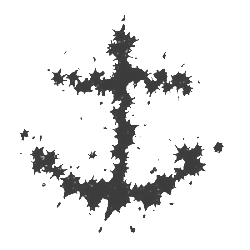Amerigo
Un livre de Stefan Zweig
Comment l’Amérique a gagné son nom, ou l’histoire d’hommes tirés de l’oubli. Dans cette superbe petite biographie d’Amerigo Vespucci, Stefan Zweig établit en préambule ce que réaffirmera Yuval Harari dans « Sapiens, Une brève histoire de l’humanité » : l’explication de l’expansion universelle de l’Europe à partir de la fin du XVe siècle (« plus de découvertes que pendant les mille ans qui ont précédé », dit Zweig, p. 23), a eu pour moteur le fait que les Européens ont été la seule grande civilisation (comparée aux Perses, aux Indiens, aux Chinois…) à assumer qu’ils ignoraient la plupart des choses du monde. Malgré les pouvoirs, les dogmes, malgré la théologie, malgré les mandarins. Assumer qu’on ne sait pas vraiment ce qu’il y a par-delà l’horizon de la Mare tenebrosum qu’évoque Zweig au début, au-delà de Gibraltar. Et un de ces jours, y aller voir. Refuser de « vivre dans un espace qu’il ne connaît pas ; enfermé dans un monde dont il ne découvrira jamais les dimensions ni la forme » (p. 15).
Alors Amerigo Vespucci voyage, écrit des lettres et c’est un de ses titres qui fera le reste : Mundus novus (p. 32). Ce n’était peut-être pas un grand navigateur, ni un grand géographe, ni un grand écrivain – quoique, qu’en savons-nous vraiment ? – nous savons, nous, combien l’histoire peut plonger dans l’ombre ceux qui méritaient la lumière et glorifier ceux qui auraient dû rester anonymes – mais peu importe, Amerigo a été le premier à écrire et faire savoir : ce monde est nouveau. Nous nous sommes trompés. Ce ne sont ni les Indes ni le Japon. C’est autre chose. Assumer et reconnaître notre ignorance. Très socratique renaissance.
Ce sur quoi Zweig met le doigt avec Amerigo, c’est bien cet essentiel au-delà de la technique : « toute découverte, toute invention ne tient pas tant sa valeur de celui qui la réalise que de celui qui en comprend toute la signification, toute la force opérante » (p. 35).
Et c’est bien par le verbe que se trame cette « grande comédie des méprises » (p. 41) : un imprimeur réunit les trente-deux pages d’Amerigo, ajoute d’autres récits et attribue le tout à Vespucci. Un titre, nouveau monde, un auteur, l’association se répand en Europe, et malgré le Florentin, à son insu, la paternité de l’Amérique lui vient. Pour preuve de son innocence, Colomb lui conserve toute son amitié…
Après l’imprimeur vient le cartographe. C’est un jeune homme de vingt-sept ans – Martin Valdseemüller – géographe à Saint-Dié, dans les Vosges, qui se méprend et attribue la paternité de la découverte de l’Amérique à Vespucci. Plus tard il se rendra compte de son erreur et essaiera de la corriger sur d’autres textes, d’autres cartes. Mais trop tard, un nom sera né. Il aura nommé l’Amérique.
Amerigo était un marchand. Pour tous les explorateurs de cette époque, les motivations commerciales étaient au cœur de leur désir d’horizon, même si les humanistes mettront Vespucci sur un piédestal. Mais quand même : « il n’a pas martyrisé des hommes et détruit des royaumes comme tous les autres conquistadors criminels : il a observé les peuples étrangers en humaniste, en érudit, décrivant leur mœurs et leurs coutumes sans les glorifier ni les blâmer » (p. 69).
Enfin, mais ça je l’avais déjà vu dans le superbe « Magellan » de Zweig, nous ne pouvons qu’avoir une bizarre nostalgie de cette lointaine époque que nous n’avons pas connue : « cette époque de découvertes donne à l’audacieux qui ose mettre sa vie en jeu une occasion unique d’acquérir gloire et richesse ; c’est une époque faite pour les aventuriers et les amateurs de risques, une époque telle que le monde n’en a pratiquement plus connu depuis. » (p. 112).
De cette improbable histoire du nom d’un continent, Zweig en tire la grande leçon : « jamais un acte n’est décisif par lui-même ; ce qui compte c’est la connaissance de cet acte, et ses conséquences » (p. 121).
Alors, finalement, ce nom venu par une incroyable série de hasards et de méprises ? « l’Amérique ne doit pas avoir honte de son nom de baptême. C’est celui d’un homme intègre et courageux qui, à l’âge de cinquante ans, s’est risqué par trois fois, sur des bateaux minuscules, sur l’océan inexploré, un de ces « marins inconnus » qui à l’époque exposaient leurs vies par centaines, s’offrant à l’aventure et au danger. Et peut-être le nom d’un homme ordinaire comme celui-là, le nom d’un homme appartenant à la cohorte anonyme des braves, est-il mieux adapté à un pays démocratique que celui d’un roi ou d’un conquistador. C’est en tout cas plus adéquat que si l’on avait appelé l’Amérique Indes occidentales ou Nouvelle-Angleterre, ou encore Nouvelle-Espagne ou Terre de Santa Cruz. Ce n’est pas par la volonté d’un être humain que ce nom très mortel a franchi le seuil de l’immortalité […]. Ainsi utilisons-nous aujourd’hui comme le seul véritable, le seul concevable, ce mot qu’un hasard aveugle se plut à imaginer par jeu, ce mot sonore, ce mot vibrant : ʺAmériqueʺ » (p 122).
Stefan Zweig
Le livre de poche, 122 p.
Écrit en 1941, publication posthume en 1944
Merci à N.-L. pour avoir recommandé ce livre à son père, qui m’en a ensuite parlé avec enthousiasme, ce qui m’a incité à m’y plonger sérieusement.