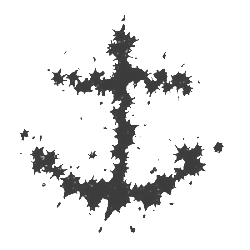Autogestion et révolution
Prologue
L’autogestion est un vilain terme, mais une délicieuse pratique. Vilain parce qu’il n’est bien sûr pas seulement question de sèche « gestion » et délicieuse pratique parce qu’elle peut donner à l’individu, à toutes les structures qu’il s’invente avec ses semblables, l’occasion de participer à la maîtrise de son destin collectif.
Équipages pirates au XVIIe siècle, Commune de Paris en 1871, collectivisations au cours de la Makhnovchtchina en 1917 et de la Révolution espagnole de 1936 à 1938, milliers de coopératives ouvrières passées et présentes, organisations révolutionnaires prônant l’autogestion, Zapatistes au Chiapas aujourd’hui… l’autogestion est une pratique souvent informelle, diverse, n’obéissant à aucun corpus de principes intangibles. Ses expériences concrètes sont confrontées à la redoutable adversité du capitalisme et des institutions étatiques, tandis que ses réalisations passées ont souvent été défaites, ou ont simplement échoué. Son historiographie est donc parcellaire et balbutiante. Le présent texte l’aborde résolument comme une matière vivante, celle de pratiques quotidiennes, et n’a pas vocation à développer une analyse historique des expériences d’autogestion.
En guise de définition, nous dirons que l’autogestion est le fonctionnement d’un groupe au sein duquel chacun a le droit et la responsabilité de prendre part à l’ensemble des décisions et taches nécessaires à la poursuite des objectifs que ce groupe se fixe.
Dans son principe, l’autogestion pose en son cœur le principe d’égalité de tous les individus. Égalité de fait, qui se matérialise par la possibilité pour tout un chacun de participer à toutes les activités, et non uniquement égalité de principe. Elle affirme et met également en œuvre la notion de responsabilité qui incombe à tout individu choisissant la vie en collectivité.
Enfin, affirmons que l’autogestion en soi n’existe pas. Un concept sans interactions avec la matière relève de la métaphysique et n’a donc aucune réalité. Seuls existent des pratiques et des actes autogestionnaires ; lorsque nous parlons d’autogestion, par commodité, c’est ainsi qu’il faut la comprendre.
Sur les bienfaits de l’autogestion
Dans le monde actuel, l’autogestion a une vocation intrinsèque d’émancipation concrète. Là où l’être humain est soumis à une hiérarchie arbitraire, à l’injustice de la possession ou non d’un capital, à l’inégalité de la biologie, l’autogestion pose un fonctionnement capable d’émanciper l’être humain. De participer à sa libération.
Mais au-delà de cette possibilité d’émancipation, elle se pose également en alternative durable aux modes d’organisation actuels, qui relèvent encore de nos jours des principes les plus archaïques des rapports humains. Elle représente donc à la fois une valeur éthique, dont l’égalité est l’essence, et une valeur de progrès, relativement aux schémas actuels d’organisation sociale, politique et économique: démocratie parlementaire et capitalisme.
Difficulté
L’autogestion est souvent mise en avant, clamée, comme on porterait un fétiche ou couverait un totem. Le simple fait de s’en revendiquer, d’en donner de vagues définitions et quelques principes concrets semble souvent satisfaire les individus et organisations qui s’en réclament. On aimerait que l’autogestion soit performative. Il n’y a pas de nature humaine ; mais force est de constater que les modes d’organisation que les humains se choisissent ont une furieuse tendance à l’atavisme des hiérarchies et se tachent souvent les injustices qui en découlent. Dans une entreprise ou bien à l’échelle d’un pays, dans un club de sport ou dans la cour de l’école, les organisations s’échafaudent autour des hiérarchies qui apparaissent et des inégalités existantes. Si spontanéité des masses il y a, elle est dans l’acceptation des inégalités et des chefs qui surgissent. La mise en pratique de l’autogestion est donc bien un effort, un raffinement de l’organisation humaine qui ne se réalise pas naturellement. Raffinement nécessaire pour quiconque ne supporte pas l’injustice qui gouverne le monde.
Elle exige de désapprendre l’obéissance au chef ; elle exige l’acceptation de la responsabilité individuelle de tous dans la conduite des affaires ; elle exige la discipline envers la communauté, là où l’organisation classique n’exige que la discipline envers le chef et la loi. Elle exige, et c’est probablement le plus compliqué dans le contexte historique de ce début de XXIe siècle, la confiance envers le collectif, c’est-à-dire finalement, la confiance en soi.
Clarification des autogestions
Nous avons vu que l’autogestion ne peut pas être un mot d’ordre universel que la seule invocation permettrait de réaliser. Elle est un mode d’organisation pratique, adapté à un contexte particulier.
Il serait en effet aberrant d’appliquer les mêmes principes d’autogestion à une entreprise, qu’à un syndicat, qu’à la conduite d’une bataille, qu’à une crèche parentale ou qu’à un pays. Aucune de ces organisations ne porte en soi, par nature, des caractéristiques qui en feraient des sujets d’autogestion différents. Mais ils se distinguent, en ce qui intéresse les pratiques autogestionnaires, par leurs structures et leurs objectifs. L’objectif d’une entreprise autogérée est de produire en assurant à ceux qui y travaillent une vie décente (c’est en tout cas un objectif minimaliste d’une entreprise autogérée), et sa structure est un ensemble d’individus égaux. Un syndicat a pour objectif la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs, peut-être a-t-il également des visées révolutionnaires, et tous les adhérents sont égaux. L’objectif d’une bataille est de la gagner, et des impératifs de réactivité peuvent conduire à conférer à certains, temporairement, une certaine autorité hiérarchique. Tous ne sont dès lors plus, pendant ce laps de temps, tout à fait égaux. Au sein d’une crèche ou d’une école, il existe, au final, une inégalité structurelle entre les adultes et les enfants. Les objectifs d’un pays (sans connotation « nationaliste », c’est à dire d’une région), comme celui d’une école et à l’inverse de celui d’une bataille, s’inscrivent dans la durée, dans le sens de leur propre perpétuation. Quant à son organisation autogestionnaire, elle consisterait à faire fonctionner ensemble des myriades de structures potentiellement elles-mêmes autogestionnaires, l’autogestion directe entre individus à une si grande échelle étant impossible.
Ces quelques exemples montrent bien combien les formes d’autogestion sont multiples. Pour tenter d’en définir quelques grands principes, il faut donc essayer au préalable de les distinguer.
Perspectives de l’autogestion
Si l’on admet que l’essentiel des tourments de l’humanité a pour origine les injustices et les abus d’autorité, ce qui parait sensé, l’autogestion est une évolution a priori positive, c’est-à-dire donnant le sens d’un progrès. Elle peut cependant s’inscrire dans deux contextes différents: soit elle se limite à une évolution dans son strict contexte d’application, soit elle se pose dans une perspective, réelle ou hypothétique, d’une forme plus globale d’autogestion. Concrètement, soit une entreprise est par exemple autogérée sans considération du contexte dans lequel elle existe, en autarcie, soit elle explicite sa vocation à favoriser l’extension de l’autogestion au contexte qui la dépasse (l’organisation économique de la société dans ce cas). Dans le premier cas, soit les protagonistes choisissent d’ignorer le contexte, soit ils pensent que leur mode d’organisation pourra, de proche en proche et par l’exemple, s’étendre à la société tout entière. Le premier choix s’inscrit finalement comme une forme d’amélioration locale des conditions de vie, légitime, mais nécessairement limitée dans ses réalisations. Le deuxième choix se rapporte au premier, à cela près qu’il repose sur une illusion: la puissance du capitalisme ne laisse guère de chance à la remise en cause durable de son cœur historique, l’organisation économique. Alors les expériences d’autogestion finissent par être intégrées au sein du capitalisme comme formes innovantes de « management ». Le second cas, celui de l’autogestion qui s’astreint à vouloir s’étendre, est a priori plus contraignant puisqu’il est nécessaire de faire des choix reposant sur une réalité qui dépasse le seul périmètre de son application. Mais parce que cette optique se démarque de l’individualisation des destins, elle est la seule qui puisse conférer à l’autogestion une perspective historique globale qu’elle ne possède pas en soi.
Autogestion économique
L’autogestion économique s’applique aux structures qui assurent les productions et les services nécessaires, ou souhaitables, à la vie en société. La première conséquence d’une telle définition est qu’il n’est pas nécessairement légitime d’autogérer tout type d’organisation économique. Le contexte général, réel ou hypothétique d’une société autogestionnaire évoqué plus haut peut mener à des contradictions insurmontables. Toute structure humaine recèle des contradictions plus ou moins sévères. Des cas peuvent être débattus; mais convenons par exemple que cela n’a pas de sens, si l’on choisit de s’inscrire dans une perspective historique, d’autogérer un cabinet de conseil en ressources humaines ou un fabriquant d’armes en temps de paix.
L’autogestion d’une entreprise, de terres, est probablement le domaine ayant connu le plus d’expériences documentées, des 1 838 000 ouvriers et paysans travaillant en autogestion pendant la révolution espagnole de 1936 [1] aux entreprises « récupérées » d’Argentine de nos jours [2]. L’objectif économique (passé l’écueil de l’acceptation ou non des contradictions évoquées plus haut) et l’impératif d’égalité, en particulier entre travailleurs manuels et non manuels, balisent assez strictement une telle pratique. La réappropriation par les travailleurs de leur outil de travail et des bénéfices de l’effort, annihilation de la pression de classe qu’imposent les capitalistes, lui donne une perspective historique.
L’obstacle principal tient à la gestion des relations humaines. A priori, dans une entreprise autogérée, les participants ne sont unis que du fait de leurs compétences et de la nécessité de travailler (en écartant les coopératives « affinitaires », qui, si bien elles peuvent fonctionner, sont structurellement incapables de s’étendre à l’ensemble de la société… nous en revenons à la notion de perspective historique). Cela implique donc de mettre en place des structures, des processus qui permettent de passer outre les différences de culture, les différences d’aspirations. Nous y reviendrons. Il est probable que le principe directeur de tels processus relève de l’acceptation pleine et entière que l’entreprise autogérée est avant une entreprise, dont la raison d’être n’est ni bonne ni mauvaise, simplement nécessaire, avec ses impératifs de production et d’équilibre économique (quelle que soit la monnaie – c’est-à-dire même en imaginant qu’il n’y en a plus, il y a toujours une notion d’équilibre économique, énergétique). Et de tenter, puisqu’il n’y a en principe pas de culture commune, de détacher l’affect de l’organisation.
Autogestion des luttes
Une lutte pour la conquête ou la défense de droits, pour contrecarrer les agissements des patrons, d’un État ou pour défaire un ennemi colonial, porte une charge d’émancipation, de restauration d’une dignité que l’adversité de classe ou impérialiste a mise à mal. Son mode d’organisation doit donc hériter d’un caractère émancipateur. Il doit poser au centre de son fonctionnement l’égalité de ceux qui luttent, et surtout mettre en œuvre une conduite collective des luttes. Ceci étant dit, rien ne permet de dire que l’autogestion d’une lutte la rend en soi plus efficace pour atteindre les objectifs poursuivis. Dans certains cas, comme celui de la conduite d’un affrontement physique, l’expérience indique même qu’une suspension ou une dégradation, partielle et sur le terrain, des pratiques autogestionnaires est plus efficace. Cela revient à dire que dans le cas de l’autogestion d’une lutte, les principes de fonctionnement doivent prévoir la possibilité de l’adoption, dans le cadre des pratiques de prises de décisions autogestionnaires, de la suspension de cette autogestion. Elles doivent en prévoir les cas et surtout les modalités organisationnelles permettant d’en décider. Il est par exemple contradictoire avec tout concept d’autogestion de l’abandonner, fût-ce temporairement, pour laisser une avant-garde mener les choses. Mais on peut envisager que des militants se choisissent un chef (appelons-le comme on veut, référent, coordinateur…) pour une action dont la coordination ne laisse pas le temps requis pour une participation collective aux prises de décision.
Mais une organisation autogestionnaire peut aussi avoir à décider de se comporter ponctuellement de façon autoritaire vis-à-vis d’une autre organisation, solidaire au cours d’une lutte, mais ayant contrevenu aux principes autogestionnaires qui régissent leurs relations (au sein d’un collectif par exemple). Autrement dit, il faut savoir suspendre l’autogestion à l’encontre de ceux qui ne la respectent pas.
Dans tous ces cas, la suspension ne peut être que temporaire, et faite de telle façon que soient transposés certains principes élémentaires: mandats précis, révocabilité des mandats, mais aussi discipline vis-à-vis des décisions collectives adoptées. Cette possibilité de suspension ou d’entorse aux principes n’est possible que parce qu’elle est temporaire.
On voit ici apparaître la distinction fondamentale entre l’autogestion d’une lutte et l’autogestion d’une organisation de lutte. La pérennité. Une lutte, par définition, s’achève lorsque l’une des parties l’emporte, ou lorsque l’affrontement s’enlise en un statu quo. Les structures d’organisation de cette lutte disparaissent en général avec elle, fût-ce avec un peu de retard. À l’inverse, une organisation de lutte a vocation à durer dans le temps, à entamer de nouvelles luttes les unes après les autres, selon ses buts (réformistes ou révolutionnaires). Cette différence confère aux structures temporaires de conduite des luttes une flexibilité supplémentaire par rapport aux organisations de lutte pérennes. Ces dernières doivent en effet se projeter au-delà des luttes du moment, en considérant leurs buts finaux. Or nous avons vu que pour une organisation qui se veut autogestionnaire, le but d’organisation autogestionnaire de la société est essentiel. Elle doit donc en particulier veiller à ne jamais s’écarter de son fonctionnement autogestionnaire, puisque ses structures sont destinées à perdurer jusqu’aux changements globaux, voire au-delà. Mais rappelons qu’une organisation de lutte doit prévoir les modalités de suspension partielle et temporaire de certains aspects de l’autogestion… de façon autogestionnaire, c’est-à-dire décidée par tous, avec l’implication de tous.
Autogestion d’organisation
Cette vaste catégorie concerne toutes les organisations humaines: crèches, syndicats, villes, régions, pays…
Distinguons parmi ces organisations celles qui ont un rôle politiquement « neutre » (citons par exemple les écoles, les clubs sportifs, les associations culturelles, les laboratoires de recherche…) de celles qui ont rôle « directif » (État, syndicats, groupes politiques… « directifs » en cela qu’ils aspirent à déterminer des évolutions de la société). Nous avons dit qu’en ce qui concerne l’autogestion le premier critère déterminant est l’objectif de l’entité à laquelle elle s’applique. La distinction entre ces organisations se fait donc selon leurs objectifs : les premières gèrent le quotidien, tandis que les secondes ont vocation à déterminer l’avenir.
Le cas de l’autogestion des organisations « neutres » se ramène, moyennant des différences d’objectifs, à celui de l’autogestion économique.
Contrairement à l’autogestion d’une lutte, celle d’une organisation « directive » (un syndicat comme la CNT par exemple) s’inscrit dans le temps, pour durer. L’urgence d’une lutte, nous l’avons vu, peut justifier des écarts, ce qui n’est pas le cas, en principe, au sein d’une organisation pérenne. L’entorse récurrente aux pratiques autogestionnaires au sein d’une organisation qui s’en réclame est au contraire le symptôme de dysfonctionnements structurels. Remarquons en effet que l’autogestion, dans aucun cas de figure, ne peut reposer sur la bonne volonté des participants ni sur le « bon sens » (le « bon sens », parce qu’il revêt l’apparence de l’évidence, permet souvent de justifier ce qui n’est pas évident ; c’est ainsi en général le réceptacle de l’idéologie dominante ; exemple : « il nous faut des chefs pour diriger, c’est le bon sens »). L’autogestion doit reposer sur la mise en place de pratiques, qui, concrètement, sont matérialisées par des institutions dont le fonctionnement est régi par une sorte de loi (statuts, charte, règlement…). Qui dit institutions, dit discipline. L’autogestion doit, puisqu’elle met au cœur de son fonctionnement la responsabilité de tous vis-à-vis de tout, imposer lorsque nécessaire. Les pratiques autogestionnaires souffrent trop souvent d’une sorte de laxisme béat, les uns imaginant que le progrès que représente l’autogestion incitera les autres à prendre spontanément leur part aux tâches et prises de décision nécessaires. Elle souffre aussi d’un effet de bord du sentiment d’émancipation qu’elle procure, qui peut permettre à certains, sûr de n’être pas soumis à une autorité, d’agir comme ils ne le feraient pas s’ils étaient soumis au système « normal ». Chez ceux-là la couardise qui les fait se soumettre aux systèmes hiérarchiques par peur de sanctions et représailles, disparaît dans un contexte d’autogestion ; on peut alors constater des comportements handicapants pour le groupe, qui ne surgissent que dans ce contexte d’égalité et d’autogestion.
Les organisations marxistes posent (posaient) clairement le caractère temporaire de leurs organisations. Temporaire en ce sens qu’elles ne préfiguraient pas les structures de la future société. Ils remettaient dès lors au lendemain de cette révolution la mise en place d’une société libre. Beaucoup de syndicalistes révolutionnaires posent eux comme principe que l’organisation qu’ils construisent pour mettre à bas le capitalisme préfigure l’organisation de la société future, que ses structures survivront à la révolution et seront les fondations de la société de demain. Conséquence logique pour des révolutionnaires dont le projet de société est une sorte d’autogestion appliquée au pays, les organisations de lutte, pour parvenir à ces fins, se doivent d’être autogestionnaires. L’histoire soviétique a montré ce qu’il en coûte de remettre au lendemain la démocratie directe.
Cependant, qui a passé quelques années au sein d’une organisation autogérée et clamant que son objectif est de faire de ses structures les bases de la société future est fou à lier s’il y croit vraiment. Il suffit d’imaginer. Transposer à l’échelle d’un pays les misérables chamailleries (mélange de lutte pour le pouvoir dont l’assemblée générale est l’arène, de mise en avant de l’égo avant l’intérêt collectif, de choix d’un élément social prépondérant sans entendre d’autres arguments, etc.) qui font souvent le quotidien de quasiment toutes les organisations, libertaires ou non. Impossible. Aucune organisation n’est à ce jour en mesure de prétendre qu’une société organisée selon son mode de fonctionnement serait viable. Il y aurait beaucoup à développer. Mais retenons que ce qui manque manifestement à la culture de lutte révolutionnaire est la rigueur organisationnelle.
Ajoutons enfin que cette question des structures de lutte, syndicales par exemple, sensées se muer en structure d’organisation de la société future se pose différemment si ce sont les événements qui donnent à cette structure une prépondérance de fait (en Espagne, en 1936, le coup d’État de Franco a laissé la République tout à fait désorganisée ; la CNT s’est trouvée de facto être la seule force en mesure de structurer la société).
Que reste-t-il alors?
Autogestion et projet de société
La complexité intrinsèque du fonctionnement de toute organisation humaine les rend tout à fait non déterministes. Il est dès lors inutile de concevoir le plan détaillé de ce que sera la société future. Inutile, mais aussi dangereux: l’application de projets conçus a priori, loin des âpretés et des imprévus de la réalité future peut causer plus de torts qu’ils n’en réparent.
Un projet de société ne doit donc pas dire, décrire dans le détail la société qu’il faudra mettre en place en cas de victoire [3].
La seule chose sur laquelle nous puissions statuer aujourd’hui de façon certaine, ce sont les raisons pour lesquelles le monde mérite d’être bouleversé par un événement révolutionnaire, c’est-à-dire les causes des injustices et inégalités. Ainsi, un projet de société doit dessiner les institutions et pratiques qui permettraient d’écarter ces maux. Il ne peut dire que ce qui sera proscrit dans l’organisation économique et politique, pas définir péremptoirement tout ce qui sera mis en place.
Pour dépasser la construction en négatif, le tropisme de l’anti, il est cependant nécessaire de proposer. Mais proposer sans concevoir l’organisation de lutte comme un outil pour imposer le futur. L’instrument de lutte ne peut au mieux, éthiquement, que tendre à refuser ce que l’on sait nocif (au regard de la réalité présente), et viser à imposer les structures et modalités qui permettront de choisir l’avenir.
Un projet de société autogestionnaire peut par exemple affirmer qu’aucun être humain ne pourra, dans une société post-révolutionnaire, vivre du travail d’un autre être humain, et en tirer les conséquences en termes d’organisation économique. Mais il n’est pas possible d’affirmer que le meilleur système économique sera une économie planifiée organisée au niveau national, ou bien une sorte de concurrence limitée entre entreprises collectivisées.
Une telle méthode présente un intérêt supplémentaire, qui est de mettre en lumière les interdits que prônent ceux qui rédigent un tel projet de société, ce qui est beaucoup plus intéressant que les volontés, qui sont souvent des déclarations de principes lénifiantes et consensuelles.
Quelques écueils liés à l’autogestion
La pratique de l’autogestion est plus difficile que celle de l’organisation hiérarchique et inégalitaire. Simplement parce cette dernière flatte et repose sur des tendances spontanées, animales, qui surgissent lorsque les humains se rassemblent : volonté de pouvoir, assujettissement au charisme, appropriation des responsabilités, volonté d’accroître ses biens personnels…
Face à ces réactions, la mise en place d’un fonctionnement autogestionnaire peut être le fait d’individus partageant cet idéal. Il s’agit alors d’une sorte de groupement par affinités, le groupe résultant de l’assemblage d’individus ayant une culture commune préalable. Bien que cette culture puisse se transmettre à de nouveaux entrants, l’entreprise n’est pas aisée. Le risque est alors de voir des individus, voire des structures dans le cas de groupes autogestionnaires plus vastes, subrepticement mis de côté, exclus parce qu’ils ne partagent pas cette culture commune. De fait, cette culture n’est souvent que l’un des aspects d’une culture plus vaste: libertaire, de gauche, culturelle, communautaire, nationaliste… On voit donc que ce fonctionnement par affinités est nécessairement limité. Il ne peut en aucun cas prétendre à sa propre généralisation, et cela vaut pour toutes les catégories de structures autogérées évoquées plus haut. Or nous avons vu qu’une autogestion qui ne se concevrait que comme un îlot sans vocation à la généralisation est nécessairement limitée, voire stérile (n’ayant pas de descendance).
Les conditions d’une telle possibilité de généralisation doivent permettre d’aller au-delà de la culture des participants. Cela implique ici encore la mise en place de véritables institutions. L’autogestion ne doit pas reposer sur la bonne volonté ou la culture d’un groupe ou d’un noyau de convaincus, mais sur l’acceptation de règles de fonctionnement sur lesquelles le groupe s’est mis d’accord, et qu’il s’engage à respecter comme une loi organique. Une sorte de contrat social issu de quelque assemblée générale. La difficulté consiste alors essentiellement non pas tellement en la définition de ces règles, ni même en leur modalité d’adoption (qui constituent l’un des principes de fonctionnement autogestionnaires) qu’en leur respect. Une situation d’autogestion est facilement vécue comme une émancipation des contraintes et des coercitions de l’organisation traditionnelle de la société. On constate dès lors bien souvent, comme nous l’avons déjà souligné, une difficulté endémique à faire preuve de discipline au sein des groupes autogestionnaires. Consciemment ou non, les membres d’un groupe autogestionnaire répugnent à appliquer avec rigueur les règles communes, de peur de voir réapparaître les schémas que leur expérience vise justement à éviter. Or le respect des règles communes, et surtout leur application qui peut être coercitive via les institutions d’autogestion est la seule condition qui permette à ce groupe de prospérer malgré les différences de sensibilité, de culture et d’affinité. Tout cela, bien sûr, à condition que l’objectif de l’autogestion soit de remettre fondamentalement en cause les injustices et inégalités.
Cette nécessité d’établir des institutions, dont le fonctionnement doit bien sûr respecter les règles de bases de l’autogestion – égalité et absence de hiérarchie exécutive – est particulièrement vitale lorsque l’entité autogérée est constituée de groupes constitués (organisation syndicale, communauté de communes, fédération…). Parce que dans ce cas, les groupes autonomes développent bien souvent leurs cultures propres, qui, en l’absence de discipline et de respect des règles communes suscitent souvent des désaccords qui mènent à des conflits majeurs et irréversibles, et finalement à des scissions. Remarquons qu’il ne peut s’agir de « prendre » les institutions actuelles, si peu démocratiques, et de prétendre en faire quelque miracle [4]. Entendons-nous bien: les institutions autogestionnaires n’empêcheront jamais les conflits ou le sentiment d’être exclu d’une culture partagée par une majorité. Mais elles sont la condition nécessaire à la possibilité du succès pérenne d’une expérience autogestionnaire. L’autogestion n’est pas « naturelle » ; elle ne surgit pas spontanément lorsque les hommes se débarrassent des inégalités et des hiérarchies ; lorsqu’elle semble « spontanée », comme certaines collectivisations paysannes, elle fait en réalité écho à des traditions ayant existé, redécouvertes (mais n’existant pas partout). Elle se construit socialement, ce qui revient à bâtir des institutions.
L’articulation entre autogestion et pratiques révolutionnaires
Une société humaine évolue en général de façon continue et progressive, c’est-à-dire de proche en proche : chaque nouvel état étant le résultat de l’état précédent très légèrement modifié. Toutes ces évolutions sont réversibles, mais la somme de ces évolutions devient tout aussi continûment irréversible. Cela marque le sens du temps social.
Si ce sens du temps existe, il est impossible d’affirmer qu’il existe un sens de l’évolution morale ou éthique des changements sociaux : rien n’indique que nous allions vers le meilleur, vers plus de justice sociale, de paix ou de bien-être. L’observation du monde de ce début de XXIe siècle l’illustre assez clairement.
Cependant, les positions réformistes reposent sur un tel postulat. Évacuons le réformisme de droite, dont l’objectif est explicitement d’établir ou de rétablir les conditions politiques et économiques où les riches et les puissants sont le plus à leur aise possible dans leur entreprise d’accumulation et de gestion de la société. Quant au réformisme de gauche, héritier décadent des idéaux socialistes, il repose sur un tel postulat : des modifications mineures, qui supposent de détenir le pouvoir pour les entreprendre, permettent de tirer la société vers le mieux pour tous. Supposons qu’il s’agisse là d’une véritable position de principe, et non d’un discours masquant la seule volonté de s’emparer et de détenir le pouvoir.
Ces évolutions concernant la justice sociale, l’égalité, la liberté, socle du principe du réformisme de gauche, se heurtent toujours à une limite infranchissable : elles ne peuvent remettre en cause les structures économiques capitalistes et politiques autoritaires qui garantissent l’ordre des choses, puisqu’elles sont initiées du haut de ce même pouvoir. Le pouvoir ne se suicide pas.
Ainsi, le réformisme (transitions de proche en proche vers le meilleur) ne peut mener qu’à deux points de rupture : soit une rupture avec son objectif (améliorer les conditions de vie) parce que leur poursuite mènerait à la remise en cause fondamentale des structures existantes ; soit une rupture avec son essence en se transformant en pratique révolutionnaire parce qu’un point de non-retour a été atteint.
Le réformisme peut (nous avons seulement montré qu’il peut aussi ne pas) améliorer les conditions de vie ; c’est ce qui donne sa légitimité aux syndicats.
La question est de savoir si l’on se satisfait d’améliorations, dans le cadre du système qui génère l’injustice ou bien si l’on est prêt à remettre en cause le système lui-même. Remarquons cependant que dans la période actuelle, en France, le réformisme ne conquiert plus rien, mais prétend défendre les « acquis » contre les offensives capitalistes. En réalité, réformistes de gauche comme représentants de la droite plaident tous pour des « réformes », plus ou moins les mêmes.
L’évènement révolutionnaire, c’est la discontinuité. C’est un phénomène, une transition entre deux phases d’Histoire. Si bien sûr il réussit. En soi, parce que cet événement comporte des risques de désordres, de violences et d’aléas pour la vie, seuls des nihilistes peuvent la souhaiter. Mais on ne peut que souhaiter ce qu’elle permettra de réaliser et de faire cesser. Comme certaines guerres, l’événement révolutionnaire est un mal nécessaire pour quiconque ne se satisfait pas des réformes qui, éternellement, font osciller la société d’un état plus ou moins vivable à un état tout à fait invivable pour la majorité des habitants de la Terre.
Quel rapport avec l’autogestion?
La révolution n’existe pas. Il n’existe que des pratiques et des événements révolutionnaires. Mais en soi, l’autogestion est une méthode, un mode de fonctionnement. Si elle implique le respect de certaines valeurs, comme l’égalité, elle peut être mise en œuvre en contradiction avec l’essentiel des principes et pratiques émancipatrices révolutionnaires (la transformation de slogans autogestionnaires en promotion droitière de la cogestion par la CFDT est significative [5]). Elle ne suffit donc pas, elle ne porte pas de principes révolutionnaires intrinsèquement. Mais elle peut incarner des modes d’organisation que l’on souhaiterait voir remplacer les organisations actuelles de l’entreprise, de la société, des pays. Elle le peut, et elle est la seule façon de préfigurer dans la pratique, c’est à dire autrement qu’en concepts, cet autre futur. Autrement dit, l’autogestion ne peut en aucune façon être suffisante dans la lutte révolutionnaire, mais certaines de ses formes lui sont absolument nécessaires, en préalable.
L’une des conséquences de ce qui précède est qu’il convient, dans une optique révolutionnaire, d’adjoindre à la pratique de l’autogestion une pratique de la lutte à visée révolutionnaire (et non uniquement des déclarations de principe).
Le temps et l’énergie n’étant pas inépuisable, la question se pose si l’on doit rendre prioritaire la recherche de la discontinuité révolutionnaire par la lutte, ou bien la construction de l’une de ses conditions nécessaires, la culture et l’organisation de l’autogestion.
Deux cas de figure se présentent alors: 1/ La société est dans un état d’équilibre, c’est-à-dire que les phénomènes progressifs et continus cités plus hauts ont lieu, qu’il n’y a pas de situation de guerre, de crise brusque et majeure, de vaste effervescence sociale… Dans ce cas, les deux sont absolument nécessaires. La recherche de discontinuité sans préoccupations concernant le quotidien mène à l’arbitraire (si pas de quotidien, pas d’assise sociale, pas de base sociologique, les groupes de lutte armée européens de la fin du XXe siècle l’ont subi). 2/ En temps de guerre ou de crise, il peut être nécessaire de rechercher la discontinuité sans disposer de la légitimité qu’apporte la pratique de l’autogestion, et de s’y consacrer en priorité.
Autrement dit, lorsque la société ne vacille pas, la discontinuité ne peut aller de pair qu’avec un travail de base de construction de ce que nous souhaiterions pour l’avenir; mais lorsque la société vacille (quelles qu’en soient les causes), la recherche de rupture est une sorte d’opportunisme justifié [6].
La différence entre une société « à l’équilibre » et une société « en crise », c’est la quantité de temps dont elle dispose. Dans la première, le temps n’est un facteur contraignant pour personne ; dans la seconde le temps disponible est l’un des critères essentiels de toute décision.
Le quotidien sans la recherche de discontinuité, soit demeurera végétatif (c’est-à-dire très limité, ou bien fera trop de concessions), soit sera absorbé par le système. La vocation révolutionnaire sert, dans une certaine mesure, d’antidote (dans une certaine mesure parce que le propre du capitalisme est d’être capable d’intégrer jusqu’à son plus intime ennemi).
Épilogue
Nous avons vu que l’autogestion est une pratique émancipatrice, qui, bien qu’elle ne porte pas en soi de caractère révolutionnaire, est nécessaire à toute démarche révolutionnaire. Ne serait-ce que parce qu’elle permet de s’ancrer dans la réalité, de se confronter à la matière. En cela, la pratique de l’autogestion, économique ou d’organisation, constitue un élément validant partiellement ce que Alain Badiou appelle « l’hypothèse communiste » [7], c’est-à-dire la possibilité de se libérer de la subordination : des travailleurs à un patron, de membres d’une organisation à des dirigeants. Et finalement, il n’y a que ça ; nous ne prétendons pas au bonheur universel ; nous aspirons simplement à la justice, à la liberté et à l’égalité.
Notes :
[1] Franck Mintz, « Autogestion et anarchosyndicalisme, analyse et critiques sur l’Espagne 1931-1990 », Éditions CNT région parisienne, 1999 [2] Cf. le film de David Futerman, « Argentinazo », 2004.
[3] Le très beau « Concepto Confederal del Comunismo Libertario », projet de société communiste libertaire adopté par la CNT en 1936 à Saragosse, le disait d’ailleurs déjà clairement : « Nous devons tous garder à l’esprit que structurer, avec une précision mathématique, la société de l’avenir serait absurde puisqu’il existe souvent, entre la théorie et la pratique, un véritable abîme ».
[4] Le « miracle » se fait cauchemar… ou logique trahison : « Il est illusoire de vouloir réaliser l’autogestion en faisant abstraction de la conquête du pouvoir d’État par les travailleurs », Programme autogestionnaire présenté par le PSU, Éditions Syros, 1978.
[5] Brochure syndicaliste n° 3 de la CNT, « CFDT - 1964 - 1996 – De l’alibi autogestionnaire à la collaboration de classe », 1996.
[6] Selon les conditions historiques, il peut être plus efficace de « s’occuper moins de coopératives que de grèves », Bakounine, cité par Daniel Guérin, Idées / Gallimard, 1965.
[7] « De quoi Sarkozy est-il le nom ? », Alain Badiou, Nouvelles Éditions Lignes, 2007.