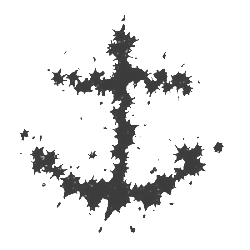Bad girl
Un livre de Nancy Huston
Il y a quelques semaines, en partant après avoir passé quelques jours chez nous, une amie nous demande si nous avons vu son livre, « Bad girl » de Nancy Huston. Nous cherchons un peu, regardons sous le chat, sur la bibliothèque, dans le panier de linge sale, dans la corbeille à fruits. Impossible de le retrouver… il apparaîtra bien, nous te le rendrons ; d’accord, c’était bien de vous voir ; oui, reviens vite, bon retour, au revoir ; à bientôt… Le lendemain, en passant l’aspirateur, je trouve le livre sous le canapé (d’une certaine façon, il était donc bien sous le chat). Je le pose sur la bibliothèque, bien en évidence, histoire de nous souvenir de le rendre à notre amie. Deux semaines plus tard, je dois prendre l’avion, plus de dix heures de vol. Les Russes superstitieux s’assoient sur leur valise avant de partir en voyage, pour écarter le mauvais œil. Chacun ses rites. Moi, j’aime hésiter à choisir un ou des livres. Je tombe sur « Bad Girl », allez, je serai en bonne compagnie : je le prends.
Les premières pages me saisissent. En quelques mots justes, je plonge in utero. Annonce de la grossesse, souffrance de l’avortement… appel à bâtir des monuments à l’Avortée inconnue, comme nous en avons pour le soldat.
C’est écrit court et saillant, comme des notes faussement désinvoltes qu’un éditeur aurait préféré appeler « classes de littérature ». C’est limpide : « Peuvent vous tuer : la mésentente entre vos ancêtres. L’exil intérieur. L’incompréhension d’un soi par un autre soi » (p. 50).
Huston se raconte, mêlant délicatement l’histoire de sa famille avec la sienne, avec les échos de la grande Histoire. C’est incomplet, en fait, comme si la vie elle-même ressemblait davantage à des notes qu’à un roman bien structuré. Elle le revendique : « Ton ignorance fait partie du tableau » (p. 90).
Elle fait des phrases superbes. Et parce que nous sommes des mécaniques symboliques et non des machines rationnelles, c’est parfois un peu péremptoire, dur et injustifié comme ça me plait : « Un enfant qui pense que sa mère a voulu le tuer peut quitter son pays et sa langue pour comprendre enfin pourquoi il mérite la mort » (p. 104). Ou encore : « Toujours la maîtrise doit être contrebalancée par le mystère. Chassez le mystère, il vous restera Kolyma, Sobibor, Fort McMurray, Sabra et Chatila » (p. 211).
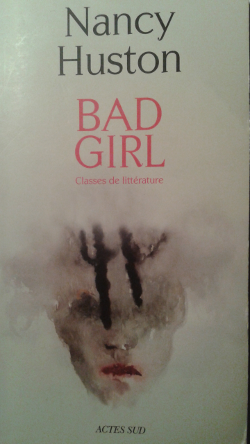 Les invariants sont : rapport à la mère, naissance / avortement, éducation, amour manqué, matérialisme. Et il y a ces moments qui ont eu tant d’importance pour un enfant, mais qui n’ont souvent été qu’une infime péripétie du quotidien pour les parents. Nancy Huston parvient à transmettre, en moins d’une page, comment une histoire de mère montée sur un tabouret et de bonbons à la menthe cachés peut devenir un traumatisme qui « arase ton être, te réduit en cendres » (p. 140).
Les invariants sont : rapport à la mère, naissance / avortement, éducation, amour manqué, matérialisme. Et il y a ces moments qui ont eu tant d’importance pour un enfant, mais qui n’ont souvent été qu’une infime péripétie du quotidien pour les parents. Nancy Huston parvient à transmettre, en moins d’une page, comment une histoire de mère montée sur un tabouret et de bonbons à la menthe cachés peut devenir un traumatisme qui « arase ton être, te réduit en cendres » (p. 140).
Il y a de multiples références à Louise Bourgeois. Récemment, j’ai vu à Bilbao ses araignées géantes, ses chambres bizarres figurant son esprit. Alors tout cela m’a parlé, fraîchement parlé. Comme les citations de Virginia Woolf. Autant d’artistes femmes que mes obsessions épiques m’ont souvent occultées… quel tort. Comment passer à côté de quelqu’un capable d’écrire une phrase comme : « La première fois que ma mère loua un de mes écrits, ce fut comme si j’étais un violon et que l’on me jouait » (V. Woolf, p. 192).
Et j’y ai trouvé des clés, dans ce livre. J’avais une intuition depuis longtemps, Huston semble la confirmer : parler d’un traumatisme n’est pas nécessairement le meilleur moyen de le dépasser. Elle a une vision matérialiste du corps, au sens physique. Et elle rappelle qu’au moment d’un traumatisme le lobe frontal, la partie du cerveau où est gérée la parole, « ferme boutique ». D’où « l’aberrante notion freudienne selon laquelle parler de son trauma aiderait à le surmonter »*. Seront bien plus efficaces : la danse, le théâtre, le rolfing (?) et le yoga. « Des trucs de corps » (p. 184). Mais aussi, bien que cela soit moins limpide, pourquoi les humaines sont « les seules femelles primates […] à retravailler leur apparence dès la prime jeunesse » : le mystère du pourquoi de la fécondité du seul corps féminin, un mystère « intérieur », on va le mettre dehors. « Ainsi les femmes seront-elles transformées, et se transformeront-elles, en mensonges, en apparence, en objets ». Une autre histoire – sombre – de la coquetterie féminine (p. 214-215).
Voyage au plus profond de l’esprit d’une femme qui n’aime pas dormir : « La nature de la Femme est d’être coupable. Elle est coupable rien qu’en étant là (jeune et attirante), un festin interdit pour les yeux des hommes. Tu apprendras cette leçon très tôt, petite Dorrit, et elle te précipitera dans la fosse aux serpents où se confondent amour et désir, désir et amour. Dorénavant tu te sentiras désirée, mais au sens étroit et effrayant du terme, non au sens large et rassurant dont tu rêves depuis toujours » (p. 199).
Et avant, comment deviennent-elles femmes ? « Devenir femme, c’est, entre autres, apprendre à jouer la femme, être consciente des regards que l’on porte sur votre corps, et faire semblant de ne pas l’être du tout en montrant clairement que vous l’êtes ». Puis vient la citation d’Anne Truitt, qui raconte un souvenir de petite fille, le jour précis où « le mensonge a démarré » : devant une glace, on la prépare, on veut lui faire une boucle de cheveux sur le front. Elle se sent bien, complète, sans cette boucle. Mais on insiste : « Mon moi sain s’estimait complet sans boucle, et reconnaissait clairement que l’on me rendait ridicule. Mais le fait d’être louée me fascinait. Ma joliesse faisait danser toute la chambre. Je savais que je n’avais rien fait d’autre que rester là debout. Mais voilà : je me mis à vouloir plaire pour être louée. Rien que pour goûter la doucereuse saveur de la louange, je me mis à jouer ce rôle, à accepter ce que je ne désirais pas, ce que je ne croyais même pas être mon intérêt, à participer au mensonge selon lequel j’étais quelqu’un de spécial » (p. 219).
Je referme le livre avec l’impression d’avoir passé un moment dans la soute d’une écrivaine, et au cœur d’une femme. Merci à notre amie de l’avoir oublié, et à notre canapé de l’avoir dissimulé.
* (14.08.2023) La vérité est que je n’en sais pas grand’chose du grand parleur silencieux tapi en nous qui joue au bonneteau avec nos sentiments, nos désirs, nos peurs et nos traumatismes, à notre insu. Je n’ai que quelques vagues idées et voir Huston confirmer l’une d’entre-elles m’a plu. Mais un ami psychanalyste a réagi et comme il fréquente depuis longtemps le parleur silencieux, il doit avoir raison: « Nancy Huston se trompe : il n’est pas du tout inutile de parler d’un traumatisme, mais bien sûr ça ne résout pas tout. D’ailleurs, comme disait l’autre, “le langage a été donné à l’homme pour dissimuler sa pensée”, mais de là à le tenir pour superflu… »
Bad girl – Classes de littérature
Nancy Huston
Actes Sud, 263 p.
2014