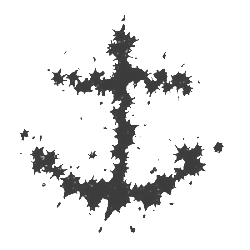Ceux qui trop supportent
Ceux qui trop supportent – Le combat des ex-GM&S (2017 – 2021)
Un livre d’Arno Bertina
Les gens qui l’ont aimanté. Voilà ceux dont parle Arno Bertina dans son dernier livre, Ceux qui trop supportent – Le combat des ex-GM&S (2017 – 2021). Un projet d’histoire immédiate où l’on verra le romancier s’astreindre à l’exactitude des faits et des propos, par respect pour les hommes et les femmes qui lui ont parlé, par fidélité à la réalité.
C’est l’histoire de l’hallucinant et interminable essorage d’une usine et de ses travailleurs. Le groupe Altia, par exemple, qui a acquis l’entreprise, va lui imposer un loyer pour vider sa trésorerie. « Une tique vient de se poser sur la bête, elle va la vider de son sang » (p. 43). Ce capitalisme financier, désincarné, qui n’hésite pas à se dévorer lui-même lorsque nécessaire, est mené par des « patrons-salariés » (p. 36) qui ont succédé aux « patrons-acteurs ». Des gens dont nous n’avons peut-être pas pris la mesure de la détermination, des stratégies, que Warren Buffett évoquait avec franchise en 2005 : « Il y a une guerre des classes, c’est un fait. Mais c’est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner » (p. 72).
Et pourtant, en contrepoint de la résistance des ouvriers on voit aussi dans ce livre la fébrilité des capitalistes. Autre exemple : les frais de gardiennage exorbitants chez Fralib, qui confectionnaient les thés Lipton et Éléphant. Lorsque son activité fut à l’arrêt suite à un conflit social, le groupe Unilever a dépensé plus de 5 millions d’euros en gardiennage et surveillance de son site de production. La motivation était surtout idéologique : empêcher à tout prix que les ouvriers puissent refaire tourner les machines et ainsi montrer qu’ils peuvent se passer d’actionnaires et de patrons, en marge du système capitaliste et en s’approvisionnant en circuit court. C’est le poison de cette démonstration que les groupes capitalistes craignent le plus (p. 86). Ce qu’on voit, lorsqu’ils déploient leurs hélicoptères ou ces frais de surveillance exorbitants, c’est leur peur. Ils font la guerre, c’est entendu. Mais ils ont aussi une conscience aiguë de leurs vulnérabilités (p. 99).
Le livre est une chronique localisée et incarnée de la lutte des classes au début du XXIe siècle. Le capitalisme est sans dehors, il nous englobe tous, il insiste pour nous appeler tous « classe moyenne » afin de désamorcer la vigueur du souvenir de la classe ouvrière, qui lui a quand même arraché quelques beaux morceaux (p. 102).
La chronique est aussi une vaste réhabilitation. Réhabilitation de la fierté des travailleurs, une notion qui a mauvaise presse, qui est souvent cannibalisée par « l’arrogance, qui est une panique » (celles des faibles, que fédère souvent le refus de l’étranger) (p. 32). Réhabilitation de la fraternité : « J’avais perdu de vue cette fraternité possible. Les rapports étaient simples, l’humour affleurait toujours. Même dans les moments difficiles, il y avait toujours ce plaisir d’être ensemble. Il y avait, oui, une alchimie particulière » (Marie Brun, p. 33).
La classe des gens qui résistent fait un contraste cruel pour les « vulgaires » capitaines d’industrie (p. 107). La classe, c’est d’abord l’absence de mesquinerie. C’est le goût de la dépense, aussi faibles que soient nos revenus. Et Bertina de citer Georges Bataille qui décrivait sa conception du chef, de l’aristocrate « la richesse […] est entièrement dirigée vers la perte en ce sens que ce pouvoir est caractérisé comme pouvoir de perdre. C’est seulement par la perte que la gloire et l’honneur lui sont liés », autrement dit, la capacité à sacrifier toutes ses richesses sous les yeux de son rival (p. 107). Mais les capitalistes n’aiment pas dépenser et ne supportent pas le risque. Une idée à contre-courant de l’absurde cliché de la prise de risque, qui serait la raison de la rémunération des actionnaires. Vraiment ? Regardez donc ce qui se passe lorsqu’advient une situation réellement critique, comme la crise économique de 2008 ou, plus récemment, la pandémie du Covid : les représentants des patrons, apeurés et geignant, demandent – exigent, sanglotent, menacent, bavent et caressent – des aides de la collectivité (p. 98).
 La vulgarité des capitalistes s’exprime aussi en mépris, comme l’illustrent ces mots d’Emmanuel Macron voyant dans les gares des lieux où l’on croise « des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien » (p. 142 – inauguration de la Station F, 29 juin 2017). Et il s’agit bien de vulgarité, puisqu’au bout du compte c’en est bien l’auteur qui en est flétri.
La vulgarité des capitalistes s’exprime aussi en mépris, comme l’illustrent ces mots d’Emmanuel Macron voyant dans les gares des lieux où l’on croise « des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien » (p. 142 – inauguration de la Station F, 29 juin 2017). Et il s’agit bien de vulgarité, puisqu’au bout du compte c’en est bien l’auteur qui en est flétri.
Les puissants sont des minables qui passent leurs petites dépenses en notes de frais : « Pour que des vies comme celles-là aient quelque chose d’électrisant, il leur faudrait le goût du risque, le sens de la perte, le goût du jeu. Si tu te crois puissant, rien de plus consternant que d’envoyer à ta boite la note de frais » (p. 108). Et quand ils ne dégrèvent pas leurs mesquineries en notes de frais, ils fraudent, simplement, mais en grand : la fraude à l’assurance chômage représenterait 58 millions d’euros par an, quand les entreprises soustrairaient dans le même temps 80 milliards : « Les entrepreneurs ne sont donc pas seulement des aveugles tâtonnant sur le plan des stratégies économiques ou commerciales ; ce sont aussi des voleurs de grand chemin, sans foi ni loi » (p. 104).
Les GM&S, eux, sont droits. Ils ne volent pas. Et s’ils ont a de l’argent, ils le dépensent.
Quand Bertina dit : « Donner, partager. Je ne suis heureux qu’à la condition de voir les autres se réjouir aussi » (p. 181) on ne peut que penser à la citation de Bakounine : « La liberté d’autrui est d’être la mienne à l’infini ».
Ils se sont battus, les GM&S. Et leur lutte pour que survive leur travail, leur outil de travail, ils la connectent au passé. L’importance de la lignée, savoir d’où l’on vient ; chez ces ouvriers creusois, c’est le souvenir de la Résistance, des maquis, qui est encore vif. « Ils savent relier des situations bien différentes en apparence, tout en restant précis : ils pensent large » (p. 131). Par ce prisme, ils sont intellectuellement beaucoup plus puissants que bien des intellectuels qui ne parviennent pas – plus ? – à penser large, dans le temps et dans l’espace.
Bertina montre aussi en quoi la lutte elle-même peut devenir une émancipation, quelle que soit son issue. Ainsi, ce cadre qui se range du côté des ouvriers et qui dit (p. 119) : « Dans la lutte, c’est un plus vrai et plus grand collectif qui se bricole spontanément. On s’est un peu découverts, des barrières sont tombées. Dans la lutte il n’y a plus de chefs, plus de cadres, et ça c’est quelque chose que je garderai, c’est vraiment important. Dans le combat, plus de hiérarchie, seulement un objectif commun. »
Leur ambition : « rester honnêtes et dignes » (p. 122). On peut se demander ce que ça signifie. Ce que ça implique en termes de prises de risque et de flirt avec la légalité, en regard de l’efficacité des actions. En synthèse : tout s’est judiciarisé, l’essentiel se règle devant des tribunaux, par avocats interposés ; la construction d’un rapport de force en restant dans le cadre de la légalité ne suffira probablement pas. C’est peut-être là qu’ils se trompent : « Nous on a quand même une estime pour la République, ça représente quelque chose, alors qu’il [le ministre Le Maire] ne veuille pas descendre jusqu’à nous, c’est-à-dire jusqu’à la salle des négociations, eh bien tant pis, on fera un pas dans sa direction » (p. 66). Histoire d’une confiance trahie. C’est une « tragédie […] quand tu tiens à respecter un système qui t’ignore ou qui te broie » (p. 205). Mais ils sont honnêtes et tiennent à cette honnêteté. Mais « quelles solutions ? Comment écarter l’option violente puisque l’ordre établi ne se corrige pas de lui-même, pacifiquement ? » (p. 212). Alors on finira le livre comme Laurence Pache, le « visage […] fermé, comme pressé par des forces agissant en sens contraire » (p. 214).
Cela finit en combat judiciaire, en droit, et non en rapport de force, ce qui caractérise la majorité des mobilisations actuelles ; et, finalement, les puissants « ont la loi pour eux mais ne sont pas en paix ; ils savent qu’en regard de la morale leurs agissements sont dégueulasses » (p. 168). Et la « loi est changeante ; une certaine morale ne l’est pas » (p. 199). Un jour, faire ce que les financiers ont fait aux GM&S pourrait être illégal. Quoi qu’il advienne, c’était, c’est et cela restera dégueulasse.
Comme le dit l’un de leurs avocats : « Je crois au rapport de force dans les négociations, mais également, sur un autre plan, au mouvement de balancier ; en ce moment le balancier est très loin [de nous], mais il va revenir. S’ouvrira alors une période comme il en a déjà existé, de plus grande justice sociale. En tout cas j’ai besoin de me dire que j’y travaille, avec d’autres » (p. 138). C’est aussi ce que fait Bertina, même s’il s’interroge avec discrétion, dans une note de bas de page, « sur le sens de [son] propre livre… Un livre de plus qui ne changera rien aux équilibres du monde ? » (p. 76).
Les cèpes, dont un heureux cueilleur ramasse 2kg, sont l’occasion d’une leçon qui rappelle que l’humanité est coopération avant d’être compétition : « Les omelettes aux cèpes ignorent le règne de la compétition » (p. 183), ce qu’illustre aussi Serge Lemaire, retraité de GM&S qui devient pompier volontaire : « n’importe qui ne part pas en retraite en se disant qu’il utilisera ce qui lui reste de souffle et de force physique à tenter de sauver les autres » (p. 187).
Finissons par une des plus belles phrases du livre (p. 131) : « (J’aurais voulu écrire un livre qui ne mentionne pas les larmes des ouvriers…) ».
La littérature ne parle pas que d’elle-même, Arno Bertina le montre. Avec ce livre il la lève haut contre le « risque […] de la langue morte des médias » (p. 230).
À la fin, il se demande s’il n’aurait pas écrit un livre de deuil plutôt que le livre de combat qu’il ambitionnait (p. 222). On ne sait. Mais même si c’était le cas, c’est un deuil nécessaire. C’est notre période historique, pour le moment. Faire le deuil de celle que nous souhaiterions est sans doute nécessaire. Pour repartir aux cèpes. Et cultiver la lucidité qui nous permettra de déceler les premiers moments de l’inversion du balancier.
Ceux qui trop supportent – Le combat des ex-GM&S (2017 – 2021)
Arno Bertina
Éditions Verticales, 231 p.
2021