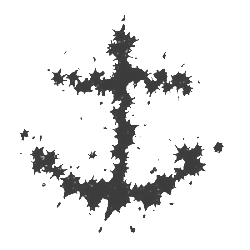Continuer
Un livre de Laurent Mauvigner
Une femme que l’on découvre fragile, un peu perdue, décide d’essayer de sauver son fils. Lui est un jeune en train de mal tourner : il fréquente des types d’extrême droite, il a assisté, passif, au viol d’une fille perpétré par ses amis aux cranes rasés et aux idées courtes… Sa mère lâche tout et l’emmène pour un long périple à cheval – l’un des intérêts passés de son fils – au Kirghizistan.
Ça commence bien. Mais ça commence mal. C’est, au début, le style qui me tirait par la manche et me susurrait : laisse tomber.
Ça commence par un vilain petit artifice de style, des « on » pour décrire ce que font les personnages : « On n’a pas le temps de se dire qu’on peut mourir ici […] » (p. 13) et alors on se demande, « on » qui ? « Ils », plutôt, non ? Et dix pages plus loin des répétitions de « comme s’il […] comme s’il » et là on se demande : mais il fait quoi ?
Et puis il y a les adjectifs. « Lorsque les deux garçons veulent entrer, une fille à la voix trop aiguë se met à crier en leur interdisant l’accès ». Trop aiguë ? C’est quoi, trop aiguë ? L’auteur à l’air de savoir, moi non. Et encore : « Elle ne le voit pas, elle est terriblement sexy » (p. 29). Dernier exemple parmi… trop, « Sibylle est belle » (p.59). Mais Mauvigner ne dit pas comment, en quoi elle est belle ; ou plutôt il dit des choses vagues, elliptiques. Peut-être laisserait-il place à l’imagination ? Très bien, mais dans ce cas pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et s’abstenir de donner son point de vue, son jugement : moi, auteur, je vous dis que je la trouve belle.
Je lisais en pestant contre une certaine tendance de bien des auteurs français au style maniéré, qui parlent trop à l’intellect du haut de leur subjectivité. Un style d’écriture moins présent chez les Anglo-saxons. Norman Mailer l’explique de façon limpide dans “Les vrais durs ne dansent pas” : « Hemingway avait raison. L’adjectif n’est que l’opinion de l’auteur sur ce qui se passe et rien de plus. Si j’écris : “Un homme très fort entra dans la pièce”, cela signifie seulement qu’il est fort par rapport à moi. À moins de m’être déjà bien fait connaître du lecteur, je risque bien d’être le seul client du bar que la carrure du nouvel arrivant impressionne. Mieux vaut écrire : “Un homme entra. Il portait une canne et, pour je ne sais quelle raison, la brisa brusquement en deux comme une brindille”. Certes, cela est plus long à raconter. Et donc les adjectifs permettent une écriture rapide du genre je vais vous apprendre à vivre, moi. La publicité prospère là-dessus » (p. 200 – 201).
Mes difficultés de forme continuaient, des mots pas bien à leur place : « Samuel a continué, il est loin – étonnamment loin, se dit-elle » (p. 43). C’est une situation tendue, urgente ; et non, on ne se dit pas « étonnamment », dans ce genre de moment. « Le sourire carnassier de Benoît, comme Samuel ne lui avait jamais vu » (p. 65)… je me suis demandé s’il n’allait pas le bouffer, avec un tel sourire.
Et puis l’auteur semblait savoir des choses que j’ignorais, ce qui, en général, ne me dispose pas bien : « Parfois elle a l’impression que des choses aussi ridicules la rendront folle, qu’elles sont aussi importantes et plus perverses encore qu’un mari dont il faut divorcer parce qu’il y a suffisamment de raisons pour ça », mais il ne les dit pas, ces raisons (p. 50-51). Certes, nous les découvrirons, mais tout de même, j’avais la désagréable impression qu’on me trimballait et qu’on ne me parlait pas comme j’aime qu’on me parle.
Bref, ça commençait mal.
Pourtant, de temps en temps, de superbes passages m’émerveillaient, comme ce plein et entier paragraphe d’hésitation, si beau que je le reproduis in extenso : « Elle veut lui dire qu’elle a pris des décisions, que pendant qu’il dormait, elle a réfléchi. Elle voudrait lui dire, mais elle ne sait pas comment ni par quoi commencer. Elle reste un instant face a lui, muette, les mains esquissent peut-être un mouvement. Un sourire s’est dessiné et Samuel a pu voir, dans son regard, comme un espoir, de la joie, mais il n’y croit pas vraiment. Il n’y a aucune raison pour que sa mère vienne vers lui en souriant – il sait qu’elle est capable de trucs étranges, mais là, non, c’est impossible. Sauf que si. Elle sourit. Elle voudrait lui parler. Elle est émue, il le sent, le comprend. Et il l’entend qui lui murmure, Samuel, Samuel, avec une voix qui vient de très loin, un souffle qui remonte d’on ne sait où et puis quelques mots qui viennent, où elle lui parle de confiance. Elle dit quelque chose qu’il ne comprend pas très bien, elle veut lui parler d’une idée, de – non, pas tout de suite, et puis elle attend, elle cherche quelque chose dans son regard à lui, qui ne vient pas. Il est gêné, il baisse les yeux. Et puis, Play. La musique reprend » (p. 53).
Malgré les passages superbes, l’histoire et les personnages me pesaient, aussi. L’adolescent attardé, le fils que Sibylle veut sauver, est insupportable, détestable. Outre ses penchants racistes et bas du front, il ne supporte pas que sa mère soit simplement heureuse, joyeuse (p. 75). Il ne suscite aucune empathie – et on ne sait pas très bien pourquoi il est comme ça – alors j’ai passé une bonne partie du livre à vouloir dire à la pauvre mère : mais laisse-le ! C’est un homme maintenant, c’est peut-être ton fils, mais tu as tout essayé, c’est devenu un con, voilà tout, va courir ta vie tant qu’il en est encore temps et essaie d’être heureuse. Et je pensais, sans oser le lui dire parce que c’était un jugement médiocre : ce jeune homme – je n’ai jamais aimé cette invention occidentale qu’est l’adolescence ; pas qu’il n’y ait pas une phase biologique particulière, non, mais je n’aime pas cette construction culturelle d’un entre-deux qui nous fait accepter des comportements de petits cons – je pensais donc, sans le dire : il n’en vaut pas la peine, il ne vaut pas les souffrances que tu endures pour lui.
Et dès que je bouillais de trop, revenait un superbe passage, de la grande littérature qui m’engageait à continuer, pour cette beauté : « Elle voudrait reprendre ses esprits, retrouver le calme. Ou pouvoir simplement reprendre un à un tous les éléments de la soirée et les remettre chacun à sa place, en faire un beau jardin à la française, bien ordonné, comme si tout pouvait sortir de la confusion, de l’agitation et trouver une place où tout, à la fin, participerait de la même organisation, de la même planification logique et rassurante, comme une cosmogonie tracée, ordonnée simplement, sans efflorescence ni chaos, sans accident ni profusion de rhizomes » (p. 177).
Et, soudain, il sembla que Sibylle m’avait entendu. C’était page 179, enfin, après 179 pages, elle passe une soirée en pensant à elle, à la sensualité, à son corps, sans penser à son idiot de fils.
Alors je me suis demandé : comment peut-on aider quelqu’un quand on ne va pas bien soi-même ?
Sibylle ne lâche pas. Par instinct, par fidélité à son passé, par amour, je ne sais… mais « une fois encore elle sent que quelque chose en elle veut le protéger » (p. 194). C’est en pensant à elle qu’elle finira par réussir.
J’ai ressenti quelque chose de fascinant en lisant ce livre. Pendant plus des trois quarts du livre, je ne l’ai pas aimé, je ne l’ai continué que parce que surgissaient de temps en temps de superbes passages, de magnifiques pages et qu’il m’avait été prêté par une amie bonne lectrice. Mais plus d’une fois, j’ai été tenté de le laisser. Mauvigner a réussi à ce que son livre provoque en moi exactement ce qu’aurait suscité la rencontre avec le fils.
Mais vers la fin, et vers l’homme, fiat lux.
Sibylle avait compris, inconsciemment, qu’aider quand on ne va pas bien est probablement une excellente clé pour aller mieux, aussi, soi-même. Elle aura eu raison. Elle que j’avais tellement voulu mettre en garde et engueuler, elle aura eu raison de croire en l’humanité. De s’accrocher et de ne pas lâcher. Avec son style qui souvent crissait à mes oreilles, avec son humanité totale, il ressemble un peu à la vie, ce petit livre.
Continuer
Laurent Mauvignier
Editions de minuit, 235 p.
2019