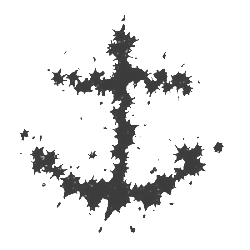De l’espoir en sommeil
L’espoir est un sommeil, une torpeur qui nous éloigne de l’action – coups de poing, coups de cœur, inventions, poésie, construction de bâtiments, et cetera. – et donc nous éloigne de la vie*. L’espoir nait de la rudesse des choses, quand l’être humain peine à modifier l’inertie de son environnement et se résigne, attend ou s’en remet avec confiance à des causes extérieures, parfois déterministes, parfois aléatoires, pour lui dessiner un avenir favorable (en espagnol « esperar » – issu de la même racine latine – signifie aussi « attendre » : les mots cousins utilisés par d’autres peuples éclairent souvent l’inconscient d’une langue). Il espère. Comme un endormissement, c’est un lâcher-prise qui le livre à ses illusions, à ses rêves. C’est au réveil que nous prenons conscience de la puissance des songes, quand nous hésitons entre rêve et réalité ; puis la réalité s’impose, nos sens reprennent le dessus et les constructions de notre cerveau s’évanouissent. L’espoir n’a pas de réveil quotidien qui nous en libère. En faire surface, croyons-nous, c’est renoncer et mourir. Mais cette croyance peut nous tenir toute une vie dans l’illusion et la passivité. Et pourtant, comme le sommeil, l’espoir est aussi une promesse qui nous est vitale. Pour elle nous acceptons de fermer les yeux dans l’obscurité parce que nous pensons, nous savons : demain je serai reposé, demain sera un autre jour où tout sera à nouveau possible. Demain nous réussirons, si faibles que soient nos chances objectives. Sans aucun espoir l’être humain risque de perdre un moteur essentiel, la motivation de refuser le destin, c’est-à-dire de n’être pas une chose. Perdre l’espoir est aussi douloureux qu’une insomnie chronique. Mais trop le nourrir, c’est aussi se condamner à étouffer sa vie en acceptant l’inacceptable au motif que demain, peut-être… Accepter en attendant, en attendant, en attendant, et grossir bêtement, faute d’action. L’espoir est détestable parce qu’il nous neutralise ; il est adorable parce qu’il nous donne la force de nous hisser, face à l’adversité, au zénith des nouveaux jours qui viennent.
* Il y a dans cette équivalence vie – action quelque chose d’essentiel : nous ne sommes que ce que nous faisons, c’est-à-dire que l’être humain n’a pas de nature, d’essence, du fait de notre polyvalence conjuguée à notre instabilité (ce que les sartriens peuvent appeler un être « pour soi »).