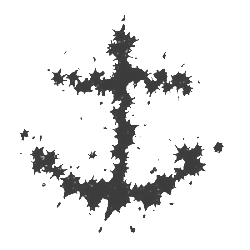Des châteaux qui brûlent
Un livre d’Arno Bertina
– livre portant une dédicace à mon intention, offert par un ami commun habitant près du Golfe du Morbihan – lecture débutée en mer entre Saint-Malo et Jersey, terminée en août 2019 à Ischia –
Séquestration d’un ministre par les employés d’un abattoir sacrifié, raconté par de multiples voix. Celles du pouvoir et celle des ouvriers.
« Il y a des cadavres – qu’on pourrait aller palper, chauds ou froids, mais ce sont que des cadavres, si tu vois c’que j’veux dire, il n’y a pas de guerre. Il y a des cadavres, mais sans guerre, d’accord, sans lutte des classes. C’est les frappes chirurgicales dont ils parlent à la télé, qui ne font pas de morts injustes » (p. 82).
Voilà l’ambiance. C’est toute l’histoire d’une époque qui se joue là. Et c’est d’une haute écriture qu’elle est dite, cette époque. Comme tout, les sentiments et tout le reste, une certaine idée de l’empathie par exemple : « Il a senti comment j’ai frissonné mais il essaie de rester cool. Quand quelqu’un se crispe tout près de toi c’est difficile, et pour moi c’est la beauté de la vie », dit Christiane Le Cléach (p. 110).
Et, surgissant d’entre la littérature, des messages très clairs : « Foutre en l’air tout ça malgré la rentabilité, les voilà les casseurs : c’est les patrons, et les actionnaires qui manipulent ces mêmes patrons. Donc les salariés sont sortis de leurs gonds – faut dire que plus injuste c’était balèze » (p. 178). C’est clair et ça change des écrivains bourgeoisisants.
Ou encore, surgissant toujours, l’espoir d’une autre organisation du travail, les coopératives : « Demain il faudra tout vivre différemment. Dans une coopérative il peut y avoir un semblant de hiérarchie, des postes attribués mais tout le monde est associé, tout le monde doit être concerné de la même façon – c’est-à-dire au maximum – par le sort de la coopérative » (p. 180).
Et voilà que tout est dit : « J’ai entendu cet ouvrier expliquer à peut-être un demi-million d’auditeurs, dont moi, qu’il était possible, légal, de briser les genoux du capitalisme, de mettre un terme à la loi du profit, à la prévalence du bénéfice sur toute question humaine », dit Fatoumata Diarra (p. 180). « La putain d’chemise », à propos de la chemise déchirée du DRH d’Air France (p. 190). Alors je me suis souvenu de ce titre en grand et en noir du journal « Le Parisien » après cet évènement, le 6 octobre 2015, titre d’un abject parti-pris : « Injustifiable ».
 Bertina poursuit sa radiographie des acteurs du conflit social avec la surprenante perception de la vision que pourraient avoir les CRS des manifestants : « Mais l’image d’un guerrier, l’image que tu t’en fais, ceux d’en face ils ont la même. Les CRS nous voient comme des hommes et des femmes qui vont se sacrifier. Nous allons perdre notre paye en faisant grève, nous allons perdre le peu que nous avons. Ils nous voient comme des hommes qui ne dansent pas, qui ne se marrent pas. Donc vous parlez la même langue, les CRS et toi, et tu risques pas de les surprendre » (p. 199).
Bertina poursuit sa radiographie des acteurs du conflit social avec la surprenante perception de la vision que pourraient avoir les CRS des manifestants : « Mais l’image d’un guerrier, l’image que tu t’en fais, ceux d’en face ils ont la même. Les CRS nous voient comme des hommes et des femmes qui vont se sacrifier. Nous allons perdre notre paye en faisant grève, nous allons perdre le peu que nous avons. Ils nous voient comme des hommes qui ne dansent pas, qui ne se marrent pas. Donc vous parlez la même langue, les CRS et toi, et tu risques pas de les surprendre » (p. 199).
Sur les syndicats, aussi sec que pertinent : « Les syndicats détestent ce qui est inhabituel. Les syndicats ne sont pas révolutionnaires, ils sont légalistes. Au bout du compte, les syndicats sont contre les initiatives » (p. 205).
L’auteur ponctue d’ailleurs à plusieurs reprises son récit de données réelles, ce qui ancre sa littérature dans la réalité des injustices : « Au début des années 70, l’écart entre le SMIC et le salaire des grands patrons était de 1 à 30. En 2015 il est de 1 à 240 » (p. 282).
Et sur les médias : « Les médias sont de droite, même quand ils sont à gauche – ils ne pensent pas que la générosité existe, ils croient qu’un groupe est toujours bête et violent » (p. 208). Le début de la phrase, avant le tiret, ça pourrait être un graphe sur un mur des quartiers rupins un jour de manifestation sauvage.
Pascal Montville – le secrétaire d’État, qui vit une sorte de petit syndrome de Stockholm (p. 303 notamment) –, à propos d’une révélation de Fatou : « Il m’a fallu quelques minutes pour mesurer la puissance de ce que venait de dire Fatou, et ensuite je n’ai plus vu que ça ; on croit que certaines formes sont des impératifs inamovibles et un jour on réalise qu’on peut se débrouiller sans un patron, et sans l’actionnaire qui ne produit pas de richesse » (p. 216).
Peut-être, parfois, quelques accents par trop idéalistes, notamment concernant une certaine idée de la gauche : « On reproche l’utopie aux gens de gauche, ils ne seraient pas dans le réel. Ce renversement donne le vertige. La gauche est née de la misère, de la colère. Elle est née dans la tête de gens qui n’avaient plus rien à perdre, qui se brûlaient chaque jour au contact du monde. Elle n’a pas été calculée sur un boulier. Une insurrection c’est une réaction de survie, une métamorphose de la mort en forme de vie ». (p. 217). L’idéalisme est ici, à mon humble avis, de parler de « gens de gauche ». Faut voir qui sont ces gens – c’est-à-dire ce qu’ils font –, et en voyant, souvent, on tombe de haut et on en parle plus.
Je ne me suis senti gentiment bousculé hors du récit qu’à de rares moments, par exemple par les très beaux interludes musicaux, mais dont je me suis demandé s’ils n’étaient pas de trop (p. 327, notamment).
Mais restent les belles images sur la rétine des mots, celles qui plongent le lecteur en l’esprit des narrateurs : « Je retourne près de la machine à café. J’écoute son ronronnement, mais je n’arrive pas à fabriquer le chat mental que je devrais caresser pour me détendre » (p. 219).
D’une certaine façon à une échelle réduite, mais qui pourrait préfigurer l’avenir « la révolution. Ils l’ont faite, je me le répète, ils sont en train de la faire » (p. 220), se rend compte Montville.
Et arrive la confirmation que nous sommes en affinité, avec le Bertina : une citation de La Boétie : « Ce sont des géants parce qu’on est à genoux » (p. 296). C’est comme un code ça. Par n’importe qui peut citer La Boétie.
Et voilà aussi que planent les poules : superbe scène de gallinacés qui volent au-dessus des forces de l’ordre, intuition que les prochains succès sociaux seront faits de fondamentaux des luttes des classes, combinés à de nouvelles créativités (p. 364).
Ouvrons en grand, finalement. Il y a le décalage entre celui qui va voir le monde, Punta Arenas et le Détroit de Magellan, et celui qui consomme le cirque, la Ligue 1 par exemple (p. 377). Cela raisonnait à une idée qui me travaille depuis longtemps : notre époque manque d’épique, et peut-être est-ce précisément là le facteur qui limite nos luttes sociales. Don Quichotte affronte des géants. Et précisément, il « voit des géants parce qu’il est en quête d’un combat qui aura de la gueule ». (p. 295)
Mais « […] il ne faut pas se tromper d’ennemi, il faut rendre la colère intelligente » (p. 371).
Ce livre, par la littérature, y participe avec brio.
Des châteaux qui brûlent
Éditions Verticales, 419 p.
2017