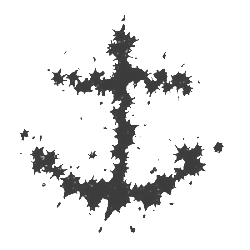Effet de Manche
Lundi 27 mai 2024
11h30, nous quittons Dielette, petit port sur la Manche, nord-ouest du Cotentin. Cap au 300°, vers Alderney – Aurigny en français – la plus proche des îles Anglo-normandes. Une terre anglaise à moins de 25 milles nautiques de la France (1 mille nautique = 1852 mètres ; prononcer « mil » ; à ne pas confondre avec les « miles » étasuniens, qui font environ 1,6 km). Le vent s’annonçait capricieux, pour le moment il n’y en a pas. Nous mettons le moteur. Le vent se lève, mais nous l’avons dans le nez. Ça secoue et nous ne sommes pas encore amarinés. Nous naviguons dans le Passage de la Déroute.
La veille, vu les conditions météo, nous avons encore envisagé d’annuler notre départ. Le matin, lors de la remise du bateau, le loueur s’est marré : « Faut pas trop regarder Météo Consult – un des principaux sites de météo marine – sinon on ne navigue jamais ». C’est le fils du loueur chez qui nous louions des bateaux il y a vingt-cinq ans avec quelques amis. Nous choisissions ce loueur parce qu’il était le moins cher de la côte Atlantique et Manche ; ses bateaux avaient les défauts de ses restrictions : batteries à plat, moteur capricieux, voiles exténuées, sondeurs hors service, compas de route embués, feux de signalisation grillés, annexe à peine flottante… J’espère que le fils a de meilleurs bateaux. En fait, il n’est pas impossible que nous ayons déjà loué celui sur lequel nous nous apprêtons à appareiller, il y a plus d’une vingtaine d’années. Longueur 9m20, 1m80 de tirant d’eau, mis à l’eau en 1986.
Il ressemble à son père, en plus sympathique. Des mains immenses de mec qui passe son temps à tirer sur des bouts et taper sur des trucs en alu. Il nous a proposé de nous rembourser la TVA si nous naviguions hors des eaux européennes. Au retour, notre légèreté à renseigner le journal de bord nous coûtera presque la réduction, faute de données précises, où étions-nous et quand. Mais finalement, il nous la fera.
Parlons donc oseille, puisque nous y sommes et qu’on s’emmerde un peu au moteur. La voile a la réputation d’être un sport de rupin. Sociologiquement, c’est plutôt vrai. Mais économiquement, on peut louer de bons bateaux pour pas trop cher. On dort à bord, on mange des pâtes et on boit des bières éventées, la douloureuse peut être modérée. Avec les années nous nous sommes un peu embourgeoisés, pas tant dans le choix des bateaux que dans le nombre d’équipiers : nous ne partons pas avec n’importe qui. Cette fois, notre élitisme relationnel nous réduit donc à trois pour partager les frais : 1986 euros tout compris (location, transport, nourriture, frais de port, etc.), dont 983 euros de location du bateau (80 remboursés), pour six jours. Soit 633 euros par personne. C’est beaucoup. Mais nous partons en mer, loin de tout, de nos tracas, de nos ombres grises et de nos artefacts, et, surtout, nous allons voir du pays. Nous aurions pu être six et partager davantage, mais je reviendrai sur la tranquillité d’âme que procure un équipage d’intimes. Nous avions proposé à deux amis de se joindre à nous, mais ils ont décliné au prétexte que nous nous étions décidés deux semaines avant le départ. Moi je trouvais ça plutôt bien planifié, cette fois.
Comme toujours avec les locations, on sent le départ prendre forme quand s’égrène l’inventaire du bateau, dont la liste des termes plonge magiquement dans l’univers maritime : règle de Cras, compas pointe sèche, compas de relèvement, compas de route, cisaille à haubans, cônes, almanach côtier, radeau de survie, écoute de spi, plomb de sonde, corne de brume, mouillage, manivelle de winch, génois sur enrouleur, lazy bag, hale-bas de tangon… mais aussi, plus casanier : louche, écumoire, couteaux, fourchettes, bouilloire, mug, bol, passoire.
Retour au Passage de la Déroute. Ça bouge toujours un peu, mais ça reste raisonnable. Pas de mal de mer, Alderney est en vue.
À l’arrivée nous nous amarrons à une bouée, protégés par une grande digue qui date de l’ère victorienne et qui abritait les vaisseaux de ligne qui défendaient ces eaux de la marine française.
L’appel des pubs de l’île ne tarde pas à nous convaincre de gonfler l’annexe, une petite embarcation grise faite de deux grands boudins en caoutchouc. L’exercice est toujours pénible : on commence par manipuler une grande et encombrante forme flasque toujours humide comme une méduse, on finit par battre bêtement du pied sur un gonfleur. Nous voilà sur l’annexe, le vent s’est levé et nous avons du mal à le remonter. Nous suons en pagayant et progressons très lentement. Le clapot nous mouille le cul posé sur les boudins, à fleur d’eau. Le moins expérimenté d’entre-nous, par ailleurs plongeur aguerri, nous dira plus tard que cette petite remontée au vent en annexe aura été le moment où il aura eu le plus peur. Il est bien.
Les pubs ne doivent pas être bien loin… Et bien si. Le bourg ne donne pas sur la mer, il faut marcher vers le centre de l’île. La Guinness n’en sera que meilleure. Je crois que ce que je préfère ce sont les départs et les arrivées. La terre n’est jamais aussi belle qu’abordée par la mer.
Mardi 28 mai 2024
Le petit mauvais temps que nous avons eu hier empire, la météo marine émet un avis de vent frais. C’est un avis de dégradation de la météo, 22 à 27 nœuds de vent (1 nœud = 1nm / heure ~ 1,852 km/h). Cela donne du force 6 sur l’échelle de Beaufort (une échelle de la vitesse du vent, de 0 à 12, de « calme » à « ouragan »). Nous ne sommes pas pressés, nous allons rester dans les jupes de la grande digue victorienne et à l’abri dans les pubs. Nous n’avons pas l’expérience et l’assurance nécessaire pour sortir par avis de vent frais. Nous n’avons pas non plus encore visité tous les débits de boisson de Saint-Anne, un grand village-capitale pour une petite île. Et puis il y a autre chose que nous voulons voir, sur cette île. Quelque chose d’important.
Nous partons faire le tour de l’île. Il pleut tellement que l’eau imbibe ma veste de quart. Au bout d’une heure, je suis plus trempé d’eau de pluie que je ne le serai de tout notre périple d’eau de mer.
Depuis les remparts d’un fort désaffecté, nous observons pendant de longues minutes le Swinge (Passage au Singe), le bras de mer entre Aurigny et l’ilot de Burhou. Les courants y sont très violents, le vent lève une très vilaine mer dont nous voyons les embruns fuir au ras de l’eau. C’est un grand plaisir de marin, ça, regarder le mauvais temps à l’abri et se dire qu’il ne ferait pas bon y être, à la mer.
Nous reprenons notre chemin à travers la lande. Et bientôt, nous approchons.
En 1940, à l’arrivée des Allemands, la Grande-Bretagne évacue l’ensemble de la population. Lorsque les nazis prennent possession de l’île, ils y construisent rapidement un camp de concentration, le Lager Sylt, où sont parqués les travailleurs forcés de l’Organisation Todt qui construisent les fortifications de l’île. Plus tard, un deuxième camp, le Lager Norderney enfermera des juifs « conjoints d’Allemands ». Enfin, il y a eu des réfugiés politiques de la guerre et de la révolution espagnole de 1936 – 1939 contre Franco, livrés par l’État français aux nazis. Environ un millier de prisonniers mourront sur Aurigny. Nous trouvons deux poteaux en béton qui délimitaient l’entrée du camp de Sylt, et une plaque : « These gate posts mark the entrance to the former German concentration camp “SS Lager – Sylt”. Some 400 prisoners died here between march 1942 and june 1944. This plaque was placed by ex-prisoners and their families – 2008 ». Crapules fascistes, ni oubli ni pardon.
Nous rentrons au village. Dans le pub où nous échouons, assoiffés et trempés, nous discutons avec une femme qui déjeune avec sa mère et le compagnon de cette dernière. La femme vit en Australie, mais est native de l’île. L’autre bout du monde, beaucoup de mers à traverser. Si nous devions, nous pourrions y filer, avec notre voilier – il faudrait l’équiper un peu en hauturier. Le bateau promet cette liberté absolue, rarement saisie. Poussé par le seul vent, on peut penser aux antipodes.
Au-dessus du bar, une grande inscription : « Don’t mention the war ». « C’est que le patron est Allemand », nous répond le vieux beau-père de l’Australienne. Les habitants sont très sympathiques, comme souvent sur les îles rudes et peu fréquentées. Ça doit être une adaptation de l’évolution : quand l’environnement et le climat sont rudes, gentillesse et solidarité sont des atouts pour la survie. En ville, on peut être chien.

Nous changeons de crémerie et migrons vers un établissement plus près du port après avoir mangé une improbable paella britannique. Nous nous occupons comme des marins à terre : nous buvons des bières et jouons aux fléchettes dans les pubs.
En rentrant au bateau – comme on rentre à la maison –, après avoir mangé un fish & chips dans une gargote sur le port, nous découvrons qu’il y a un petit semi-rigide piloté par une jeune femme qui assure, pour 9 livres sterling, l’aller-retour entre la terre ferme et notre bateau. Neuf livres pour ne pas se tremper le cul, ça le fait.
Le lendemain, nous partons pour l’Angleterre.
Mercredi 29 mai 2024
Nous sommes trois amis de plus de vingt-cinq ans. Nous avons vécu bien des aventures, parfois mouvementées. Mais à terre. Il faut s’entendre, en mer. Et il est très difficile de savoir à l’avance si ça ira. C’est que les conditions de navigation mettent parfois les hommes et les femmes dans des états particuliers où les codes et façons d’être qui ont cours à terre s’étiolent. Les personnalités s’épanchent, le froid, la fatigue, la peur peuvent bouleverser. Des agressivités, des égoïsmes ou des petits délires peuvent s’imposer et briser les savoir-vivre. Nous trois nous connaissons suffisamment pour croire que ça ira, quoi qu’il arrive. Ça fait un bel équipage.
Entre deux fronts dépressionnaires, nous avons une fenêtre pour filer plein nord, cap sur Weymouth, Angleterre. Depuis des années j’ai envie de traverser la Manche. J’aime les bateaux, la mer et naviguer. Mais je crois que ce que j’aime surtout, ce sont les départs et les arrivées. Je me répète. On se répète souvent en mer. Et c’est pourtant toujours différent. Ces moments où l’on est à l’interface. Découvrir une ville par son port, un pays par la mer, ne ressemble à aucune autre approche. C’est ainsi que j’espère revoir l’Angleterre.
Départ à 7h30, cap au 340. Nous naviguons dans une des régions du monde balayée des plus forts courants marins, qui pulsent les plus grands marnages (différence de hauteur d’eau entre le niveau de pleine mer et le niveau de basse mer – plus de 10 m à Dielette par grandes marées).
Au milieu de la Manche, une famille de dauphins apparaît et joue autour de notre étrave pendant une vingtaine de minutes. Ils virevoltent, sautent, plongent et réapparaissent, je parviens presque à les toucher, allongé à la proue du voilier. Ils semblent vraiment s’amuser et un peu se foutre de nous, gentiment.
Plus tard, d’autres viendront lorsque nous serons au moteur, mais ils ne joueront pas comme à la voile. Je les comprends. Quand on est sur un voilier, on ne met le moteur qu’à contrecœur. Ça fait du bruit, ça pue, ça brûle une énergie fossile très polluante. Et puis on a là-haut, dans le gréement, des voiles qui peuvent faire avancer le bateau à la seule force du vent, sans rien devoir à personne, sans combustion irréversible. Bien plus classe. Mais parfois, c’est compliqué… s’il n’y a pas de vent et qu’on doit rendre un bateau à l’heure, en entrant dans un port et qu’on doit se ranger bien à l’étroit des autres bateaux, ou, parfois, si on s’est laissé aller trop près des cailloux et que le vent ou les courants, ou les deux, ne donnent plus d’aise à la voile. Alors on démarre le bourrin, à regret, mais bien content qu’il soit là et qu’il se mette à tourner en avalant son lourd et puant gasoil. Les dauphins, eux, n’aiment pas.
La bateau file bon train. Sentiment d’appartenir à la nature, de faire corps, d’en être. Le simple fait que l’on remarque ces moments devrait nous inquiéter sur ce que nous avons fait de nos vies. Pourtant, je crois qu’affirmer notre humanité, distincte de la nature, peut être la clé qui fonde notre responsabilité à agir pour inverser les dégâts que nous causons. Nous ne sommes pas une partie parmi d’autres du grand tout. Nous sommes ceux qui excellons à détruire la biodiversité.
Nous croisons la route de cargos, vraquiers, porte-containers, paquebots et ferrys, géants chargés de pales démembrées de monstrueux moulins à vent. Don Quichotte les chargerait. Justement, la Manche, elle est divisée en deux grands rails, un montant, un descendant. Je crois que c’est une des zones du monde où la navigation est la plus dense.
Avec le crépuscule, tout s’aplatit, la profondeur disparaît, les marins n’ont plus que les feux de navigation, rouge à bâbord, vert à tribord, et les radars pour ceux qui en ont, les choses deviennent lignes et points.
Les falaises d’Albion sont proches. L’approche d’un port, c’est retrouver le volume des choses. Ce qui se présentait comme une ligne, peu à peu se déplie et prend forme dans l’espace. Comme si en la retrouvant la terre se rouvrait après nous avoir oubliés. Anacharsis, un philosophe du VIe siècle av. J.-C. a qui on demandait si les vivants étaient plus nombreux que les morts répondit : « Mais d’abord, ceux qui sont sur mer, dans quelle catégorie les rangez-vous ? » (citation attribuée à Platon : « Il y a trois types d’hommes : les vivants, les morts, et ceux qui vont en mer », belle, elle est très probablement apocryphe).
À chaque arrivée dans un port inconnu, nous avançons sur la pointe de la quille, hésitants, et lorsqu’enfin nous accostons le long d’un catway (les pontons flottants qui marbrent les ports de plaisance), nous nous posons toujours la même question : sommes-nous au bon endroit ? Pouvons-nous être là ou allons-nous nous faire virer par quelque prioritaire ?
On s’amarre provisoirement et l’un d’entre nous part se renseigner. Des voisins nous rassurent : « You are safe here ». Les sauveteurs en mer locaux sortent avec leur canot insubmersible, le vent forcit, nous sommes heureux d’être arrivés en Angleterre. Weymouth.
À la capitainerie on nous dit que nous devrons nous déplacer le lendemain matin, ça nous va bien. Nous avons faim, soif et envie de marcher sur la terre ferme. Nous trouvons facilement un fish and chips à emporter, on ne peut faire mieux, c’est ce dont nous avons besoin. Mais le lendemain soir je n’en pourrai déjà plus de tant de friture. C’est le destin de tout français en voyage, vite sa nourriture lui manque.

En débarquant au Royaume-Uni, aucun contrôle d’identité, alors que nous venons de l’Union européenne et que nous n’avons plus d’accord de libre-circulation. Deux hypothèses : l’arrivée des bateaux de plaisance est un angle mort du dispositif de contrôle ou bien la navigation à voile est considérée par les autorités comme un passe-temps de bourgeois, et on peut négliger d’emmerder les bourgeois avec des contrôles. Peut-être les deux hypothèses sont-elles un peu vraies.
Weymouth est une station balnéaire populaire, joyeuse et animée. Les darses du port semblent s’y glisser comme les méandres d’un estuaire perdu en ville.
Notre plaisir d’avoir traversé la Manche ne passe pas. J’en suis simplement fier, et, des mois après, alors que je rédige ces mots en relisant mes notes, l’écriture me fait revivre, heure par heure, mot par mot, ce plaisir et cette fierté. Lorsque j’écris un récit je m’émerveille à chaque fois du pouvoir qu’à l’écriture de faire revivre les émotions d’expériences qui semblaient vouées à disparaitre, comme une sorte d’empathie avec son propre passé – lorsque j’écris des fictions, c’est le pouvoir démiurge de l’imagination qui me fascine. Nous pensons un peu à Guillaume le Conquérant, parti de Normandie pour la dernière invasion réussie de la Grande-Bretagne, en 1066.
Mais nous savons ce qu’est la Manche pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir nos passeports, notre situation, notre voilier. Nous pensons alors aux centaines, aux milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui tentent la traversée sur des trucs qui flottent à peine, risquent leurs vies pour en trouver une meilleure, pourchassés par la police, détestés par les scolopendres de droite et abandonnés par tous les gens sages qui secouent la tête en disant – à regret, feignent-ils – que c’est malheureux, mais qu’on ne peut accueillir toute la misère du monde. Les gens de mer, en général, se comportent mieux et se déroutent quand ils peuvent en sauver. En 2024, plus de 60 réfugiés sont déjà morts en Manche, plus au nord, par noyade ou hypothermie ; et leurs corps bouffés par les crabes viennent s’échouer sur les côtes de France.
Weymouth. Nous regardons le grand pont basculant qui coupe le port en deux retomber lentement, un lourd soleil couchant nous chauffe les épaules.
Jeudi 30 mai 2024
À nouveau, nous décidons de ne pas naviguer et de prolonger un peu le bon temps à Weymouth. Le long des quais du port, les Anglais en famille louent des petits seaux en plastique avec des appâts, ils les plongent et capturent des petits crabes, puis les relâchent. Les bestioles doivent savoir qu’en échange d’une bonne pitance elles n’ont qu’à passer quelques minutes dans un seau avant de retrouver les eaux du port, tellement elles semblent se laisser prendre avec bonhommie. Je me sens en vacances, ne manquent que ma compagne et ma fille en lieu et place de mes deux amis poilus.
La précision des bulletins météo, qui annoncent un avis de grand frais, permet de prendre ce genre de décision : à nouveau un jour à terre. Nous sommes en goguette. Nous sommes en congés, nous ne travaillons pas. Pécheurs, réfugiés, sauveteurs en mer ou équipages d’un cargo, la mer se prend jusqu’à la limite. Les premières fois que j’ai navigué avec des amis, il fallait aller voir la météo affichée sur les portes vitrées des capitaineries. On y voyait quelques vagues dessins avec des fronts froids et chauds, quelques tendances. On pouvait aussi appeler un numéro qui la donnait comme un répondeur, ou l’écouter à la VHF ou encore en grandes ondes, sur Radio France internationale dite par la chaude voix d’Arielle Cassim. Maintenant, tout est à portée de smartphone. C’est une aide, un confort incroyable. Lorsque j’ai commencé à naviguer, les GPS n’étaient pas non plus omniprésents. Il fallait souvent, pour se situer, identifier des amers, prendre des mesures au compas de relèvement, les reporter sous forme de traits sur la carte jusqu’à délimiter un petit triangle où l’on se situait. Exercice laborieux, imprécis. Aujourd’hui, la précision des prévisions météo et les GPS traceurs – des écrans sur lesquels on voit sa position sur fond de carte marine – permettent à des marins de peu d’expérience comme nous de se lancer sereinement à la mer. Mais sans doute aussi y perd-on un peu de sens marin, le nez souvent plongé sur nos écrans pour y voir où l’on se trouve et chercher le bon et le mauvais vent à venir.

L’un d’entre-nous insiste pour visiter le fort qui domine la ville, construit par les Anglais pour se préparer à la guerre contre les Français – il aime les installations militaires, goût aussi paradoxal pour un libertaire comme lui que celui de l’histoire des religions pour un anticlérical comme moi.
Dehors, ça souffle, les drapeaux sont tendus comme des strings. Notre bateau est bien à l’abri au fond du port, juste en face d’un pub, avec d’autres voiliers à couple. C’est beau ce terme, à couple.
En descendant de notre bateau, en quelques pas, nous sommes attablés au pub. Nous commandons un plateau de fruits de mer, fatigués des fritures et séduits par le prix. Quelques crevettes décortiquées, le reste… des croquettes et des rillettes de poisson. La mer force à la différence culturelle. Comme les voyages ? Il y a quelque chose qui se vit en bateau et qu’on ne sent pas tout à fait en débarquant quelque part d’un train, d’un avion ou d’une voiture. L’effort pour y arriver ? Le sentiment de n’être pas comme les autres, c’est qu’on est arrivé par la mer et que c’est un chemin peu courant aujourd’hui ? Le contact avec la nature ? Le risque ? La lenteur ? La certitude qu’on aurait pu ne pas être là si les vents et les courants, ou quelque autre fortune de mer, en avaient décidé autrement ?
Nous sommes en Angleterre. Il y a des panneaux « Aggressive seagulls – Protect your food. Management cannot replace food stolen ». Il s’y vend de la glace pour les chiens.

Adossée à la petite ville, il y a une longue plage. Il fait frais, mais on est en Angleterre, les Anglaises et les Anglais se baignent sans frissonner. Ils ne semblent pas avoir la même peau que les continentaux – bon, ils ont de la marge, ils ne sont pas du niveau des Canadiens qui se baladent par moins cinq en short et en jupe sans collants. Le soir, dans les rues de la ville, nous croisons les incontournables groupes de jeunes femmes ivres et courtes vêtues, jambes et décolletés au vent, qui ne semblent absolument pas souffrir du froid. J’ai cette image des Britanniques en tête depuis la première fois que je les ai vues, à l’adolescence, au cours d’un séjour à Bristol. Avec le temps, elles tiennent une place de choix dans l’image que je me fais de la femme libre – de faire ce qui lui plaît, habillée comme il lui plaît, défiant les hommes et la froidure au besoin.

Vendredi 31 mai 2024
Ça souffle, mais nous devons repartir. On peut aller loin en bateau, mais on n’est rarement aussi libre qu’on l’imagine. Il y a des contraintes, comme à terre, elles sont simplement différentes. Quoique. Il faut rentrer travailler. Il faut rendre une location. Il faut retrouver les siens. Il peut y avoir du mauvais temps. Elle est souvent là, à l’heure de décider, la météo. Nous avons une fenêtre pour retraverser la Manche. Mais dans 48 ou 72 heures, elle se refermera. Le vent redeviendra rude. Quand on décide de passer par ce genre de fenêtres il peut y avoir de sacrés courants d’air. Il n’y a plus d’avis de vent frais, mais ça peut souffler. Ça peut, ou pas.
La météorologie modélise les systèmes atmosphériques, qui sont strictement déterministes, mais soumis à un très grand nombre de facteurs. Et ils sont chaotiques, c’est-à-dire extrêmement sensibles aux conditions initiales. Concrètement, au-delà de quelques jours, impossible de prévoir le temps avec certitude ; et dans certaines circonstances, comme lorsque plusieurs dépressions se suivent, les prévisions peuvent être assez erratiques, en quelques heures les vents peuvent faire le tour de l’horloge.

Cette incertitude perturbe des marins peu aguerris comme nous, mais enfin, il faut y aller. Nous nous lançons donc de bon matin, plein sud, vers le continent.
Le vent est avec nous, allure au portant, souvent plein vent arrière. On avance bien à ces allures, mais ce ne sont pas les plus agréables. Surtout quand la mer n’est pas plate. Ça tangue, la bôme menace de nous assommer ou de nous envoyer par-dessus bord en cas d’empannage (un virement par vent arrière), et si la houle prend par l’arrière elle peut facilement me rendre nauséeux. Nous avançons plus lentement que prévu, nous mettrons presque 15 heures pour retrouver la Normandie. Nous faisons cap sur Cherbourg.
Pendant la traversée, alors que le crépuscule arrive, nous entendons – sans les voir – deux grands bateaux se parler à la VHF. Le premier se présente, avec son bel accent français, comme un ferry, faisant route vers quelque part. Il demande à un bateau – sans doute un cargo – qu’il a identifié avec son AIS (système automatique de transmission de la position des navires) s’il compte changer de cap, parce qu’ils sont sur une route de collision. La passerelle du cargo, très flegmatique, répond que ça ira, en somme. Le ferry insiste, le cargo répond alors « I will do my best ». Nous en avons ri pendant longtemps, imaginant l’officier de quart d’un monstre des mers disant à un ferry qui craignait l’abordage, qu’il allait faire de son mieux.
Alors que nous commençons à voir les côtes, nous entendons un « Pan Pan Pan » sur le canal 16 – le canal de veille sur la VHS. C’est une demande d’assistance en urgence – mais qui n’est pas de la gravité d’un Mayday ou d’un SOS – à tous les navires sur zone : un voilier a perdu sa propulsion. Un voilier avance avec ses voiles, direz-vous. Oui, mais les arrivées au port peuvent être vraiment compliquées sans moteur, de nuit. Une fois, il y a des années, nous avions voulu tenter, alors que nous n’avions plus de moteur. Nous n’avions évité un lamentable échouage, bateau éventré sur le flanc contre les rochers de la digue du fond du port de Trébeurden, que parce que le capitaine du port avait surgi au dernier moment avec un zodiac et nous avait remorqué.
Nous descendons regarder la carte – notre niveau de luxe ne va pas jusqu’à nous avoir doté d’un renvoi d’écran dans le cockpit, à l’extérieur ; pour regarder les cartes, papier ou électroniques, il faut descendre ; mais nous utilisons aussi les cartes sur nos mobiles. Le verdict de nos estimations sur la carte est assez clair : nous sommes trop loin. Nous n’y arriverons pas avant d’autres bateaux qui ont – nous semble-t-il, la VHS est mauvaise – répondu à l’appel d’urgence. De plus, le bateau n’est pas en perdition, il a besoin d’être remorqué ce que nous aurions bien du mal à faire, avec notre voilier. Il n’y a pas de vies en jeu : nous décidons de ne pas y aller. S’il se fut agi d’un appel de Détresse – Mayday Mayday – nous aurions fait cap sur l’appel sans hésiter.

Nous arrivons à Cherbourg de nuit, le port est immense. Nous cherchons notre chemin à travers les digues et les feux. Mais en arrivant dans le bassin où dorment sagement des centaines de voiliers, nous constatons vite qu’il n’y a pas une place sur les pontons. Le port est plein. Nous apercevons le voilier qui était en difficulté, bien amarré, ses occupants doivent être au bar en train de raconter et de trinquer à leur frayeur – les marins aiment bien raconter. Il a dû être remorqué et est arrivé avant nous, nous avons bien fait de ne pas faire route sur lui. Il porte une bannière que nous remarquons bientôt sur de nombreux bateaux : il est venu d’Angleterre pour les commémorations du quatre-vingtième anniversaire du D-Day, le grand débarquement de 1944. Je me rends compte que je vieillis en me sentant obligé de préciser ce qu’est le D-Day.
Comme souvent, je me dis que nous aurions dû nous annoncer à la VHF aux autorités du port, et, comme toujours, probablement que la prochaine fois j’oublierai à nouveau, craignant peut-être inconsciemment qu’elles m’envoient faire escale ailleurs, ce qui est idiot. Partout les bateaux sont à couple, il est tard, rien ne bouge dans le port, nous n’osons pas tenter un amarrage en troisième ou quatrième position, avec la certitude de réveiller l’équipage du bateau que nous choisirions.
Cette réticence est une option facile parce qu’à l’entrée du port nous avons remarqué un ponton étonnamment vide : n’y sont amarrés que quelques épaves et une vingtaine d’Optimists – des petits dériveurs d’apprentissage –, probablement la flotte de l’école de voile locale. Bien qu’une signalétique nous en interdise explicitement l’accès, nous sommes fatigués et certains que nous ne dérangerons personne. Nous nous amarrons. Je regarde nos voiles enroulées et affalées en savourant une petite bière. Il n’y a pas besoin de permis, pour naviguer en voilier. J’aime cette liberté. Elle est possible, je crois, du fait de la complexité de ce gréement que je regarde se balancer lentement dans la pénombre. Il ne passe presque à l’esprit de personne de partir en mer sans savoir – un peu – manier tous ces bouts, filins, écoutes, et voiles.
Juste en face de nous, le Redoutable, grand sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) aménagé en patrimoine guerrier visitable. Notre ponton n’est pas relié à la terre ferme ; aucune importance, nous ne comptions ni écluser les bars de Cherbourg ni prendre une douche, ce soir-là. Nous imaginons nous endormir pour une belle et paisible nuit de sommeil quand le silence est brisé par ce qui bercera notre nuit : « Alexandrie, Alexandra… » et autres tortures disco qu’une sono géante distribue généreusement à tous les invités d’une énorme fête qui se tient dans la Cité de la mer, juste à côté du Redoutable.
Samedi 1er juin 2024
Départ à l’aube. Nous ne pouvons pas rater le passage du Raz Blanchard. Le courant y est si intense que si on ne s’y engageait pas au bon moment, il ne nous laisserait pas passer. Il faut dire aussi que le départ matinal nous soustrait à une éventuelle explication avec les autorités du port. Nous partons sans payer, certes, mais enfin nous ne nous sommes amarrés qu’à un ponton certes interdit, mais isolé. Outre le calme du port, nous n’avons bénéficié d’aucune de ses commodités – électricité, eau douce, douches, toilettes. Et puis nous avons subi du Claude François la moitié de la nuit, ça vaut paiement.
Nous faisons cap plein ouest et ça souffle encore. Je suis tendu, parce que nous arrivons un peu justes pour le passage du Raz. Pour gagner du temps, peut-être nous sommes-nous trop approchés des redoutables rochers qui hérissent l’aplomb du centre de traitement des déchets nucléaires de la Hague.
Cela ne serait probablement pas arrivé aux amis avec qui j’ai appris à naviguer au gré des sorties et des navigations, lentement, pendant des années, jusqu’à me sentir assez en confiance pour y aller avec un autre ami dans le même cas que moi – mais pas encore assez pour naviguer seul. L’apprentissage eut surtout lieu en Bretagne. Avec les courants, le marnage et les cailloux qu’on y rencontre, je me dis que c’est une bonne formation pour naviguer ailleurs dans le monde, là où les côtes sont bien dessinées et les marées faibles. Au fil des années, mon ami et moi nous sommes rendus compte que nous ne progressions plus avec nos amis plus expérimentés ; parce que sur un bateau, même entre gens de bien, s’établit toujours une subtile hiérarchie, qui fait du plus expérimenté le leader (je considère l’autorité, le pouvoir, comme essentiellement nocif, dans la lignée de Louise Michel, qui disait que « tout pouvoir est maudit » ; mais il peut y avoir des leaders, femmes ou hommes qui, par leur expérience, leur charisme, leur sagesse ou leur courage, emmènent d’autres gens vers un but commun ; la différence entre le leader et le chef est l’institutionnalisation, c’est-à-dire la sacralisation de ce dernier ; on peut toujours contester un leader, on doit obéissance au chef). Sur un bateau, les moins expérimentés ont une tendance naturelle à lui laisser l’initiative des décisions, la coordination des manœuvres. Or, pour apprendre, à partir d’un certain moment, il faut prendre la barre. C’est surtout pour ça que nous avons commencé à y aller seuls, juste à deux principiantes. Que soient ici chaleureusement remerciés mes amis Chamo, Tomka, Yann, Gnou – et, j’en profite, dans une autre catégorie, mais après tout c’est aussi un bateau, Alex, avec qui j’ai appris à naviguer en kayak de mer. Vous m’avez appris le peu que je sais sur un bateau. Des bises s’ul’cul à vous!
Remercier les amis ne change rien à la dérive. Nous mettons un peu le moteur, pour sécuriser le passage en remontant le vent que nous avons perdu.
Soudain, pendant une dizaine de minutes, nous sommes chahutés par un fort clapot, une véritable marmite bouillonnante. C’est une mer croisée, irrégulière, casse-allure, gerbeuse. Peut-être passons-nous à l’aplomb d’une zone de hauts fonds, le courant et le vent font le reste pour lever ponctuellement la mer. Elle semble faite de gerbes qui explosent sous l’effet de grenades sous-marines. Nous avons pourtant déjà franchi le Raz. Nous étions déjà passés, il y a quelques années, par un temps étonnamment calme et, plus ou moins par hasard, parfaitement à l’étale (lorsque les courants de marées s’immobilisent, le temps de changer de sens). Cette expérience nous avait laissé une fausse idée de facilité. Cette fois, ce n’est pas la même

Il ne nous est rien arrivé, nous avons été bien secoués par le Raz Blanchard, mais nous sommes passés.
Retour à Dielette, sans casse et sans grosse frayeur. Une fois de plus, la vue de la terre de Normandie qui grandit confirme l’affirmation que m’a faite un jour mon père : la terre n’est jamais aussi belle que vue du pont d’un bateau. Nous rentrons d’Angleterre, nous sommes heureux, nous avons passé du bon temps, nous nous sommes bien entendus, nous repartirons. La prochaine fois, nous aurons créé notre club de voileux libertaires et antifascistes dont nous avons eu l’idée pendant cette nav.