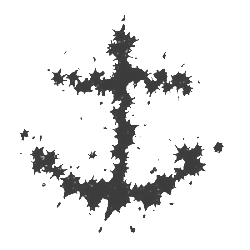L'atelier
Le vieux me tire vers l’entrée de l’atelier. Elle fait face au Riachuelo, petit fleuve noirâtre et endormi qui limite La Boca, quartier par lequel Buenos Aires se souvient de la mer. L’atelier, comme toutes les autres constructions de ce quartier prolétaire, est surélevé de plusieurs marches, pour rester au sec lors des crues du fleuve. Il est en dur, loin des tôles colorées de Caminito et de ses alentours, pourtant à deux pas. En dur, mais périssable : des fissures de toutes tailles montent aux murs comme des lézards pétrifiés qui semblent n’attendre que mon départ pour reprendre leur course d’écartement.
Dès le seuil, l’atelier exhale des effluves de graisse, de cambouis aigre et de métal vrillé, torturé, brûlé, haché ou raboté. Ces odeurs forment un front lourd et compact qui balaie celle d’eau saumâtre du vieux port. Ou peut-être n’est-ce que le changement de lumière qui produit cette impression de contraste ; parce qu’en fait on jurerait que le quartier a toujours senti comme cet atelier. La massive porte entrebâillée laisse entrer un peu de soleil, une timide tache au sol, tandis que deux petites ampoules essaient d’en prendre la relève.
Partout où elles passent, caressent ou effleurent, les mains se couvrent de particules de poussière et de minuscules copeaux d’acier venus se poser par couches sur la graisse des outils, moteurs et autres bizarres objets contondants. Tout paraît hâlé d’un duvet soyeux, velours noir d’un labeur fait de frictions et de plaintes métalliques. Par endroits, le sol semble lui aussi couvert d’une sorte de ras et obscur gazon. Les établis, manches d’outils ou planchettes d’ajustement sont perclus d’huile, gorgés de gras comme de vieilles et dignes prostituées alourdies d’épaisses couches de maquillage protecteur. Le bois ressemble aux arbustes le long des autoroutes urbaines, malingres et rabougris sous leur nappage de suie.
Les murs et le sol sont encombrés d’énormes moteurs engourdis, de bielles éparpillées, de clés anglaises démesurées, de myriades de petits et gros écrous, de chiffons et de câbles dénudés, le cuivre à l’air, d’alignements d’outils sagement rangés sur leurs tableaux et de tours et perceuses qui semblent sortis d’une manufacture du dix-neuvième siècle. Tout ce monde d’acier et de fer en sommeil reçoit la faible lumière des deux lampes qui pendent au plafond, précaires et fatiguées.
Le vieux, droit et élégant avec son foulard rouge noué sous la carotide, promène un regard perçant sur l’atelier de mécanique navale. Sa moustache laisse entrevoir un sourire d’un autre temps ; son visage est marqué de rides, comme un antique parchemin. L’aisance de ses mouvements, son pas assuré, mais aussi la tendresse manifeste qu’il voue à tous ces objets, à ce lieu… À n’en pas douter, cet homme est chez lui.
Puis, comme s’il m’avait laissé le temps de découvrir les premières notes d’une musique inconnue, de m’en imprégner, il lève un bras d’un geste où se mêlent fierté et complicité et me présente ses deux amis : le peintre infidèle et le barbu.
Le peintre infidèle est un grand tableau, un portrait accroché au mur ; ses couleurs ternies paraissent avoir été recouvertes du même satin de cambouis que celui qui tapisse l’atelier ; elles semblent défaites et résignées à ne plus refléter que le silence de l’antre. Il y a des années, commence le vieux, là, à côté, vivait un peintre. Il peignait beaucoup, le bougre, là-bas, juste là, près de la Plaza Solis. Et il trompait sa femme autant qu’il peignait, beaucoup.
 Le mécanicien parle un argentin des quartiers populaires, mêlant à son lunfardo – argot de Buenos Aires – des années cinquante les gaillardes intonations de l’orateur révolutionnaire qu’il a été, aux côtés de mon père. Son accent, malgré les années, balance au rythme d’un autre continent. Europe de l’Est, yiddish peut-être. D’une poche de son impeccable bleu de travail, dépasse un numéro de La Protesta, étendard de ses inaltérables engagements.
Le mécanicien parle un argentin des quartiers populaires, mêlant à son lunfardo – argot de Buenos Aires – des années cinquante les gaillardes intonations de l’orateur révolutionnaire qu’il a été, aux côtés de mon père. Son accent, malgré les années, balance au rythme d’un autre continent. Europe de l’Est, yiddish peut-être. D’une poche de son impeccable bleu de travail, dépasse un numéro de La Protesta, étendard de ses inaltérables engagements.
Un jour que le peintre était sorti, reprend-il, cherchant sans doute l’inspiration dans les bras d’une nouvelle muse généreuse, sa femme, excédée, jeta toutes ses toiles par la fenêtre de leur misérable logis. Puis, après les avoir emmenées une à une vers le centre de la place, elle les brûla toutes. En un immense brasier de conjugale exaspération, le peintre brillait enfin de mille feux, luisait en mille étoiles incandescentes. Tout fut brûlé, excepté un tableau que la femme avait oublié. Ou peut-être voulut-elle désigner le coupable. C’était l’autoportrait du peintre.
Le soir, termina le vieux, je suis passé sur la place et j’ai emporté la toile rescapée du vengeur autodafé. Du peintre, je n’ai jamais rien su d’autre que ce que je viens de te raconter. Le voilà, mon ami le peintre infidèle.
Les yeux posés sur le tableau, je refais la scène. Je revois le brasier sur la place que j’avais traversée en venant, je joins toutes ces années. Aucune question ne vient, ne subsiste que la rondeur de son histoire, petit îlot de vie qui se suffit à lui-même.
Face au peintre infidèle, sur l’autre mur, il y a un vieux barbu. Ils paraissent se tenir compagnie, navrés ou amusés de passer leur retraite dans cet atelier. C’est une grande photographie sépia d’un grand-père d’allure paisible, chauve, et arborant une abondante barbe grise. Peut-être a-t-elle été blanche. Quelque chose le rend si proche, comme si je le connaissais… Il évoque une superposition de toutes les images de vieux sympathiques et bienveillants qui errent dans mon inconscient. L’esprit cherche vainement, poursuit un nom à mettre sur un visage que j’imagine avoir oublié. Mais le familier ancien reste inconnu.
Lui, il m’est très utile, reprend le vieux en interrompant ma contemplation du mural barbu.
À certains, je raconte qu’il s’agit d’un grand-père, d’un parent, ou quoi qu’ils veuillent, s’ils veulent que je leur parle de ma famille. À d’autres je décris le barbu comme une grande figure intellectuelle de l’anarchisme. Aux créanciers, je présente l’oncle qui me tirera du mauvais pas que me vaut leur présence. À une femme je donne son visage à un écrivain, histoire de causer littérature. Ce barbu, c’est une perle, tu comprends ? Tu ne trouves pas qu’il ressemble à tout ça ?
Le vieux barbu accroché à son clou a mille vies, entend chaque fois son histoire, chaque fois différente. Peut-être rit-il sous sa barbe broussailleuse de celle que mon ami raconte aujourd’hui avec l’assurance de son regard bleu comme la haute mer. L’image prend vie et l’espace d’un instant je me demande : qui m’a parlé, le vieux au foulard rouge ou celui accroché au mur ?
Dehors, amarrés aux quais de l’autre côté de la rue, les navires se tiennent tranquilles, ni tout à fait actifs, ni tout à fait abandonnés.
Dehors, un immense pont en ferraille, un quartier d’un autre âge exhalent et raisonnent encore des clameurs des marins et dockers partis depuis longtemps. L’eau noire du fleuve est lourde et assoupie.
Dehors, les bateaux las et les murs fissurés sont les peintres infidèles et les placides barbus d’une ville dont je sais avoir touché le cœur, dans cet atelier.
Cet atelier a réellement existé, cet homme m’y a réellement raconté cette histoire. C’était Carlos Scharf “Puchero”, camarade de mon père, mort le 17 avril 2017. La dernière fois que je l’ai vu, près de son atelier, il a sorti du coffre de sa voiture un exemplaire de Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie, en espagnol, et me l’a offert avec un grand sourire.