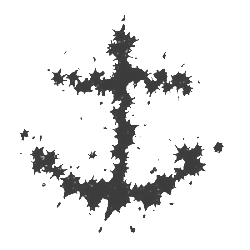Le chant debout
(version 3 – en devenir depuis le premier mai 2014)
Tant que je bougerai, nous serons vivants.
Qu’aurai-je à perdre ?
Le maigre espoir de vivre honnêtement,
À bout de souffle,
À force de travail dont je n’aurais jamais que les pépins amers ?
Mais dont les fruits nous seraient toujours volés.
Le maigre espoir de finir ma vie sans voir le vaste monde.
Je n’étais ni jeune ni vieux.
Je devais me sauver, l’aventure ferait le reste,
Le monde et ses amers.
Je n’avais qu’une poignée de pépins,
Et ce que m’avait laissé mon vieux, la confiance.
Mon dernier jour de pierre, poussant des choses molles dans mon sac, Ultime révision de ma moto,
Ce dernier jour je sus la seule possibilité que je quittai,
L’amour,
Chimie qui ne m’avait jamais sauvé.
Par hasard peut-être, ou maladresse,
Adresse incorrecte, impasse de l’amour.
Je devais me sauver.
Par nécessité, sans doute.
Ou peut-était-ce l’un des espoirs qui me restaient
Un de ceux qui n’avait pas encore fossilisé.
Je ne suis pas une pierre.
Ou pas encore.
Je roulais, des jours et des semaines, des semaines et des jours
Et quelques nuits.
À court d’argent, d’or, de platine, et de toute chose,
Ma moto se fit pierre, à court de liquide.
Je l’abandonnai, c’était en Sibérie.
Alors je marchai, vers le Levant,
À travers des forêts dont chaque arbre me regardait et m’appelait :
Deviens des nôtres !
Dans un village je croisai de métalliques vestiges,
Bustes de chauves barbus,
D’une rouge révolution d’État.
Et quelques vieux nostalgiques d’un temps qui,
Aussi froid qu’il fut, fit la fierté des ouvriers et paysans.
Et, au sortir du village, retrouvant la route qui ne reflétait que mon pouce levé,
J’entendais sous l’asphalte les cris étouffés des goulags oubliés.
On m’aida parfois, on m’ignora aussi.
On m’hébergea, et il arriva que j’eusse à me battre.
On se méfia de moi, et on m’aima, aussi.
En je ne sais quelle langue, dites les yeux plissés, pas encore bridés.
Et il me sembla parfois que c’était le jeune vieux pays sans passé,
Que j’avais parfois rêvé.
Je travaillais dans la forêt et passai l’hiver.
Sans jamais croire les arbres, murmurant que je pouvais rester.
Le soleil continuait à se lever,
Par-delà le Baïkal,
Levant.
Alors, avant que nos odeurs ne s’attachent, Olga, je repartis,
Et te laissai battre le temps,
Au hasard de nos illusions, et chercher ce qui serait ton histoire.
J’étais jeune finalement.
Chanter parce que le chant appelle la danse.
Danser, avec passion, élégance,
Nos passions.
Chanter, danser et oublier nos illusions,
Nous serons inflexibles.
Ni les nuages ni les pleurs,
Pour les rires et la joie,
Pour un chat caché dans l’herbe,
Un enfant qui grimpe aux arbres,
Pour la grâce d’un oiseau,
Ou la beauté de la mer,
Pour un baiser, un amour,
Et les échos de nos millions de voix,
Rien ne nous arrêtera,
Pas même notre propre fin,
La mort n’éblouit pas les yeux des partisans.
Sur les hauteurs d’un canyon ombragé de Crète
Je croisai un village absurde
Vide et blanc,
Abandonné dans les années cinquante.
Les habitants disparus, ne restent que les pierres.
Pour la cloche d’une chèvre morte :
Elle est à moi, non à moi, non, moi, non…
Alors ils se sont entretués, les deux garçons.
Les pères n’ont pas voulu en rester là,
Et sont morts aussi, avec quelques autres.
Ceux qui restaient sont partis, ont abandonné
Et le village, et la vendetta, et quelques animaux,
Au fond de ce canyon, sous mes pas,
En regardant bien, j’ai vu de la bêtise, humaine.
Puis a surgi le cadavre d’une chèvre
À moitié dévoré, dégradé, les côtes à l’air.
Elles tombent parfois des flancs du canyon,
C’est la peine de leur liberté.
Le cadavre n’avait plus de cloche depuis longtemps.
Et il m’a semblé que cette chèvre morte
Avait été l’être le plus intelligent qui vécut jamais.
La vie, sa beauté et ses rires,
Ses joies et ses couleurs,
Et pourtant
Cris dans la nuit, cris dans le jour,
Cris
Fils des douleurs de la vie,
Outrages de l’injustice
Et pourtant,
Et par tous les temps,
Rien n’est plus beau que la vie
Un souffle qui bat une joue,
Le désir qui agite les ailes de l’espoir,
La peau de l’autre que l’on aime,
Le rire du petit qui s’accroche à la grande main,
La fierté du solidaire,
L’audace du créateur,
La foi du découvreur,
Le plaisir d’un repos, d’une naissance, d’une amitié,
De nos amours épars.
Et pourtant, rien n’est plus beau que la vie.
Et c’est bien là, en ce pourtant,
Atavisme de l’humanité,
Que niche l’exigence de justice.
Nous n’existons pas pour souffrir.
S’il le faut, si la physique, la chimie ou le hasard,
Nous l’imposent,
Alors souffrons.
Mais nous le ferons,
En nous battant.
Sans nous laisser aller au fil du courant,
En nous battant, dis-je !
Contre l’adversité.
Alors pourquoi ?
Comment pouvons-nous laisser naître,
Entre les hommes,
Forteresses d’injustice
Et falaises d’autorité ?
Nous aimerions comprendre.
Alors regardons.
L’œil de l’homme qui obéit, qui subit,
Qui acquiesce quand ses maîtres,
Non seulement sont maîtres,
Mais jouissent en leur chair de leur supériorité.
Le premier mystère est là.
Dans l’acceptation.
Il n’y a rien à comprendre, ailleurs,
Pourquoi les hommes s’écrasent, se piétinent, et se dominent.
C’est, dans l’immense et immense majorité,
Des cas connus et inconnus,
C’est de leur intérêt matériel qu’il s’agit,
C’est leur plaisir qu’ils soignent.
Dans les quelques autres cas, quelques-uns, deux trois,
Par-ci par-là,
C’est de leur conception du monde qu’il s’agit,
Et de leur conviction qu’elle mérite
D’être imposée.
Mais dans tous les cas, l’habitude finit,
Sans jamais finir,
Par n’être que la seule raison d’être de la domination,
Encore et encore, en silence.
Mais celui qui subit, obéit et souffre des injustices,
Ne satisfait rien,
Aucune idée, conception, aucun plaisir.
Parfois il arrive qu’une vision légitime la souffrance.
Mais jamais elle ne la cause.
C’est la peur qui parle.
Habitués par la nature à subir la violence,
Des éléments et des ensembles,
Nous avons incorporé, au plus chaud de notre chair,
Qu’à tout moment il en existe un pire,
Et qu’attendre, en baissant le front et pliant le cou,
Est encore le meilleur.
C’est oublier ce qui nous fait humain.
C’est oublier que c’est contre l’adversité,
Contre la gravité pour l’enfant qui veut marcher,
Contre le vide de la vallée sur laquelle l’ingénieur lance son pont, Contre le temps pour le père qui conduit son fils à l’hôpital,
C’est oublier que c’est l’adversité qui nous fait humain.
C’est de nous tenir debout, qui nous fait humain.
Droits.
Imaginer et marcher vers l’idée,
Impie,
Que ce pourrait être différent.
Que l’inéluctable ne l’est pas.
S’il arrive que nous en croisions,
De l’inéluctable,
Alors c’est de physique ou de chimie qu’il s’agit.
Jamais des relations humaines.
Rien de ce qui est humain n’est inéluctable.
Tout bouge, hommes tectoniques.
Aucune nature humaine n’existe ailleurs qu’en nos esprits.
Dans une ville, un village, une maison, une chambre
Dans une usine, un bureau, un chantier, un camion, une mine,
Des hommes et des femmes,
Des hommes et des femmes et des enfants souffrent.
Dans cent, mille villes, maisons, bureaux, chantiers et camions, Mille, dix, cent millions souffrent
D’un travail qui les ronge, qu’ils en aient ou non,
De pauvres qu’ils sont,
De soins utopiques,
D’électricité qui se tait,
De solitude honteuse,
Des millions et des milliards souffrent,
Et emplissent le monde d’une acre odeur.
Qui ne sent pas cette odeur,
Qui ne voit pas la vive couleur du malheur,
Qui n’en est pas,
Que celui-là ait honte et cesse sa lecture.
Voir et sentir l’autre est ce qui nous fait humain.
Dans les mêmes villes, villages, maisons ou bureaux,
Et dans quelques autres,
D’autres hommes, femmes et enfants profitent,
De la souffrance.