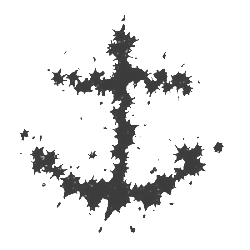Le réverbère
Il y a quelques années je suis parti en Patagonie. Voici comment s’est décidé ce voyage.
Juste en face de chez moi, à hauteur de la fenêtre de mon appartement, il y avait un réverbère. Il commençait par être noir, puis, à partir de là où les chiens ne peuvent plus pisser, même les gros, il montait d’une sombre couleur indéfinie, urbaine. Son épaisseur diminuait, gagnant en finesse, et, peu avant son sommet naissait une branche, une gracieuse courbe ; quand on le regardait d’en bas, du trottoir, la grâce de cette courbe se devinait à peine. Sa longue et mince silhouette finissait penchée au-dessus de la rue qu’il éclairait, le soir. À l’extrémité de cette courbe pendait le massif boîtier sphérique qui abritait son ampoule cyclopéenne, protégée par une vitre bombée.
Il s’allumait à la tombée du soleil. Pendant la journée, je ne le remarquais presque pas. Personne ne le remarquait, sauf les chiens. C’était une grande ville, et il y en a tout de même beaucoup, des réverbères anonymes. Ce qui, parfois, le distinguait du paysage urbain était son exceptionnelle hauteur, rapportée à son épaisseur. Lorsque le soleil disparaissait et que je regardais par la fenêtre, le lampadaire était là. Chaque soir depuis que nous nous croisions, je le toisais d’un œil méchant, l’accusant de me gâcher l’obscurité. J’aurais aimé pouvoir regarder les étoiles, me laisser aller à un coup de lune. L’obscurité ne se gâche pas, les astronomes ont raison… Las, le réverbère est là, invariablement fidèle à son poste. Il se tient en sa grotte de lumière, cloîtré en son nid de photons obéissants.
Un soir, n’y tenant plus, ne contenant plus mon animosité, j’ouvrais la fenêtre et le hélais, poliment, pour commencer.
« Réverbère, ne pourrais-tu pas taire ton incandescence ? » Bien sûr, je n’attendais aucune réponse. D’ailleurs, il convient de préciser que je ne souffrais d’aucun symptôme de dérangement ou d’instabilité mentale. Je n’avais rien bu et je ne consomme jamais quelque sorte de psychotrope que ce soit.
« L’intermittence, tu connais ? »
Silence, bien sûr.
Je sais ce que vous pensez : il est fou, il parle aux réverbères.
J’expliquais au réverbère : « Puisque ta fonction est d’éclairer les passants et véhicules, ne pourrais-tu pas ne t’allumer que lorsque quelque mouvement se présenterait ? Je pourrais apporter de nombreux arguments plaidant en faveur de ma requête, mais, ne doutant pas de ta clairvoyance, ton essence, je ne t’assommerai point de rhétorique. »
J’imaginais ses réponses, pour placer les miennes.
« Et à quoi travailles-tu, d’ailleurs ? » finis-je par lancer au lampadaire, m’ébrouant brusquement. La question s’était imposée. De celles qui, lorsqu’elles ont germé, doivent impérativement sortir, comme germent les pommes de terre oubliées.
« Ne vois-tu pas que la rue est vide !? ». Ma réponse avait fusé comme ça, évidente.
Le lampadaire ne daigna pas répondre.
« Il n’y a personne ! Personne n’a besoin de ta lumière ! »
Je continuais en lui répétant qu’il n’y avait personne, rien, pas même un animal. Que si bien tout le monde avait besoin de lumière, il n’y avait en ce moment personne qui profitait de la sienne, et, au contraire, que je soufrais de cette lumière parce que ce soir, oui précisément ce soir, j’avais envie, besoin, envie et besoin c’est ça, besoin et envie de voir le ciel noir. Je continuais ainsi jusqu’à épuiser mes arguments et en venir à les répéter sous des formes différentes. Les arguments sont comme ça : quand ils sont épuisés, il suffit de les dire autrement pour qu’ils semblent retrouver une jeunesse. Et c’est important la jeunesse des arguments. Je pensais à tout ça en continuant à invectiver le réverbère ; je parlais des arguments tout en continuant de penser au réverbère.
Jeunesse artificielle, bien sûr, simplement rincée de leurs scories. Si tous les arguments du monde étaient lavés de leurs répétitions, il n’en resterait sans doute qu’une poignée d’essentiels. Peut-être forment-ils une langue, celle des arguments premiers. L’espace vectoriel primitif du sens. Ceux que l’on ne peut réduire, ceux que l’on ne peut confondre, les briques élémentaires de la conviction. Peut-être en utilisant un tel idiome parviendrions-nous à mieux communiquer, débarrassés des fioritures argumentaires dont nous sommes si friands. Communiquer, juste ça. Pour partager, le superflu est nécessaire. Mais pour communiquer, l’idiome des arguments essentiels serait bien pratique. « J’ai envie de voir le noir, tu n’es pas obligé d’éclairer inutilement, donc éteins toi ». Syllogisme primordial, argumentaire débarrassé de courtoisie.
« Hein ? Qu’en penses-tu, réverbère ? ».
Le réverbère ne répondait toujours rien. Il était pourtant bien là, alerte, peut-être même intéressé. Ça, c’était ma vanité que de le croire. Après plusieurs instants pendant lesquels je l’avais fixé avec insistance, une voix métallique résonna : « Tu vois, je t’éclaire et tu finis par laisser poindre quelques bonnes idées, par hasard sans doute, et il m’a fallu attendre… »
Ahuri et incrédule, je ne parvenais à lancer qu’un piteux : « Des quoi ? ».
« Je parle à un réverbère », pensai-je. Je baissais la tête, parcourus la rue toujours aussi vide. La lumière faisait des ombres, des dizaines d’ombres improbables de voitures garées, de petits trottoirs, de murets discrets et de grands édifices. Le réverbère continuait à faire de l’ombre. Improbable, parce que la nuit, il ne doit pas y avoir d’ombre.
La voix mal assurée, je tentais de reprendre le dessus, l’air de rien, ou le moins possible : « Écoute, très bien. Je suis éclairé. Éteins-toi maintenant ». J’étais visiblement loin de la candide question que j’avais avancée au réverbère, le « qu’en penses-tu ? » presque cordial par lequel j’avais eu l’impression de m’approcher, de nouer un peu, un dialogue ou quelque chose comme ça, comme une belle couenne blanche. Un peu de superflu. Mais j’en étais très loin.
Lui paraissait s’être adouci et, d’irascible – je l’avais, à tort, supposé tel – il ne conservait plus que son air fin et strict.
« Tu vois, commença-t-il doucement, la lumière, lorsqu’elle arrive, vous l’oubliez… »
Silence.
Le réverbère reprit : « Débarrassé des politesses et des arguments resservis sous des formes différentes, je trouve, moi, vraiment, que tu fais d’étonnants progrès ce soir ».
J’eus un imperceptible mouvement de retrait. Non. Non, je n’irai pas me coucher. Pas maintenant. Non, je ne le laisserai pas tranquille. Ma pensée suivante fut : n’avais-je pas une hache ? Où ai-je donc pu la mettre ? Droite, gauche, biais, morceaux après morceaux, copeaux de métal éclatés jusqu’aux fils électriques que je finirai pas arracher avec les dents, et au diable le courant… je voyais le lampadaire abattu s’écraser sur la route en lâchant un miteux dernier râle. L’ai-je encore, cette hache ? Un réverbère qui parle, il me fallait agir.
Mais il continua : « Comme éclaireur public, j’en vois de drôles, tu sais… Des amoureux qui changent de trottoir juste pour jouir de leur impulsion commune ; des hommes pressés portant des cravates mal nouées – ou, pire, perpétuellement nouées – préoccupés d’importance ; des bébés dans des poussettes, ne bougeant que leurs yeux rapides ; des éboueurs las, des policiers qui roulent à contresens pour s’approcher d’un jeune, toujours dangereux le jeune ; des chiens lunatiques et des vieilles femmes qui, à peine sorties de chez elles en oublient pourquoi elles sortaient. Je vois parfois des hommes qui pensent encore à Francisco Ascaso ou à Antonio Soto.
Des amoureux, j’entends comme ils se répètent qu’ils s’aiment, que jamais ils n’aimeront que lui, qu’elle, c’est selon. Je les entends se promettre, toujours, et chaque fois, tout et davantage encore. Je les vois répéter leurs arguments, en varier la forme comme s’ils les passaient à travers un énorme cristal à mille facettes, je les vois s’aimer et donc répéter. Comme lorsque vous mangez – ça aussi je le vois par vos fenêtres – vous répétez parce que c’est le seul moyen que vous avez d’apprivoiser le temps. Alors mes amoureux répètent leur « je t’aime », presque chaque fois qu’ils passent sous moi ; parce qu’il ne doit y avoir rien d’autre, finalement.
Des hommes pressés aux cravates mal nouées je sens le pas rapide, j’entends presque leurs pensées, celles d’avant-travail, celles qui oscillent entre le très concret et le transcendant, lorsque, le matin, les yeux vous pèsent encore. D’ailleurs, sais-tu pourquoi vous n’avez pas un mot pour de telles pensées ? Moi, je trouve que vous devriez en inventer un. Nous avons tous des pensées d’avant-travail. Ces choses devraient avoir un nom, un mot. Ces hommes qui marchent vite, pressés comme si quelque féroce et monstrueux hérisson les poursuivait, ces hommes et leurs pensées, préparent souvent leurs politesses. Ils ne savent pas comment dire à leur collègue qu’il a mauvaise haleine ; ils aimeraient savoir demander à tel autre chef de cesser de se curer le nez et d’ensuite se débarrasser de ses sales trouvailles sur le sol par un discret frottement pouce-index ; ils aimeraient sentir venir les arguments. Et quand ils sentent qu’ils viennent, alors je les entends les préparer, les chuchoter, imaginer et jouer les situations comme de jeunes premiers ; aux bellâtres des bureaux, répétitions dans la rue. Toujours je les entends jouer leurs arguments, sous toutes les formes et pour tous les motifs. Finalement, ils font un peu comme les amoureux : ils répètent sans cesse les mêmes choses, et leur temps passe ainsi. La différence est, je le vois à leur allure, à leur rythme, à la densité de leur peau, à leur odeur, à la forme de leurs visages, la différence est qu’ils ne sont en rien obligés de faire ce qu’ils font. À l’inverse des amoureux, sur qui pèse l’impératif.
Je t’entends, toi, penser à elle qui est là-bas… si fort que parfois je n’entends même plus les oiseaux.
Des enfants dans leurs poussettes je vois les années à venir. Je vois tout ce qui les attend et la joie essentielle, animale, d’en être plutôt au début qu’à la fin. Puisque leurs mains sont toujours engoncées dans d’innommables corsets roses ou bleus, ils bougent les yeux. Quand passent les éboueurs, les bébés dans leurs poussettes tournent les yeux, fixent le camion vert. Ils essaient de faire le point sur le camion. Le camion bouge, clignote. Et les éboueurs sont las.
J’ai connu une petite fille qui se levait exprès, le matin, très tôt, pour les voir passer. Elle était fascinée. Fascinée par vos déchets. Toute la semaine, toute l’année des milliers de tonnes, ramassées par des hommes las. Comment ne seraient-ils pas las ? S’occuper de vos déchets ne se fait pas sans risque. Ça travaille. Je les vois, les éboueurs, ils ont quelque chose sur le visage. Une expression. Comme s’ils avaient vu ce qu’il ne fallait pas voir. Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Ils ont vu, ils voient, ils portent, ils sentent et se brisent la santé sur vos déchets, naufragés sur les récifs en plastique bleu de votre dérisoire consumérisme. Nul besoin d’arguments, juste le cerveau reptilien qui sait le malheur d’être charognard en service commandé, spectateur méprisé d’un peuple qui consomme beaucoup, vit longtemps et peu.
Je vous vois tous. Vos policiers sécurisants, traquant les « incivilités » pour dresser les gueux ; vos vieux abandonnés, qui souffrent plus de vos oublis que des leurs. Et je vous vois jusqu’à l’os, rien ne m’échappe. De vos policiers je vois l’abrutissement de l’ordre sécuritaire, de vos vieux je perçois les regrets tardifs qu’ils ont, maintenant qu’ils arrivent au bout, seuls, d’avoir fait le monde qu’ils ont fait. Et qu’aucune quantité de policiers ne rendra plus vivable et que vos idiotes religions rendent pire encore. Monde sur lequel vous tolérez les pires injustices au nom de la propriété. Monde que vous avez éviscéré de vos utopies.
Je vous vois bouillir silencieusement, frémir plutôt, oscillant entre le dérisoire de la cravate, les regrets annoncés des futures petites vieilles, les révolutions en gestation que portent vos bébés, et les lèvres incertaines des amoureux. »
Le lampadaire s’était arrêté brusquement, sa lumière paraissait maintenant plus jaune. Peut-être vacillait-elle un peu. Il ajouta, après un silence, et presque inaudible : « J’aimerais bouger parfois, et simplement aller voir ailleurs, loin. »
Je ne voyais plus rien, le réverbère m’avait aplati. Je me sentais déborder de sensations confuses et silencieuses. La lumière continuait, mais j’attendais, je ne pouvais qu’attendre, sûr de passer outre…
Rien ne se passait.
« Tu veux fuir ? » finis-je par lâcher presque en murmurant.
« Non, simplement voir le monde. »
« Tout ce que tu racontes est… confus, et pourtant ta conclusion semble si claire. »
« Je ne suis qu’un lampadaire. Mais puisque le monde se refuse à moi, j’aimerais l’aller chercher. Sans doute en d’autres temps, en d’autres circonstances n’aurais-je pas souhaité cela. Mais c’est un détail finalement. Le plus souvent, nous répétons, faisons sous des formes différentes, les mêmes choses. L’ère n’est pas à ma lumière, pour l’instant. Je dois attendre. »
Il ne bougeait plus ; le vent s’était pourtant levé, une brise de nuit. Mais il me sembla que le lampadaire s’était durci et qu’il pleurait.
J’attendais, silencieux, je ne pouvais qu’attendre, sûr de passer outre.
Mais il n’en fut pas ainsi.
« Ailleurs, loin, c’est en Patagonie ». Je ne sais plus qui de lui ou de moi prononça ces mots.
Cinglé direz-vous. Je ne crois pas. Mystique alors. Certainement pas. Simplement je suis devenu ami d’un lampadaire qui m’apporta beaucoup, et que je délivrais de son immobilité. C’est peut-être le nom d’Antonio Soto, cet homme dont le lampadaire avait convoqué le souvenir qui nous a menés à la Patagonie. C’est venu comme ça, l’air de rien, en parlant avec lui ce soir-là et quelques autres. Et je ne suis pas passé outre. C’est ainsi que se décida mon départ, notre départ, puisqu’à sa demande je dévissai son ampoule et l’emmenai avec moi. Nous partions enfin voir le monde.