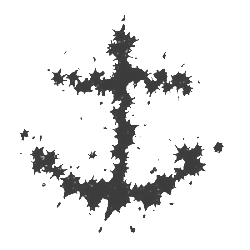Les murs de la critique
Samedi dernier a eu lieu une rencontre dont le thème était:
« Quels sont les murs auxquels se heurte la critique intellectuelle ou militante et qui minent les possibilités de naissance d’un salutaire mouvement de masse ? »
Les organisateurs proposaient en particulier de s’appuyer sur un livre de Jean-Marc Royer, « Le monde comme projet Manhattan »
http://www.autrefutur.net/A-propos-de-l-ouvrage-Le-monde-comme-projet-Manhattan
Comme je n’étais pas certain de pouvoir participer, j’avais noté quelques idées que cette thématique m’inspirait. Comme j’ai finalement pu y aller, voici ces notes, peu travaillées, et augmentées de quelques autres prises pendant la réunion.
Préambule
La question évoque implicitement deux faits: d’abord, que la critique du capitalisme et des mécaniques de domination se heurte actuellement à « des murs », après des dizaines d’années de développement fertile (deuxième moitié du XIXe et début du XXe siècle) ; ensuite, que cet empêchement réduit ou grève les possibilités de développement d’un mouvement social d’ampleur. Ces deux constats me semblent valides. Le premier, parce que je ne perçois en France rien de nouveau ou de percutant dans l’ordre de la critique (il y des choses, comme le livre de Royer par exemple. Mais encore rien qui s’adresse à tout le monde, prenne de l’ampleur en termes d’audience et cristallise à travers ou sous la forme d’organisations pérennes – je reviendrai un autre jour sur la question de l’organisation, qui me semble encore ce qu’on a trouvé de plus efficace); le second, parce que je crois qu’il faut des idées claires pour se mettre collectivement en mouvement et que cela ne me semble absolument pas être le cas.
Maintenant, à la maçonnerie. Parlons murs.
1/ Quelle critique ?
Nous parlons de critiques du capitalisme et des mécanismes de domination d’une minorité de la population sur une majorité qui provoque des inégalités toujours croissantes, des injustices, des catastrophes écologiques et d’immenses souffrances et de nombreux morts qui auraient pu être évités.
Mais trop souvent il est difficile de discerner si une « théorie », une recherche, relève de la science ou du militantisme. Or cette distinction est essentielle. La science s’astreint à l’objectivité et ne dit rien sur l’éthique. Elle met au jour des processus et des logiques. La critique militante, elle, devrait poursuivre des buts précis: stratégies et perspectives ; quoi qu’il en soit, une chose la sépare de la science : elle doit assumer son engagement. Les objectifs d’une critique du capitalisme ne sont pas scientifiques, mais militants. Bien sûr, la critique militante peut s’appuyer sur des constats de la science. Mais il n’y a là aucun lien évident. Il n’est pas nécessaire d’avoir une fine compréhension de tous les mécanismes du capitalisme pour en établir une critique. Analogie : il n’est pas nécessaire de connaître le détail du fonctionnement d’un revolver pour faire une analyse pertinente de sa dangerosité. Si l’objectif est essentiellement militant, alors nous devrions être davantage dans le registre de l’éthique que dans celui de la science (on pourra parfois aussi se demander si tant de temps et d’énergie passés à analyser le capitalisme n’est pas, aussi, du travail gratis pour les capitalistes). Des générations de militants ont cru et continuent de croire qu’en expliquant les détails et les dessous de l’exploitation capitaliste les gens seront convaincus de la pertinence et de la nécessité de se révolter. Je ne crois pas – l’ayant moi-même beaucoup pratiqué – que cela marche comme ça.
2/ Des théories critiques, pour quoi faire ?
Une théorie critique ou révolutionnaire ne déclenche rien. Il me semble qu’elle sert essentiellement à quatre choses : mobiliser, donner du sens à une révolte, définir des stratégies et des tactiques, et définir les perspectives, les buts vers lesquelles aller. L’autre futur que nous voulons. Par le passé, et encore aujourd’hui pour bien des groupes et tendances, la théorie critique sert aussi à dire ce que l’on est ; cela constitue donc souvent, consciemment ou non, un excluant de ceux qui n’adhèrent pas parfaitement au placement de toutes les virgules.
Les deux premiers rôles que j’ai évoqués pour une théorie critique sont qu’elle peut mobiliser et donner du sens. C’est là le lien entre cette abstraction et la réalité. Elle pourra y parvenir si elle contient et donc apporte une certaine transcendance. Une transcendance rationnelle et non mystique (par exemple : affirmer que nous pensons possible et souhaitable un autre mode d’organisation politique et économique est une forme de « croyance » non mystique et rationnelle – rationnel au sens où cela s’apparente à un pari). La théorie est ce qui donne sens à une révolte, ce qui place dans un tout cohérent un sentiment initialement individuel. Mais ce qui permet de sauter le pas de l’action collective – dans un objectif d’émancipation –, c’est-à-dire d’agir au-delà de soi, de l’individualité, ne peut être seulement rationnel. Ni un espoir bien calculé d’amélioration des conditions morales et matérielles des travailleurs, comme disent les syndicalistes. Ce qui permet cet élan est nécessairement une sorte de transcendance. « Les arguments rationnels ne suffisent pas », disait Royer lors la rencontre. « Il faut que nous ayons un espoir à offrir plus séduisant que ce qu’offre capitalisme », disais-je il y a déjà plus de quinze ans. Une parole qui peut mobiliser, mais surtout unir, au-delà des intérêts individuels. Historiquement le socialisme a adopté en guise de transcendance, l’égalité et quelques autres principes universels (George Orwell a identifié que la « mystique » du socialisme était l’égalité ; par principes universels je me réfère à des principes valables de tout temps, en tout lieu, pour tout le monde. Exemples : la croyance ou conviction que nous pouvons faire un monde meilleur ; l’impératif du respect absolu de l’intégrité physique des individus ; l’égalité en droits de tous les êtres humains ; l’émancipation des oppressions ; l’objectif de mettre fin au salariat ; considérer l’utilité sociale comme critère pour juger de la pertinence d’une activité ; le refus de tout racisme ou sexisme, etc.). Je ne vois aucune raison de renoncer à cette sorte de transcendance, ce qui implique donc de penser autour d’une colonne vertébrale de principes universels à ressusciter ou inventer. L’objectif est de dépasser les subjectivités individuelles, mais aussi identitaires, de genre, d’origine, alimentaires, etc. pour un engagement unitaire, essentiellement tourné contre le capitalisme. Unifier au lieu de jouer le jeu des capitalistes qui sont enchantés de l’éclatement de la critique, de la dispersion des luttes. Cela ne signifie pas abandonner ces axes ; cela signifie reconnaître leur caractère secondaire dans la bataille contre le capitalisme (je ne dis pas que tout le monde doit cesser ces luttes « secondaires » et rejoindre cette lutte que je qualifie de « principale ». Je dis simplement que ceux qui identifient le capitalisme comme la forme d’oppression la plus importante tournent ses forces à le combattre sans s’éparpiller).
Et ainsi, en unifiant au maximum, passer progressivement du « tout se passe comme si » d’une coquette analyse sociologique ou historique au « nous » le plus large possible. Cet engagement collectif est lui aussi une subjectivité, puisque tout le monde ne sera pas convaincu ni engagé. La question se pose alors : quels contours pour cette subjectivité ? Je pense qu’il devrait s’agir du plus petit dénominateur commun à tous ceux et celles qui sont exploités par le capitalisme, c’est-à-dire précisément la condition d’exploité en capitalisme, le rapport de classe (cela ne signifie bien sûr pas que ceux qui ne sont pas directement exploités par le capitalisme – gens qui ont fait le choix de se mettre en marge, artisans, profession libérales – ou exploités, mais qui s’en sortent bien ne puissent pas décider de se joindre à cette subjectivité (je développerai un autre jour pourquoi je pense que le rapport de classe est plus que jamais d’actualité ; mais de façon laconique : parce que c’est là que nous pouvons faire le plus mal au capitalisme).
3/ Des théories critiques : faites de quel bois ? Assemblées comment ?
Nous avons vu qu’elles devraient avoir pour but de dégager des stratégies et des objectifs. Je pense donc qu’un pan essentiel de la pensée critique devrait être la conception de projets de société. Ce travail a le potentiel de transcendance, de mobilisation (cf. la façon dont le municipalisme libertaire participe à mobiliser les Kurdes ; cf. également combien le projet de communisme libertaire adopté par la CNT en Espagne en mai 1936 a été mobilisateur : il permettait à tout le monde de faire cesser les élucubrations et analyses théoriques à n’en plus finir et de poser sur la table un sonore « voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous allons faire ») et ils doivent s’appuyer sur les travaux scientifiques d’analyse du capitalisme (afin de concevoir des systèmes qui désamorcent les logiques qu’exploite et amplifie le capitalisme).
Toute pensée politique devrait graver dans le marbre de sa propre conception l’idée de l’humble confrontation avec la réalité. Les théâtres de telles confrontations fertiles avec le capitalisme ne manquent pas : luttes syndicales, sociales, ZADs, etc. Humble ? Parce ce que la réalité commande. J’ai par exemple expérimenté l’organisation syndicale révolutionnaire intransigeante avec certains de ses principes : ça ne marche pas. Il est nécessaire d’avoir une forte et lucide interaction entre pratiques et théorie.
Théorie ? J’ai constaté au cours de mes années de lecture de textes politiques deux travers souvent rédhibitoires : le manque de rigueur et l’utilisation de jargons (chacun le sien, c’est comme l’argot : celui des psychanalystes, des philosophes, des sociologues, des militants de telle ou telle obédience, etc.). Ici encore, ces jargons servent à inclure – ceux qui le maîtrisent – et exclure les autres. Si l’on aspire à ce que nos théories parlent à nos semblables, alors il faut être précis, rigoureux et éviter l’utilisation de jargon.
Le jargon est aussi souvent le signe d’une pensée politique faible et confuse. Bien des pensées « postmodernes » ont sombré dans ce travers, ce qui était cohérent avec leur manie de la déconstruction, de la relativisation de la mise en cause de la vérité comme objet primordial du savoir (par vérité je n’entends bien sûr pas une idée de vérité absolue, platonicienne ; j’entends l’établissement de vérités dans le cadre de notre pensée et de notre rapport au monde, perfectible bien sûr, la plus cohérente possible et indépendante des points de vue). Est-il besoin de le rappeler ? Il existe des vérités qui ne sont pas le fruit de conventions, pratiques culturelles, ou coutumes instables (comme l’évoque Miguel Amoros dans ce texte :
http://lemoinebleu.blogspot.fr/2018/02/miguel-amoros-critique-de-la.html)
. Une critique fertile devrait à mon avis se bâtir sur des bases rationnelles, c’est-à-dire en cherchant des vérités ou en faisant des paris, mais sans relativiser et contextualiser, et en assumant les limites de notre connaissance et de la puissance de l’action humaine. C’est de là que s’ouvriront les voies de l’universalisme. Si nous échouons à toucher à l’universalisme, nous nous offrirons au relativisme dont raffole le marché. D’ailleurs, si les pensées critiques « postmodernes » se sont avérées si inoffensives – comparé au socialisme universaliste des débuts – on peut se demander si la raison n’en est pas, justement, l’obsession de la déconstruction et du relativisme qui s’emboîte si bien avec l’essence du capitalisme, système dans lequel tout se vaut, selon l’angle, selon la devise – parce que finalement tout finit par se compter.
Il me semble également que l’exigence de rigueur devrait mener à la prise en compte dans toute critique du capitalisme de l’aléa. Le cours des évènements historiques est déterministe (suite de causes et de conséquences) mais non prévisible. Prendre en compte l’importance du hasard de certaines conjonctions historiques, de l’aléa pourrait par exemple permettre de définir des stratégies d’influence du cours des évènements, ou de préparation à de futurs évènements probables. Prendre en compte les aléas présente aussi l’avantage de nous rendre humbles concernant nos analyses critiques.
Le fait que l’histoire soit déterministe ne signifie pas que nous puissions en établir un modèle exact. C’est d’ailleurs l’écueil contre lequel butent vainement les économistes capitalistes : ils tentent d’établir des modèles déductifs et prédictifs (inspirés des sciences exactes) sans jamais y parvenir. Parce que la complexité du monde est trop grande, et surtout parce que les décisions des humains ne sont pas modélisables, la tâche est impossible. En cela, comme le dit Jean-Marc Royer, il faut dépasser la vision marxiste qui interprète l’apparition du capitalisme comme une nécessité historique (et aussi, bien sûr, réfuter l’argument qui fait de cette apparition un grand progrès dans l’histoire de l’humanité – l’argument a longtemps été difficile à démonter ; la crise écologique généralisée impose le constat de son absurdité. D’ailleurs, je trouve caractéristique que les patrons des nouveaux géants de la Silicon Valley ne professent plus l’amélioration du monde – comme pouvait encore le faire un Bill Gates, mais l’amélioration de certains humains, ceux qui pourront se payer le transhumanisme).
De même, il me semble essentiel de se garder de toute confusion entre nos modélisations théoriques de la société et de son évolution avec la réalité de la société. Parler du modèle n’est pas parler de la société. Par exemple, dire que la lutte des classes existe en soi n’a pas de sens. Elle n’existe que lorsque les acteurs sociaux la font exister matériellement. En d’autres termes, il est essentiel de faire la distinction entre la réalité et les ordres imaginaires (une pomme existe réellement, indépendamment de nous ; le pays dans lequel se trouve le pommier qui l’a portée n’existe que parce que nous y croyons et le faisons exister. Cette pomme existe nécessairement ; le pays, lui, relève d’un ordre imaginaire – ou imaginé –, qui pourrait ne pas exister). Je pense que cette précaution peut éviter certaines erreurs d’appréciation et fourvoiements stratégiques.
Sans la connaître assez, ce que j’ai lu des penseurs de la critique de la valeur, courant essentiellement développé outre-Rhin ces trente dernières années, semble particulièrement intéressant. Seul bémol (mais je peux me tromper), il m’a semblé déceler un trait commun à certains de leurs penseurs qui me parait néfaste : le rejet de la science (ou plutôt, le rejet d’un ensemble souvent mal défini science-technologies) ; les sciences peuvent être détachées des technostructures capitalistes et elles constituent la seule façon que nous ayons de produire du savoir rationnel. Les négliger, les abandonner, c’est ouvrir les bras aux ténèbres des religions et du mysticisme.
Jean-Marc Royer met en avant une chose qui me parait essentielle : il nous faut cesser de refouler ce qui pose problème, soit en le renvoyant au lendemain du grand soir (comme le problème de l’investissement dans une société libérée du capitalisme), soit en tordant nos analyses et parfois la réalité pour qu’elles coïncident joliment. Mieux valent des contradictions assumées qu’une cohérence artificielle.
Cette dernière remarque m’amène à un sujet essentiel à l’heure d’évoquer critiques et pratiques politiques : la nécessaire prise de risques. Sans prise de risque, on ne fait ni on ne produit rien qui vaille la peine. C’est vrai dans le domaine des idées ou au sein d’une organisation (j’ai fréquenté une organisation dont la moitié des militants ont préféré ne prendre aucun risque vis-à-vis de leurs principes – par exemple le fait de salarier un juriste, sachant et acceptant l’entrave létale que cela constituait pour le développement de l’organisation). Prendre des risques c’est aussi oser l’élargissement, c’est-à-dire le « risque » que se joignent à nos luttes et mouvements des gens d’avis très différents, ou peu politisés. Prendre des risques – avec les principes libertaires par exemple – ce peut être de se montrer autoritaire envers ceux qui nous fréquentent sans nous respecter (j’ai en tête de multiples exemples ; le plus polémique ? Je pense que nous devrions nous passer de la compagnie des gens qui jouissent manifestement des conflits internes ou de ceux qui viennent soigner quelque névrose au sein d’un collectif a priori plus bienveillant qu’un club de sport). Il serait intéressant de développer une sorte d’éthique politique du risque.
Le poète argentin Leonidas Lamborghini dit quelque part que face à l’omniprésence d’avis et de théories qui finalement ne permettent pas de décider grand-chose, le poète donne ses solutions, brutes. Nous avons évoqué au cours de la rencontre la nécessité de restaurer le désir. Peut-être cela peut-il passer par des l’expression de la parole politique sous des formes plus artistiques, qu’elle qu’en soit la forme, mais populaire de préférence (c’est-à-dire ne nécessitant pas une grande culture artistique pour y accéder ; ou bien des expressions artistiques à plusieurs niveaux de lecture). Dire ce que nous avons à dire au plus grand nombre avec l’éclat et la simplicité de l’art plutôt que les centaines de pages absconses semble une jolie piste de travail. Ou, pour le dire autrement : que les militants sont parfois ternes et chiants ! Qui à part des militants à envie de passer une soirée avec des militants ou de lire leur prose ? (alors qu’on a souvent envie de passer un bon moment en compagnie d’expressions artistiques, au cinéma, en allant voir une exposition, un concert ou en lisant un roman par exemple).
Enfin, citons un élément qui pourra être vu comme une leçon tirée des pratiques de nos aïeux, ou comme une exigence de modestie : les perspectives et stratégies ne devraient pas avoir pour but la recherche du bonheur collectif, mais seulement d’éviter que les structures sociales ne créent, renforcent et institutionnalisent les inégalités entre humains. Le besoin de savoir faire la distinction entre le vrai et le faux ne signifie en rien une quelconque recherche d’absolu en pratique.
En conclusion, je vais revenir sur cette idée d’universels qui fait tant défaut à l’heure de la fragmentation des luttes (j’ai parfois vraiment l’impression que le corporatisme des syndicalistes a contaminé toute la société, grâce à la pensée postmoderne : à chacun sa lutte, à chacun sa domination à combattre ; cherchez bien, vous en trouverez une bien à vous) et dont j’ai l’intuition que ce sera elle, bien davantage que la pertinence d’une analyse ou le charisme de ceux qui la portent, qui pourra emporter l’adhésion d’une masse critique de citoyens. Il est possible que les circonstances historiques nous servent sur un plateau ce que nous n’avons pas été capables de penser. Il commence à devenir évident pour un nombre croissant de gens que le capitalisme met en cause l’avenir de l’humanité, voire au-delà (Royer parle de « guerre généralisée au vivant »). Dès lors lutter pour la disparition du capitalisme signifie lutter pour une cause réellement universelle : l’avenir du vivant et de sa diversité.
N’oubliez pas, ce sont des notes. Soyez indulgents avec les contradictions, erreurs et approximations. Je vais travailler à quelque chose de plus rigoureux et construit. Mais il m’a semblé intéressant de partager et donc peut-être de recevoir en retour des avis et commentaires dès à présent.