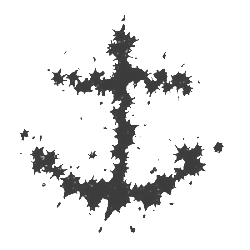Mare nostrum
Le bateau franchissait les vagues les unes après les autres, laissant sur l’eau un long sillage d’écume. Assis à la poupe, Georges tenait la barre du moteur d’une main ferme. Il se retournait souvent pour observer la traînée blanche, une longue veine ouverte, que la mer semblait peiner à refermer. Cette trace était la seule preuve qu’ils faisaient route vers quelque part.
Tout autour n’était que la mer. Au loin, quand le bateau montait sur une vague un peu plus haute que les autres, Georges apercevait l’horizon. Une mince ligne qui séparait la mer d’un immense ciel bleu. Pas une terre en vue, pas un navire, de l’eau, du ciel, une ligne qui les sépare, le soleil, et quelques humains, rien d’autre.
Pousser la barre pour infléchir le cap vers bâbord, tirer pour tribord. Réduire les gaz quand le bateau descendait une vague, donner de la puissance quand il gravissait la suivante. Georges avait acquis la dextérité nécessaire pour naviguer en haute mer.
Le soleil était bas maintenant, et la température chutait. Le vent et les embruns augmentaient la sensation de froid. Georges, en relevant le col de sa veste, eut la sensation de perdre quelque chose. À l’est était apparue la lune, et, au-dessus, quelques étoiles confirmaient l’arrivée imminente de la nuit. Si le ciel se peuplait, la mer, elle, demeurait immensément vide.
Georges regardait la lune, presque pleine, et la remercia. Sa faible lumière lui permettrait de continuer à distinguer le relief marin. Réduire les gaz, les remettre, éviter les petits rouleaux qui, parfois, naissaient au sommet des vagues.
L’homme consulta la boussole, puis vérifia que le GPS, la carte et le téléphone satellite étaient à leur place. Il sourit à la lune : finalement tout allait bien et elle faisait briller de blanc tout ce qui devait être vu. Mais pas ce qui arriverait.
C’est le car que Justine et Léa avaient choisi pour rejoindre Pozzallo. La climatisation les privait de l’air chaud de la Sicile, mais le véhicule roulait vite sur une autoroute en bon état. Elles seraient vite arrivées. Les deux jeunes femmes regardaient le paysage ras qui montait rapidement sur leur droite en collines et, au loin, en montagnes. Elles parlaient peu ; de temps en temps l’une ou l’autre prenait une photo à travers les vitres.
Le matin, elles avaient atterri à Catane en provenance de Paris. Le dépaysement avait commencé lorsque par le hublot de l’avion elles avaient aperçu l’Etna.
Le car s’arrêta dans la petite ville balnéaire de Pozzallo dans le milieu de l’après-midi. L’hôtel, par chance, était juste à côté, bien situé, à quelques rues de la plage.
Elles avaient trouvé un très bon tarif low cost pour l’avion, le car avait coûté moins que ce qu’indiquait leur Guide du routard et l’hôtel, modeste, était d’un très bon rapport qualité-prix. Sans une minutieuse préparation budgétaire, les deux amies n’auraient pas pu se payer cette semaine de vacances qu’elles planifiaient depuis plus d’une année.
Une semaine au soleil, en Sicile, à ne rien faire. Simplement se reposer d’une longue année de travail.
Pozzallo était ce qu’il leur fallait, elles en riaient. Touristique mais pas trop, authentique sans être austère. Le soleil et la chaleur étaient là, les restaurants ne semblaient pas très chers et les Siciliens étaient beaux et sympathiques.
Quelques mois auparavant elles avaient envisagé de partir plutôt en septembre mais Léa venait de se séparer de son compagnon, alors son amie avait pris les choses en main pour avancer leur départ. Le chagrin te passera au soleil lui avait-elle dit, allons-y en juin.
Léa avait laissé faire et elle ne le regrettait pas. Attablées à une terrasse elles buvaient un cocktail et profitaient de la brise chaude qui montait du sud, de la mer. Une brise dont l’arrivée semblait avoir précipité la chute d’un beau crépuscule rougeoyant. D’un rouge sang.
Au lever du soleil, Georges reprit la barre du bateau. Aux dernières heures de la nuit, il l’avait confiée à l’homme qui lui avait semblé le plus à même de tenir le cap dans l’obscurité. Tout s’était bien passé et les quelques heures de sommeil l’avaient remis d’aplomb pour une nouvelle journée de navigation qui, crut-il, s’annonçait bien. Le vent avait molli, la mer était moins grosse.
Mais le moteur s’arrêta. Il eut d’abord quelques ratés, Georges l’avait tapoté, avait vérifié l’arrivée d’essence, l’arrivée d’air, il avait demandé à ce qu’on vérifie le niveau de carburant. Tout semblait normal, mais le moteur toussa une dernière fois puis cessa de fonctionner. Georges essaya longtemps de le redémarrer, sans succès. À chaque fois la mécanique semblait repartir mais s’étouffait. Face au moteur, dos à la proue, il voyait le sillage du bateau se refermer. Bientôt il n’y eut, derrière le canot immobile, plus aucune traînée d’écume.
Georges se retourna et contempla les dizaines de passagers qui le regardaient, incrédules. Il évalua la situation : aucune terre en vue ; les conditions s’étaient un peu améliorées ; il n’y avait rien pour confectionner un gréement de fortune ; il fallait essayer de réparer le moteur.
Durant toute la journée, ballottés par des vagues insensibles à leur détresse, Georges et quelques hommes démontèrent le moteur, le nettoyèrent, le remontèrent, l’ouvrirent à nouveau et ainsi de suite. Sans résultat.
Le soleil avait fini sa course du jour et Georges, fourbu, contemplait le GPS, la carte et la boussole qui lui semblèrent absurdes maintenant qu’ils n’avançaient plus. Quant au téléphone satellite, il n’avait plus de batterie. Sans le moteur ils entendaient les bruits intimes de la mer et du bateau. Légers sifflements, clapot autour de la coque, craquements.
Il se déplaça jusqu’à la proue du bateau et parla à son frère, Ismaël. Tu sais, on n’a plus de moteur, lui dit-il à l’oreille. Et je crois qu’on n’en aura plus du tout. Il est mort. Le frère, son petit frère, ne répondit rien. Il baissa simplement les yeux.
Une nuit un peu plus fraîche que la précédente enveloppa le canot désemparé.
Le jour suivant, et le jour d’après encore, les hommes essayèrent de faire fonctionner le moteur. Au troisième jour de dérive retentirent les premiers pleurs. Et comme un appel que le courage avait tu jusque là, ils en déclenchèrent de nombreux autres. Une bonne moitié des passagers geignait et pleurait. Beaucoup aussi continuaient de vomir : malades depuis le départ, le fort roulis qui s’ajoutait au tangage depuis qu’ils n’avançaient plus, aggravait leur état.
En fait, Georges le constata au GPS, ils n’étaient pas immobiles. Ils dérivaient. Mais à un rythme affreusement lent.
En fin d’après-midi du troisième jour, une femme cria qu’il n’y avait presque plus d’eau. L’homme qui avait tenu la barre le dernier soir avant la panne – il se considérait un peu comme le second de Georges, dont personne ne contestait l’autorité bien qu’il ne fut en rien le capitaine en titre : il n’y en avait pas – le second, donc, se précipita pour vérifier les réserves d’eau. Sans rien dire il revint aux côtés de Georges. Pas tout à fait. Mais demain, nous n’aurons plus d’eau. Il faut boire moins, répondit Georges. Demain nous n’aurons plus d’eau en buvant seulement un petit verre chacun, répondit le second.
Georges s’adressa malgré tout aux soixante-quinze hommes et femmes dans le canot, par mots et par signes, en leur recommandant de boire le moins possible. Certains ne l’entendirent pas à cause de la brise, certains à cause de leurs pleurs, d’autres parce qu’ils ne comprenaient pas sa langue et beaucoup parce qu’ils ne comprirent pas ses gestes.
Le lendemain, alors que la mer était devenue presque tout à fait calme, il ne se passa rien de plus. Plus personne n’essayait rien avec le moteur, ceux qui priaient priaient, ceux qui pleuraient pleuraient et les autres ne faisaient rien d’autre qu’essayer de rester digne.
En fin de journée, un grand navire militaire se détacha à l’horizon. Georges et quelques hommes s’activèrent pour confectionner, avec des chemises et blousons colorés, une sorte de grand drapeau qu’ils agitèrent quelques instants. Le navire les avait déjà vus et approchait à vive allure. Mais il ne fit rien d’autre. Sur le canot, tout le monde criait. À la proue, un homme tendait à bout de bras un bébé vers le grand navire gris. Le bébé ne bougeait pas et quand Georges croisa le regard d’Ismaël, celui-ci dit avec ses lèvres, sans prononcer aucun mot : il est mort, ce bébé est mort.
Georges fut ensuite certain d’apercevoir, sur le grand navire gris, des marins qui prenaient des photos, appuyés au bastingage. Le second, dont le comportement était très troublé depuis la veille, plongea ses mains dans la boite contenant la carte, la boussole, le GPS et le téléphone satellite. Il les jeta à la mer en hurlant au grand navire de guerre qu’il fallait les sauver. Maintenant, il faut nous sauver, répéta-t-il.
Mais le grand navire repartit.
Le cinquième jour, trois hommes, six femmes et tous les enfants moururent. Leurs corps furent glissés par-dessus le plat-bord. Et, comme le canot ne bougeait pas, les cadavres flottèrent longtemps autour des vivants.
Justine et Léa s’étaient levées tard, juste avant que finisse le service du petit déjeuner.
Ensuite elles étaient allées se promener dans les rues chaudes de Pozzallo. L’après-midi, plage. Aussi simple que ça.
Allongées sur des serviettes trop grandes, elles avaient parlé. La mer, le sable, le soleil et l’oisiveté n’avaient pas contenu longtemps les chagrins de Léa et le mal-être de Justine.
Léa parla beaucoup de sa séparation. Pendant des années, elle avait eu du mal à s’établir dans une relation durable. Comme on aurait du mal à s’acheter, à vingt-huit ans, la concession dans laquelle on voudrait être enterré, avait-elle dit, c’est ce que je ressentais, tu comprends ? Justine comprenait. Elle se souvenait que son amie lui avait souvent parlé de son père qui, se plaignant continuellement et à tout propos, affirmait sans cesse qu’il avait un pied dans la tombe. D’ailleurs, ce devait être son premier souvenir de petite fille, un pied dans la tombe. Ça doit avoir quelque chose à voir avec ça, j’en suis sûre, mes problèmes avec les garçons, dit Léa en caressant le sable.
Après un long silence, ce fut au tour de Justine. Moi, avec les hommes ça va, mais… mais c’est moi qui ne vais pas. Son amie la scrutait, un peu surprise. Justine le roc, Justine l’amie solide, Justine était-elle, elle aussi, fragile comme le sable ? Oui, je ne sais pas exactement quoi. Un malaise persistant, depuis toujours. En fait, je ne me suis jamais sentie à ma place. Léa l’interrompit : mais tes parents ont été parfaits, t’es plus jolie que moi… Oui, mes parents, parfaits. Je suis allée voir quelqu’un pendant quelques mois – Léa se redressa un peu : son amie, le roc, avait consulté un psy ? – un type très bien. Nous discutions. Et au cours de ces discussions, nous en sommes arrivés à évoquer cette perfection de mes parents, justement, c’est peut-être ça qui ne m’a pas laissé de place. Et maintenant, je le traîne avec moi. C’est diffus, c’est comme une lancinante sensation que la vie, ce n’est pas ça. Il y a deux ans, tu sais quand on ne se voyait plus trop, t’étais en phase amour fou, il y a deux ans, j’ai même sérieusement pensé à partir. Je me suis renseignée, je voulais aller en Australie.
Léa s’était maintenant tout à fait redressée, ajusta son soutien-gorge et se couvrit les épaules d’une serviette, parcourue par la sensation que de telles révélations de la part de son amie exigeaient davantage de décence.
J’ai rempli un questionnaire, je suis allée au consulat, j’ai lu des centaines de forums. Mais je n’avais pas les conditions, pas le métier qu’il faut, ils sont très stricts sur l’immigration. Voilà, même un immense pays continent presque inhabité ne voulait pas de moi. Mais, et Stéphane, demanda Léa. Justine se contenta de regarder le large. Entre ses doigts une poignée de sable s’écoulait lentement, tombant sur le sable de la plage. La main se vida, la plage s’était à nouveau remplie. Mais ce sablier ne se retournerait pas.
En mer, les morts marquaient le temps. D’épuisement, de soif, de peur, de désespoir, les uns après les autres, les hommes et les femmes du canot périssaient. Georges maudit les passeurs qui leur avaient pris leurs sacs de provisions et leur eau, pour caser quelques passagers de plus. Qui leur avaient vendu un moteur défectueux. Georges maudit le second qui avait jeté boussole, GPS et téléphone. Le second, lui, ne maudissait plus personne. Il était dans le coma, gisant au fond du canot pneumatique, et dans quelques heures il serait mort.
À la proue, Georges voyait Ismaël qui, faiblement, lui souriait et levait un bras. Plus personne ne parlait, les gorges étaient trop sèches, trop douloureuses. Le seul effort que faisaient les survivants était de boire, toutes les deux ou trois heures, quelques centilitres de leur urine. Et de jeter les nouveaux cadavres à la mer, avant que le soleil les fasse gonfler et puer.
La Méditerranée les accablait d’un calme fatal. Pas une brise qui les portât quelque part, peu importe où, mais quelque part. Ils avaient rêvé d’Europe, ils n’espéraient plus que survivre.
Au cours de cette sixième journée de dérive, un hélicoptère militaire survola le canot en perdition. Il n’y avait plus de nourrisson à tenir à bout de bras, seuls quelques hommes eurent la force de se lever et de hisser leurs bras. De loin, ils ressemblaient à des épouvantails. Le grand hélicoptère vert kaki resta un peu en vol stationnaire au-dessus d’eux, puis de ses portes ouvertes des silhouettes jetèrent des bouteilles d’eau. Et il repartit.
Les hommes et les femmes – il en restait respectivement onze et quatre – se précipitèrent et il fallut toute l’autorité de Georges et de son frère pour que tout ne soit pas immédiatement bu, qu’un rationnement soit établi. Georges imaginait que l’hélicoptère pouvait ne pas revenir. De fait, il ne revint pas.
L’eau réveilla les corps meurtris. Quelques heures plus tard un vent de sud se levait. S’il annonçait des dangers, une mer grosse, il apportait aussi l’espoir de toucher une côte.
Il fallait faire un peu d’ordre dans le canot. Les objets inutiles furent jetés par-dessus bord. Le second était mort, personne ne s’en était aperçu. Georges l’immergea. Comme en souvenir des moments où ils avaient formé un improbable équipage, commandant et second de fortune, il le porta dans l’eau sans le laisser tomber. Quand ses avant-bras entrèrent dans la mer, il ressentit une intense brûlure. Il distingua une grosse méduse s’éloigner. Le vent poussait le canot, le corps du second était déjà loin.
La veille, Justine et Léa avaient parlé sur la plage, elles avaient ri, pleuré, avaient partagé des conseils et s’étaient promis de profiter de leurs quelques jours de congés ; malgré les méduses qui les empêchaient de se baigner.
Elles marchaient dans la vieille ville et approchaient du port. Il y avait une petite marina avec des voiliers et leurs bruits de drisses, et, un peu plus loin, le port de pêche et ses odeurs de poisson et de mazout.
En approchant des chalutiers, vides pour la plupart, elles virent un jeune homme travaillant à bord de l’un d’entre eux.
Elles s’arrêtèrent à proximité, feignant de contempler le bassin du port. Un invraisemblable grondement retentit dans le ciel, Léa pensa à Zeus en colère. Elles regardaient en l’air les deux avions de chasse qui venaient de survoler la côte à basse altitude. Le jeune pêcheur dans son bateau les suivait aussi du regard. Libya, leur dit-il en montrant les deux avions qui n’étaient déjà plus que deux petits points à l’horizon.
Les deux jeunes femmes approchèrent, dirent qu’elles ne parlaient pas italien, siciliano, rectifia le jeune homme en se désignant de l’index et en souriant, puis il expliqua dans un mélange d’anglais et d’italien que ces avions faisaient partie de la coalition intervenant en Libye, qu’ils y allaient, là-bas, dans le sud. Puis il ajouta que ce coin de la Méditerranée était plein de navires militaires en ce moment, tellement plein que c’en était un danger, les collisions.
Mais ce n’est pas le plus dangereux, ça doit être les tempêtes, non ? demanda Justine en regardant la rouille qui décorait le bateau du jeune homme. Oui et non, répondit-il. Oui, parce qu’en Méditerranée le mauvais temps se lève très vite et que la mer est très désordonnée, ce ne sont pas des longues vagues comme dans l’Atlantique. Et non, parce qu’ils naviguaient presque toujours près de quelque part, ce n’est pas si grand, alors des secours peuvent arriver rapidement. Faut pas couler quoi, mais on a plus de chance que les immigrés clandestins sur leurs bicoques. Et si vous en voyez en détresse, vous les aidez ? demanda brusquement Léa. Avant, oui, répondit le jeune homme, mais plus maintenant. Plus maintenant parce qu’il y a deux ans un capitaine du coin a été inculpé pour aide aux illégaux après en avoir ramené qu’il avait pris à son bord parce que leur canot coulait. C’est malheureux, ajouta le pêcheur. Les deux femmes comprenaient sans comprendre. C’est horrible, murmura Justine. Léa regretta sa question qui avait écrasé l’ambiance. Elles s’apprêtaient à partir. Mais l’homme leur demanda : vous aimez le poisson ? Oui, répondirent les femmes, surtout quand on a parlé avec le pêcheur. Le changement de conversation les libéra un peu, si bien qu’elles ajoutèrent même qu’elles adoraient les fruits de mer. Ah, j’en pêche aussi, là-bas – il désigna une côte à l’ouest de la ville – j’en vends au restaurant Mare nostrum, vous le connaissez ? Oui, on l’a vu sur le guide. Allez-y, c’est très bon, et c’est pas cher. Des fruits de mer alors, dirent-elles en saluant, oui, c’est ça, pensez à moi ce soir au dîner, leur répondit le jeune pêcheur en leur rendant un salut.
Le canot, poussé par le vent, dansait sur des vagues de plus en plus grosses. Certaines déferlaient et les hommes et les femmes survivants ne pouvaient rien faire d’autre qu’espérer qu’aucune ne viendrait chavirer l’embarcation. Ils se cramponnaient au bateau comme ils s’accrochaient à la vie.
Un homme cria quelque chose, mais les autres ne le comprenaient pas. Érythréens, Somaliens, Tunisiens, Georges et Ismaël étaient Sénégalais, peu parlaient la même langue. Mais en suivant la direction du bras de l’homme qui avait crié, tous virent une terre. Le vent les y poussait. Quelques kilomètres, pensa Georges, quelques kilomètres de chance, et c’est bon.
Il fallait écoper le fond du canot ; ceux qui n’étaient pas trop affaiblis ou terrassés par le mal de mer s’en chargeaient.
Quand la terre fut proche, Georges distingua ce qu’il redoutait, des déferlantes. La côte à cet endroit n’était que rochers, et ceux qui étaient immergés faisaient lever la mer qui explosait ensuite en gerbes blanches.
Le canot chavira dans les déferlantes. C’était à deux cents mètres environ du rivage et tout se passa très vite. Georges s’agrippa au cordage qui faisait le tour du canot. Quelques hommes réussirent à faire comme lui, d’autres coulèrent, d’autres essayèrent de rejoindre la terre ferme à la nage. Malgré le fracas des vagues, Georges entendit un cri rauque. Il se tourna et reconnut le blouson rouge d’Ismaël ; il se débattait dans l’eau à une dizaine de mètres ; il ne savait pas nager. Georges, bien que sachant nager, ne trouva pas la force, ne trouva pas le courage de lâcher le canot chaviré pour aller chercher son frère. Il le vit sombrer une fois, resurgir, puis disparaître.
Le canot finit par toucher terre et Georges, épuisé, choqué, vide, resta de longues heures face à la mer.
C’était deux jours avant l’arrivée de Justine et Léa en Sicile, un peu à l’ouest de Pozzallo.
Le corps d’Ismaël sombra, emporté au fond par le poids de ses vêtements et des objets qu’il avait dans les poches : un livre, des papiers, quelques photos, dont une de son frère Georges, un couteau, un sac contenant des coquillages ramassés à leur départ des côtes de Libye, un petit transistor à pile.
Pendant de longues minutes, sous l’eau, le cadavre fut ballotté, traîné sur le fond sableux par les lames de fond. Puis il se cala entre deux rochers. Très rapidement quelques poissons approchèrent de l’aubaine, picorèrent la peau noire ramollie par l’eau salée. Puis, par dizaines, marchant les uns sur les autres, vinrent les crabes. Avec leurs puissantes pinces, ils commencèrent par le visage et les yeux. En quelques heures, ils avaient mangé la moitié du cadavre.
Le pêcheur n’a pas menti, c’est la mer ici, dit Léa en entrant dans le restaurant Mare nostrum. Elles s’attablèrent, papotèrent gaiement, évoquèrent la musique un peu trop forte et l’éclairage trop intense. Elles avaient faim et le serveur tardait.
Quand il arriva, elles avaient déjà bien étudié la carte pour touristes, écrite en italien et en anglais.
Elles choisirent un grand plateau de fruits de mer.
À la fin du repas, quand le serveur vint débarrasser, les deux jeunes femmes n’avaient pas encore fini d’extraire, à l’aide de longs ustensiles métalliques, tous les brins de chair blanche de l’intérieur des pinces des crabes. Ah, je vous laisse finir, dit le serveur. Il est bon, n’est-ce pas, le crabe – les jeunes femmes, la bouche pleine, acquiescèrent sans parler, mais en levant le pouce – un très bon arrivage, ils ont été pêchés hier, reprit le serveur, là-bas, un peu à l’ouest de Pozzalo.
Nouvelle publiée en mai 2013 aux éditions Nouvelocratie