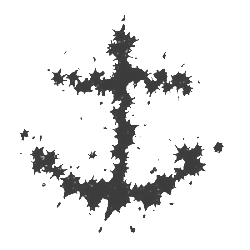Ménage
D’abord, il y a l’horreur du terme. Femme de ménage. C’est une femme qui, littéralement, appartient à son activité. Une essentialisation de la servitude.
C’était avec quelques collègues, j’avais tiré la discussion de sous le tapis des platitudes que semblent générer les machines à café d’entreprise. La plupart n’y voyaient pas malice ; seul l’un d’entre eux, bien qu’ayant les moyens, déclara n’en avoir jamais employé – mais sans trop savoir pourquoi.
Alors, bien sûr, pour détendre l’atmosphère, il peut y avoir des cas où je comprends : dépendance, maladie, handicap, grand âge, surmenage suite à un changement de vie…
Mais je ne comprends pas qui emploie « quelqu’un » tout en trouvant le temps de faire du sport, de sortir, de jouer avec ses enfants, de travailler volontairement dix heures par jour ou de regarder des séries.
Il est vrai que je nourris un dégoût viscéral à l’idée de me faire servir. S’il est évident que celui ou celle qui sert contre salaire est toujours exploité-e, j’ai toujours eu la sensation que celui ou celle qui se fait servir est symétriquement frappé-e d’indignité. Il en va bien sûr de ma représentation du monde. Dans mon univers, un homme ou une femme lave ses vêtements, passe le balai, fait sa vaisselle et ses courses.
Au-delà de ce sentiment personnel, employer quelqu’un pour faire son ménage charrie objectivement un imaginaire et des symboles. La soubrette, la bonne, la petite main, la servante, la gouvernante, le laquais, la ou le domestique, le valet… L’univers est celui de la noblesse et de la grande bourgeoisie qui se fait servir, par des femmes en général, par mépris pour les tâches domestiques, mais surtout pour marquer son rang social, son rapport de classe ; on emploie une femme de ménage aujourd’hui comme on fuyait les stigmates du soleil hier, la blancheur de peau signifiant luxe et oisiveté ; la modernité met ce désir bouchonné – se faire servir – à la portée de beaucoup. Entre 12 et 18 euros de l’heure, parait-il. Deux heures par semaine, un restaurant. Pour beaucoup d’autres, la chose ne mérite pas tant de verbiage : lorsque l’on peine à simplement bien se nourrir, lorsque quinze euros représentent une somme importante, imaginer que quelqu’un lave son sol ou ses sous-vêtements est simplement impossible et indécent.
 Il y a autre chose, et c’est aussi lié au statut social. À la propriété. Faire son ménage, son repassage, c’est garder la mesure de ce que l’on possède, de ce dont on a besoin, de l’endroit où l’on habite. Les choses que je possède, l’espace que j’habite, j’en prends la mesure lorsque je les nettoie, lorsque je les range, lorsque je les lave, les plie et les repasse. Si je n’ai « pas le temps », la solution n’est pas d’avoir une « aide ménagère ». La solution est d’avoir moins de choses. De vivre dans moins grand. De travailler moins. De dormir moins. D’apprendre à aimer le désordre créatif, si l’on tient absolument à tous ses bibelots. Et probablement le monde se porterait-il mieux si on limitait la propriété à celle dont on peut soi-même s’occuper.
Il y a autre chose, et c’est aussi lié au statut social. À la propriété. Faire son ménage, son repassage, c’est garder la mesure de ce que l’on possède, de ce dont on a besoin, de l’endroit où l’on habite. Les choses que je possède, l’espace que j’habite, j’en prends la mesure lorsque je les nettoie, lorsque je les range, lorsque je les lave, les plie et les repasse. Si je n’ai « pas le temps », la solution n’est pas d’avoir une « aide ménagère ». La solution est d’avoir moins de choses. De vivre dans moins grand. De travailler moins. De dormir moins. D’apprendre à aimer le désordre créatif, si l’on tient absolument à tous ses bibelots. Et probablement le monde se porterait-il mieux si on limitait la propriété à celle dont on peut soi-même s’occuper.
C’est un sujet sensible, avez-vous remarqué ? Parlez-en autour de vous, vous verrez. C’est un marqueur fort de contradictions. C’est que l’on peut se dire de gauche et avoir son employé-e de maison ; c’est un marqueur du schisme entre ce que l’on est – tel que l’on se définit – et ce que l’on fait ; entre ce qu’on a été, et ce qu’on est devenu ; c’est aussi que ça touche à l’intimité. Je pense que de nombreuses personnes, lorsqu’elles se sentent obligées de se justifier, ressentent confusément l’indignité frappant qui se fait servir.
Surgissent souvent, aussi, des arguments fallacieux : mais je leur donne du travail. Non ; les inégalités sociales – parmi lesquelles se compte celle qui scinde les travailleurs en « actifs » et « chômeurs » – perdurent parce que nous laissons le marché déterminer nos relations économiques et parce que nous acceptons le principe du salariat : le vol d’une partie de la rémunération du salarié et sa soumission à un lien de subordination. On ne « donne » pas du travail, on en profite.
Une autre question relève de la dignité : pourquoi payer quelqu’un pour faire ce que l’on sait faire, ce que je peux faire ? Je ne vois qu’une explication : ceux qui le font considèrent que ce « gain » de temps leur permet de faire des choses qui ont plus de valeur que le ménage qu’ils délèguent. Cela me semble confirmé par le constat que dans l’immense majorité des cas, la rémunération horaire perçue par la femme ou l’homme de ménage est très significativement inférieure aux revenus horaires du foyer qu’il ou elle récure.
Cette question de dignité est évidente si l’on pense à la dimension manuelle et genrée du ménage. C’est ingrat, on s’abîme la peau et le dos ; on met les mains dans les chiottes, on travaille courbé ; c’est manuel, c’est silencieux et discret, c’est féminin, c’est pour des immigrés, ce n’est pas digne des aspirations sociales et intellectuelles des patrons domestiques. Ici, ces patrons rejoignent les patrons d’entreprise, qui font aussi faire le ménage – en obligeant les nettoyeurs à se lever aux aurores, pour qu’ils ne croisent pas les autres employés.
Une chose est drôle : ce sont parfois les mêmes qui rechignent à faire eux-mêmes leur ménage – c’est-à-dire à se dépenser physiquement – que l’on voit s’époumoner en footing ou et dans les salles de sport. Drôle et triste.
Tout le monde est plus ou moins criblé de contradictions. Mais celle-là, je dois dire, je ne la comprends vraiment pas.
Le collègue qui n’avait jamais voulu employer « d’aide à domicile » et qui ne savait pas très bien pourquoi… Il nous a confié que sa mère avait été femme de ménage toute sa vie. « Ça doit être pour ça », a-t-il conclu.