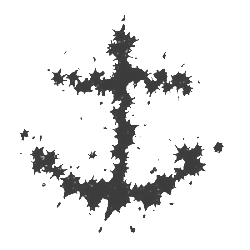Nous reviendrons
Une histoire des spectres révolutionnaires
France – XIXe siècle
Un livre d’Éric Fournier
« Le jour viendra où notre silence sera plus fort que les voix que vous étranglez aujourd’hui »
August Spies, anarcho-syndicaliste, le jour de son exécution. Chicago, 11 novembre 1887
Depuis toujours, évoquer les spectres c’est défier. Défier la mort, défier la fatalité, défier en effrayant, défier et maudire de génération en génération, hanter anonymes ou puissants, empêcher de nouveaux propriétaires de jamais dormir tranquilles, défier les clercs qui n’aiment pas les fantômes, trop magiques… Il n’est donc pas étonnant que les révolutionnaires s’en soient emparés. Pourtant, on peut relativement bien connaître son histoire sociale et politique européenne et n’avoir jamais donné l’importance due aux fantômes qu’elle tient dans ses malles et ses greniers. Des « damnés de la terre » de l’Internationale aux poèmes de Louise Michel, des images de cadavres bondissants de la Semaine sanglante au « spectre [qui] hante l’Europe, le spectre du communisme » – incipit du Manifeste du Parti communiste – au « Je reviendrai et je serai des millions » de Spartacus [1], les spectres traînaient leur teint blafard et leurs imprécations sans que leur histoire soit contée. Comme s’ils n’existaient pas, dirait un irrespectueux. Les spectres communs hantent mollement alors que les fantômes révolutionnaires, c’est-à-dire politisés et radicaux, ont toujours de furieuses passions existentielles. Ils clament haut et fort qu’ils sont, qu’ils reviendront. Éric Fournier, avec son style fluide et agréable, lève le voile sur leurs surgissements et les hisse ainsi à la vie historique.
Mais de quoi parlons-nous, de quels genres de zombies est-il question ?
Les spectres sont des manifestations des morts ou d’ancêtres, auxquels commandent des forces obscures et qui viennent interagir avec les vivants, les hanter, se venger, les tourmenter ou les accompagner. Leurs variantes révolutionnaires sont les âmes errantes des insurgés et révoltés éliminés par l’armée, la police, les gouvernements, l’État.
 C’est la façon dont on tue les révolutionnaires, sommairement abattus, sommairement jugés, enterrés vivants, laissés pour morts, versés dans des fosses communes, tués parce que ressemblant à quelque figure connue qui fait de ces femmes et de ces hommes les spectres qu’ils sont.
C’est la façon dont on tue les révolutionnaires, sommairement abattus, sommairement jugés, enterrés vivants, laissés pour morts, versés dans des fosses communes, tués parce que ressemblant à quelque figure connue qui fait de ces femmes et de ces hommes les spectres qu’ils sont.
Et, souvent, ils sont conformes à cette idée très XIXe du « bien mourir », qui n’a pas manqué d’occasions de s’exercer : combats de 1832, massacres de décembre 1851 et surtout de juin 1848 ou mai 1871, épisodes dont on remarquera la violence et l’ampleur croissante ; bien mourir, c’est-à-dire fièrement, avec un bon mot – « Il est 3 heures. À quatre heures nous serons tous morts », Charles Jeanne, sur une barricade de 1832, épisode qu’Hugo glorifiera dans les Misérables (p. 5) –, le regard droit et le geste haut – ; sur un autre continent, revoyez la photo de Fortino Samano face au peloton d’exécution [2], que l’on ne peut qu’admirer aujourd’hui où l’individualité reine de la postmodernité semble nécessairement enfermer la victime de la mort donnée par le bourreau à ce seul statut de victime, sans laisser de place à l’émergence d’une héroïne ou d’un héros. Mais revenons à notre XIXe. Les spectres sont faits spectres par la répression – mais on pourra se demander si les esprits frappeurs apolitiques des campagnes sont vraiment volontaires ; probablement qu’en de tels destins, on meurt spectre, on ne le devient pas, dirait le poltergeist de Simone Beauvoir.
Une fois les spectres sérigraphiés sur le suaire de l’Histoire, c’est-à-dire une fois que l’historien nous en fait remarquer l’apparition tout au long du XIXe, dans les proclamations politiques, les poèmes, les illustrations, les déclarations et les expressions populaires… se pose la question à laquelle Fournier répond aussi avec ce livre : pourquoi les révolutionnaires ont-ils donné vie à de telles figures spectrales ?
La fonction de ces spectres est de tourmenter les vainqueurs, l’ordre et le pouvoir, de leur « donner des frissons de condamné à mort » (p. 106). Et de venger les assassinés, davantage que de leur faire justice. Comme si la mort brutale donnée par le pouvoir faisait basculer dans le registre de la vengeance ; la justice est de l’ordre de vivants. Au-delà, c’est la vengeance.
Mais les spectres ne se limitent pas à « rappeler leurs crimes aux vainqueurs ». Ils ont une véritable « historicité révolutionnaire luttant contre les linéarités trompeuses des partisans de l’Ordre moral ou les fausses promesses des horizons libéraux » (p. 115). Et c’est en cela qu’ils sont des spectres révolutionnaires et non des ectoplasmes réformistes, justes bons à émoustiller le bourgeois. Non, les « spectres révolutionnaires sont une chose sérieuse, une arme dans la maîtrise du temps » (p. 115), d’une grande modernité.
Une grande place est donnée aux spectres de la Commune, de leur surgissement suite aux massacres de la Semaine sanglante à leur récupération par le Parti communiste en recherche de légitimité au début du XXe siècle. Le Mur des Fédérés fut l’archétype de l’endroit de naissance des spectres révolutionnaires : c’est dans le cimetière du Père-Lachaise qu’eurent lieu certains des derniers combats de la Commune, c’est contre ce mur que les versaillais fusillèrent les derniers combattants, c’est au pied du Mur que furent creusées les fosses communes alimentées pas des milliers d’autres exécutés sommairement. Leurs corps y ont fusionné avec le grand marronnier d’Inde qui se tient là avec force.
 Les spectres révolutionnaires ne sont pas des dames blanches dont d’espiègles anciens entretiennent le mythe : ils ont des fonctions politiques, la principale étant de lutter « contre les effacements » en particulier après la Semaine sanglante qui vient clore la Commune de Paris (entre 7000 et 15000 morts, le plus grand massacre du XIXe européen, p. 118) où il s’agit de juguler l’effacement « infamant de l’ordre moral comme celui apaisant de la République libérale » (p. 109).
Les spectres révolutionnaires ne sont pas des dames blanches dont d’espiègles anciens entretiennent le mythe : ils ont des fonctions politiques, la principale étant de lutter « contre les effacements » en particulier après la Semaine sanglante qui vient clore la Commune de Paris (entre 7000 et 15000 morts, le plus grand massacre du XIXe européen, p. 118) où il s’agit de juguler l’effacement « infamant de l’ordre moral comme celui apaisant de la République libérale » (p. 109).
Ce qui ne va pas de soi, souligne Fournier : le massacre fut terrible ; parcs, squares, jardins et cimetières ont partout dans Paris été creusés de fosses communes d’où exhalent encore ça été là les puanteurs de cadavres de communards passés par les armes, que déjà on en appelle à leurs spectres qui lèveront les futures révolutions. C’est osé. C’est une façon de dire : vous nous avez durement massacrés, vos régimes, République comprise, sont fondés sur le sang de ces massacres, mais ce n’est pas fini, c’est loin d’être fini.
On peut se demander si les spectres ne sont pas une expression, une résurgence d’idéalisme dans un mouvement qui se construit rationnel, éclairé, matérialiste. Citons Marx, qui revenait sur son « spectre du communisme » en expliquant que c’était une « une idée fausse, un fantasme réactionnaire, mais qui a une efficacité et un fondement politique réel » (p. 79). En somme, ça marche et peut-être cette invocation vient-elle aussi satisfaire partiellement un besoin de mystique, de transcendance qu’a toujours nourri le socialisme.
Revenus de l’exil, de la prison, de la mort ou même truite agonisante (par Gustave Courbet), peu importe, l’important est que le spectre révolutionnaire revient. Il est le retour. L’idée du retour. L’idée que, quelles que soient les batailles perdues, la guerre ne le sera pas. Les spectres figurent l’éternel retour de la juste cause sociale. Un jour, nous gagnerons.
En cela, les fantômes révolutionnaires ont aussi eu la fonction de cristalliser et transmettre la mémoire des insurrections. Les réactionnaires ont tôt déclenché la damnatio memoriae des insurgés et communards ; ils ont leur Sacré-Cœur, nous avons nos spectres.
Avec les spectres vient l’idée d’une certaine continuité, de passation, de permanence: « Les morts sont des vivants mêlés à nos combats » (p. 131), dit la légende d’une illustration du Mur. Mon père – dont les cendres sont au Mur – m’a dit un jour que son père n’était pas tout à fait mort, qu’il était en lui, et que, peut-être, lui-même sera en moi ; et que mes enfants, biologiques ou choisis, continueront à me porter lorsque je serai moi-même mort, si l’esprit révolutionnaire perdure. L’imaginaire social, en écho à l’intime, fait de la mémoire des victimes des insurrections, des émeutes et des répressions des modèles révolutionnaires catalyseurs de la réactivation des luttes.
 C’est aussi qu’il n’y a pas de culte fétiche des reliques, pas d’adoration des choses comme chez les bourgeois. Les symboles sont tout au plus des fleurs, immortelles ou églantines rouges, qui passent du registre du deuil et du souvenir à celui de la révolte et de la révolution. La continuité, ce sont les idées… les spectres et les fleurs.
C’est aussi qu’il n’y a pas de culte fétiche des reliques, pas d’adoration des choses comme chez les bourgeois. Les symboles sont tout au plus des fleurs, immortelles ou églantines rouges, qui passent du registre du deuil et du souvenir à celui de la révolte et de la révolution. La continuité, ce sont les idées… les spectres et les fleurs.
Si chacun d’entre nous cherchait parmi ses aïeux, en interrogeant une grand-mère ou un vieux cousin, sûrement dans chaque famille se lèverait un aïeul prêt à donner l’exemple de l’engagement révolutionnaire à ses descendants. Ça changerait pas mal des conneries d’Instagram.
Paris, « bivouac des révolutions » selon la formule de Vallès, porte la trace et incarne la spectralité révolutionnaire, par cet incontournable sous-jacent urbain, les pavés – pavés des barricades, bien sûr, pavés qui affleurent encore de nos jours sous le goudron, comme jadis les fusillés mal enterrés.
Dans ces parcours spectraux, dans cette ville qui excelle en insurrections, il y a des échos émouvants avec la modernité, comme ces commémorations qui ressemblent aux scènes de communion contemporaines entre survivants et descendants politiques des opposants aux dictatures sud-américaines, lorsque de vastes assemblées scandent les noms des disparus assassinés par les militaires et que la foule, en cœur, répond : « Presente ! ».
Il y a des moments très forts, loin de Paris, aussi, comme l’évocation de Maria Blondeau, dix-huit ans, abattue au cours d’une manifestation du premier mai 1891 à Fourmies. Elle meurt sous les balles de l’armée française en manifestant pacifiquement pour la journée de huit heures, un rameau d’aubépine à la main, offert le matin même par son fiancé. À la fin du siècle, des socialistes verront dans le 1er mai une fête « non seulement avec les vivants, mais avec les morts, l’humanité toute entière », faisant de cette journée de revendication internationale une continuité avec d’anciennes fêtes païennes (p. 128).
Fournier révèle aussi en quoi les spectres révolutionnaires n’ont rien à voir avec le culte des morts et les bricolages héréditaires des réactionnaires ; ces derniers sont intemporels, fiers de leur race et de leur nation qu’ils aiment imaginer respectivement réelles et éternelles. Même chez les fantômes, non, les extrêmes ne se rejoignent pas.
Le livre recèle aussi une frappante série de portraits de protagonistes ayant vécu en leur chair le statut de revenants – dont l’incontournable Louise Michel, qui se définit comme « le spectre de mai » – de fantômes révolutionnaires, ce qui permet finalement d’assister à l’incarnation de ces spectres que nous avons suivis tout au long de ces pages. Une transsubstantiation révolutionnaire, en somme.
Enfin, pour expliquer comment et pourquoi les révolutionnaires ont investi « résolument les ressources du fantastique et des cultures magiques », il faut se défaire de l’idée simpliste que les « lumières émancipatrices » s’opposent à un « romantisme conservateur ». Le romantisme recèle aussi de puissantes « potentialités révolutionnaires » ; il n’est pas que mélancolie bourgeoise. Notons au passage que mobiliser les « cultures magiques » est bien différent que de tolérer les religions – structures sociales et politiques de pouvoir –, pratique très courante chez bien des radicaux « éveillés » contemporains.
Alors continuons à cultiver nos spectres, le souvenirs des morts sur les barricades, à porter leurs anathèmes et leurs paroles de vengeance lorsque la justice ne peut plus rien. C’est ainsi que Spartacus, Louise Michel et Maria Blondeau vivent encore et s’incarneront à nouveau. Comme le disait Louise Michel, ils sont invincibles, on ne peut tuer une deuxième fois un mort. Le rôle historique de ces fantômes est peut-être, surtout, d’être de « puissants antidotes à la résignation » (p. 208). Ils nous sont bienveillants. Ils ne sont mauvais que pour les tenants de l’ordre établi.
Notes:
[1] Le mot est en réalité de Fairtrax, compagnon gaulois du gladiateur révolté Spartacus, qui le lance à la face des vainqueurs romains, mourant crucifié entre Rome et Capoue dans le roman « Spartacus », de Howard Fast, publié en États-Unis en 1951 (p. 21). Un obscur poète argentin et péroniste reprendra la phrase, qui sera ensuite attribuée à Eva Perón, la vidant de tout son sens. Il semblerait que la phrase soit en fait de Túpac Katari, un résistant andin aux Espagnols, mis à mort par les conquistadors 1781: « A mí solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones »: https://www.finalescerrados.com/2020/07/volvere-y-sere-millones.html
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fortino_S%C3%A1mano
Audio – podcast – de la rencontre du 8 mai 2024 :
https://open.spotify.com/episode/7eIfAwHkLj5wtnb3pPIV6K
« Nous reviendrons ! »
Une histoire des spectres révolutionnaires
France – XIXe siècle
Éric Fournier
Champ Vallon, 210 p.
2024