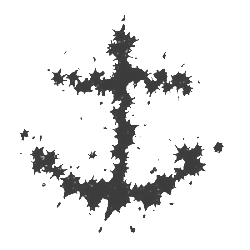Pas pleurer
Un livre de Lydie Salvayre
« L’évêque-archevêque de Palma désigne aux justiciers, d’une main vénérable où luit l’anneau pastoral, la poitrine des mauvais pauvres » (p. 11). Le livre commence fort, avec cette citation de Georges Bernanos. Un mauvais pauvre, c’est un pauvre qui se rebiffe contre sa condition ; c’est un pauvre que l’on peut fusiller, avec la bénédiction des curés. Les exploités sont l’une des grandes voix du roman. L’histoire est racontée par deux femmes, la mère et la fille. La mère a vibré pendant la révolution espagnole de 1936, avant de fuir en France acculée par la victoire des fascistes. Des années plus tard, la fille – la narratrice – recueille le témoignage de sa mère. En écho à sa mère Lydie Salvayre pose Georges Bernanos, catholique et conservateur que les crimes franquistes ont horrifiés et qui est passé du bon côté de la barricade. « L’Église espagnole a révélé avec la guerre son visage effrayant. Pour Bernanos, l’irréparable est consommé » (p. 139). Ils sont émouvants ces parcours de gens qui vont à l’encontre de toute leur formation, de toute leur culture et de leur entourage pour défendre la justice ou la liberté.
« Je ne veux pas être boniche, je préfère faire la pute en ville » (p. 14) s’écrie la jeune femme, Montse, qui deviendra la mère ; puis la vieille qui perd la mémoire, toute la mémoire, sauf celle de sa jeunesse et de ces mois effervescents en Espagne rouge et noire, couleurs de la grande centrale anarcho-syndicaliste, la CNT. Elle oublie le présent avec autant de facilité que nous y sommes vainement accrochés comme des bernicles ; mais elle se souvient de ce passé que nous oublions. Qui se souvient encore du combat de ces femmes et de ces hommes qui non seulement affrontaient les fascistes mais faisaient une révolution libertaire ? Elle ravive « les mots d’un monde qui commence : révolution, liberté, fraternité… » (p. 22), contre tout ce que « le mot national porte en lui de malheur » (p. 94). Des deux maux du siècle évoqués par Schopenhauer en son temps, la vérole et le nationalisme, seul le premier a presque disparu. Transparaît aussi dans le livre la force de vie et d’amour des anarchistes, des humanistes, qui s’élève contre l’abject « Viva la muerte » des militaires. Jusque dans le combat à mort contre l’hydre réactionnaire qui bientôt noiera toute l’Europe, José « ne comprend pas que ces jeunes gens qu’il voit partir au front, torses bombés et culs cambrés à l’espagnole, aillent se faire massacrer avec un entrain aussi obstiné » (p. 129).
Salvayre fait de magnifiques phrases : « […] je sens, à leur évocation, se glisser en moi par des écluses ignorées des sentiments contradictoires » (p. 17) et des images qui flottent encore longtemps à l’esprit, comme cette femme « dodue comme un rat d’église ».
 Bernanos est là comme témoin moral d’une histoire que Salvayre maîtrise. Elle n’omet pas, par exemple, comment le Parti communiste espagnol a prospéré en recrutant parmi la bourgeoisie républicaine – se faisant le chantre de l’ordre et de la modération –, avant de refermer ses crocs staliniens en mai 1937 en tournant ses armes contres les anarchistes et en faisant exécuter les gens du POUM (un parti marxiste non stalinien). Ils « voulaient depuis longtemps contrôler le jeu politique et liquider de la révolution son contenu libertaire. Ils s’acharnaient depuis longtemps à discréditer par la calomnie ceux qui s’en réclamaient. Mais la calomnie est une méthode pour chochottes. Il s’agissait à présent d’être sérieux. Comment ? En fusillant, pardi. C’est ce qu’ils firent » (p. 240).
Bernanos est là comme témoin moral d’une histoire que Salvayre maîtrise. Elle n’omet pas, par exemple, comment le Parti communiste espagnol a prospéré en recrutant parmi la bourgeoisie républicaine – se faisant le chantre de l’ordre et de la modération –, avant de refermer ses crocs staliniens en mai 1937 en tournant ses armes contres les anarchistes et en faisant exécuter les gens du POUM (un parti marxiste non stalinien). Ils « voulaient depuis longtemps contrôler le jeu politique et liquider de la révolution son contenu libertaire. Ils s’acharnaient depuis longtemps à discréditer par la calomnie ceux qui s’en réclamaient. Mais la calomnie est une méthode pour chochottes. Il s’agissait à présent d’être sérieux. Comment ? En fusillant, pardi. C’est ce qu’ils firent » (p. 240).
La juxtaposition d’un français parfait à la Bernanos à celui de la mère, zébré d’espagnol, fait de ce livre une très belle pièce de style : « On s’est perdu en suppositions (dit ma mère) avec cette psychologie à deux balles comme tu dirais, dont les gens s’encapricent quand ils sont privés des distractions élémentaires » (p. 36). Elle reprend tout, aussi exagéré qu’on imagine le soleil de juillet 1936, comme cette façon de mettre des majuscules au milieu d’une phrase, même sans point : « Au point qu’il en vient à lui dire Ta gueule ». Sur ce chemin, le livre est un très bel essai sur ce que c’est que de parler une langue adoptée.
En suivant la révolution dans un village, notre « esprit se réforme », comme celui de José qui embrasse les idées et pratiques libertaires. Le rythme du roman, des états d’âme de ses personnages, des rapports mère-fille, les difficultés de l’amour planté dans la réalité (p. 211) et des rudesses de l’exilée dont la mémoire est restée bloquée sur ses quelques années de jeunesse révolutionnaire, le rythme de la fiction suit le rythme de l’Histoire.
Comment ne pas s’attacher à cette révolution ? Comme ne pas s’attacher à Bernanos, comment ne pas s’attacher à José, Montse et la fille ? « [Il] découvrait, le cœur défait, que lorsque la peur gouverne, lorsque les mots sont épouvantés, lorsque les émotions sont sous surveillance, un calme, hurlant, immobile s’installe, dont les maîtres du moment se félicitent » (p. 183). Lydie Salvayre écrit comme une Espagnole avec l’emphase que l’on imagine aux Ibériques. Ainsi, quand elle évoque Claudel, elle précise que « Shakespeare eût nommé tout crûment fils de pute » (p. 212). C’est qu’il ne faut pas fléchir, et la vie n’est pas pour les timorés : « Il y a quelque chose de mille fois pire que la férocité des brutes, c’est la férocité des lâches » (Bernanos, p. 212). Pour l’histoire, pour le style et pour les idées, superbe livre.
Pas pleurer
Lydie Salvayre
Seuil, 279 p.
2014