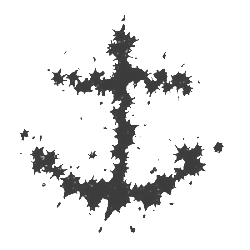Pour une haute mer ouverte
Le monde est devenu nôtre par la proue des navires.
La mer qu’elles fendent ouvre au voyage, sans routes ni frontières. C’est en naviguant que les hommes et les femmes ont toujours peuplé les terres par-delà l’horizon. Et la mer a toujours la délicatesse de ne rien nous rappeler, de refermer tous les sillages que nous y faisons. Elle nous laisse imaginer que nous sommes de quelque part. Il parait même que nous en sommes sortis, il y a des millions d’années.
Au travail, à la pêche, à la guerre, en exploration, en s’amusant, en voyage ou en émigrant l’humanité a toujours payé un lourd tribut pour oser y naviguer.
Il n’est pas anodin que nos larmes soient salées comme la mer.
Ce tribut se mesure en nombre de péris en mer.
Quelques funestes chiffres, parmi des milliers : en 1912 le Titanic sombre dans l’Atlantique nord, mille cinq cents personnes trouvent la mort ; en 1941 l’aviation japonaise attaque la flotte étasunienne à Pearl Harbor, deux mille quatre cents marins sont tués ; en 2002 le ferry Joola fait naufrage au large de la Gambie, plus de deux mille noyés.
Pour l’année 2014 l’Organisation internationale pour les migrations comptabilise trois mille cinq cents noyés en Méditerranée. Plus de mille sept cents depuis le premier janvier 2015. Depuis l’an 2000, ce sont plus de vingt-deux mille personnes qui ont péri en mer en tentant de traverser la Méditerranée.
Par milliers des hommes, des femmes et des enfants qui n’ont souvent jamais vu la mer y viennent et y sombrent. Aux yeux du monde ils disparaissent comme s’ils n’avaient jamais existé. On les appelle migrants.
Lorsqu’ils chavirent, ils flottent quelque temps, morts ou vivants, puis coulent. Ensuite leurs corps se délitent, sont mangés, se dissolvent*.
Par milliers ils tentent de rejoindre une Europe ingrate qui se ferme aux fils et filles de ceux dont l’exploitation coloniale a fait la fortune.
Ils sont pauvres, ils viennent d’ailleurs, ils n’ont pas les visas réglementaires, ils comptent pour si peu. De sordides bêtes brunes, tapies dans les recoins crasseux de nos chers terroirs, bavent que les étrangers viennent nous remplacer. D’autres, sordides, pragmatiques qu’ils se disent, murmurent en baissant les yeux que c’est une sorte de fatalité, que c’est dramatique, mais que voilà, que voulez-vous faire, c’est ainsi.
Nous aimons les humains, nous aimons la mer et les navires. Nous savons qu’en mer continue de se jouer notre histoire.
Les navires ne devraient devenir tombeaux que si tout a été fait pour qu’ils ne le soient pas. La mer n’est pas un cimetière liquide dont le destin serait d’accueillir les victimes de l’avidité des passeurs et de notre incestueuse volonté d’entre-soi.
Il ne s’agit pas d’humanitaire mais de politique.
Nos frontières sont meurtrières, elles doivent disparaître.
Qui veut traverser doit pouvoir traverser.
L’Europe doit secourir les migrants comme elle le ferait avec tout marin en détresse, et non monter des opérations militaires qui ne visent qu’à cadenasser davantage nos côtes. Les abjectes et cyniques évocations de la crainte « d’appels d’air » doivent cesser.
Qui peut aider doit aider. Les gens de mer doivent pouvoir secourir conformément au droit maritime international sans craindre de commettre quelque délit d’assistance aux clandestins.
La mer n’est pas un champ de mort.
Nous aimons les humains, la mer et les navires qui voguent.
La mer doit redevenir lieu de passage.
* En mai 2013, avant le lancement de l’opération militaro-humanitaire Mare nostrum (abandonnée depuis : l’Europe qui brunit a jugé qu’elle « facilitait » le passage des migrants en le sécurisant) j’avais écrit une nouvelle prémonitoire… Mare nostrum.