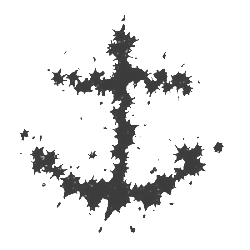Qui a fait le tour de quoi?
L’affaire Magellan, un livre de Romain Bertrand
« Lorsqu’ils arrivent à Tidore, le 8 novembre 1521, Elcano et ses équipages laissent – littéralement – exploser leur joie : “Nous remerciâmes Dieu, et de joie nous déchargeâmes toute notre artillerie”. Ainsi donc, quand les Espagnols sont contents, ils font donner de leur artillerie ; et quand ils ne sont pas contents… ils font donner leur artillerie. Des gens qui canonnent du matin au soir, il y a mieux comme visiteurs. » (p. 111)
Magellan, c’est un mythe. Une incroyable épopée maritime, la découverte du passage au sud de l’Amérique, le baptême du Pacifique, la première circumnavigation, le grand exploit de la modernité naissante… Mais Romain Bertrand, dès les premières pages, prévient : un mythe oui, mais c’est celui de « l’idée arrogante que l’Europe s’est longtemps faite d’elle-même, de son excellence, de sa précellence » (p. 13).
 Avant que de suivre Magellan et ses hommes autour du globe, voyons les conquêtes des Européens en Asie lorsqu’ils étaient allés vers l’est, en passant par le sud de l’Afrique. D’abord, elle ne furent pas le fruit d’un plan mûrement réfléchi sur quatre-vingts ans, une volonté patiemment mise en œuvre, mais des sauts de puce (p. 19) dont le Frère Vicente do Salvador dit au début du XVIIe siècle : « Bien que les Portugais soient de grands conquérants de terres, ils ne les exploitent pas, se contentant d’en arpenter les côtes tels des crabes » (p. 20). Ensuite, on l’imagine aisément mais l’historien en atteste factuellement : ce ne sont pas des conquêtes « romantiques », mais des carnages (p. 18). Et coûteux avec ça, comme la très dispendieuse prise de Ceuta : « Même en admettant que les nobliaux aient de temps à autre besoin de tirer l’épée, ça fait quand même cher la tuerie » (p. 19).
Avant que de suivre Magellan et ses hommes autour du globe, voyons les conquêtes des Européens en Asie lorsqu’ils étaient allés vers l’est, en passant par le sud de l’Afrique. D’abord, elle ne furent pas le fruit d’un plan mûrement réfléchi sur quatre-vingts ans, une volonté patiemment mise en œuvre, mais des sauts de puce (p. 19) dont le Frère Vicente do Salvador dit au début du XVIIe siècle : « Bien que les Portugais soient de grands conquérants de terres, ils ne les exploitent pas, se contentant d’en arpenter les côtes tels des crabes » (p. 20). Ensuite, on l’imagine aisément mais l’historien en atteste factuellement : ce ne sont pas des conquêtes « romantiques », mais des carnages (p. 18). Et coûteux avec ça, comme la très dispendieuse prise de Ceuta : « Même en admettant que les nobliaux aient de temps à autre besoin de tirer l’épée, ça fait quand même cher la tuerie » (p. 19).
Mais les peuples rencontrés par les Européens ne sont pas non plus idéalisés : Romain Bertrand décrit l’importance des alliances locales pour les colonisateurs, comme celle avec les Tamouls qui ont accepté la domination portugaise, ou, sur un autre continent celles nouées par Cortés pour battre les Aztèques (très bien décrites par David Graeber & David Wengrow dans « Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité », aux éditions Les Liens qui Libèrent). L’historien a cette hauteur de parler indifféremment de tous les peuples, colonisateurs ou colonisés, sans tomber dans le politiquement correct contemporain, décrivant par exemple des nomades maritimes supplétifs des Portugais à Malacca, comme une « petite troupe braillarde » ; comme il parle des Portugais, en somme.
L’un des aspects particulièrement intéressants de ce petit livre est de donner à voir la vision des « conquis », lorsque trace en a été conservée ; c’est par exemple le cas des Malais à propos de la prise de Malacca en 1511 – où Magellan prend un esclave qu’il ramènera en Europe, baptisé Enrique, nous y reviendrons –, dont on apprendra que les Portugais y sont décrits comme des « êtres torves » (p. 27). Les conquérants n’ont pas le beau rôle, dans cette histoire.
Très bien documenté, donnant souvent des descriptions très précises des endroits et des circonstances, telles que les sources permettant de les connaître, on y découvre un Magellan soldat avant tout, pas un découvreur. Il agit pour la gloire et (surtout ?) pour la richesse (p. 31). Les armées de l’époque semblent davantage ressembler à ce que nous appelons aujourd’hui des troupes de mercenaires. Un soldat qui a aussi été un excellent marin.
Magellan est un homme impulsif, colérique et aussi très gonflé. Après que sa monture a été tuée au cours d’un combat, il en demande dédommagement au roi du Portugal (p. 32). Éconduit, il se met au service du roi d’Espagne et « traîne sa rancune du côté des tavernes du pont des Barques, à Triana », vieux quartier de Séville, « là où coulent le vin et les confidences des marins et des pilotes », image d’un Magellan dans le mal qui me l’a rendu très humain, presque sympathique (p. 37).
À cette époque, les gens savaient bien sûr déjà depuis longtemps que la Terre est ronde, et non plate, au moins depuis Aristote – en particulier grâce à l’observation de l’ombre portée par la Terre sur la Lune lors des éclipses de Lune, où l’on voit clairement la rotondité de notre planète (p. 39) – conseil pratique pour les platistes d’aujourd’hui, hauts représentants de la bêtise.
 Naviguer au loin, les Ibériques avaient les bons navires, les caravelles. La principale difficulté de navigation est « le calcul des longitudes [qui] est le grand tourment des pilotes » (p. 40), faute de chronomètre précis. C’est aussi cette difficulté qui rend incertaine la position du but du voyage de Magellan – les Moluques – et cause de nombreux naufrages, comme, deux siècles plus tard, celui du Batavia, dont Simon Leys fera un superbe récit, « Les naufragés du Batavia ».
Naviguer au loin, les Ibériques avaient les bons navires, les caravelles. La principale difficulté de navigation est « le calcul des longitudes [qui] est le grand tourment des pilotes » (p. 40), faute de chronomètre précis. C’est aussi cette difficulté qui rend incertaine la position du but du voyage de Magellan – les Moluques – et cause de nombreux naufrages, comme, deux siècles plus tard, celui du Batavia, dont Simon Leys fera un superbe récit, « Les naufragés du Batavia ».
C’est sur la « foi de cartes mitées et de calculs alambiqués » (p. 41) que Magellan veut partir trouver une route pour ramener les épices, en faisant le pari que les Moluques – où poussent les très précieux clous de girofle – se trouvent dans la partie portugaise du monde tel que divisé par le traité de Tordesillas (celui qui explique, entre autres choses, pourquoi le Brésil est lusophone). L’Espagne et le Portugal, bien que férocement rivaux, ne veulent pas se faire la guerre et prennent le Pape pour témoin ; ils tracent un méridien et son antiméridien et décrètent : ce qui est à l’ouest est espagnol, ce qui est à l’est est portugais.
L’irruption de Magellan à la cour d’Espagne est relatée par un témoin de choix, Bartolomeo de Las Casas – futur défenseur de la dignité des amérindiens à la controverse de Valladolid – qui trouve qu’il est « bien petit », boiteux, et qu’il a l’œil torve (p. 42). L’idée présentée par Magellan n’est pas de faire le tour du monde, mais de trouver une nouvelle route vers les épices et de revenir par le même chemin. « Voici dissipé, nous dit Romain Bertrand, le mythe d’un voyage d’exploration avec la vérité pour trophée » (p. 44). Le récit que j’ai lu quelques fois, expliquant les succès des conquêtes et explorations européennes par leur conscience des limites de leurs propres connaissances, caractéristique que ne partageaient peut-être pas les autres grandes civilisations… est bien une fable, celle d’une forme de singularité de l’occident, opportunément inventée et entretenue par des occidentaux.
Le roi accepte. Va pour un amiral portugais qui dit qu’il y a un passage au sud. Cinq navires sont armés et Romain Bertrand fait l’inventaire des hommes et des choses qui embarquent sur les nefs de Magellan (p. 48). Je ne peux que renvoyer, pour une majestueuse exhaustivité, à la superbe édition du récit d’Antonio Pigafetta – le chroniqueur de l’expédition –, « Le voyage de Magellan » aux éditions Chandeigne ; on y lit en particulier une courte biographie des 242 hommes d’équipage, où l’on constate qu’il y en avait littéralement de partout, des Basques, des Italiens, des Espagnols et des Portugais, bien sûr, mais aussi des Allemands, des Français, des Grecs, etc. et même des Africains, un Malais (Enrique, l’esclave de Magellan). Mais revenons à « Qui a fait le tour de quoi ? » : un paragraphe m’a semblé particulièrement intéressant en contraste de l’époque actuelle qui voit réapparaître la « race » comme catégorie acceptable : « la couleur de peau ne suffit pas à distinguer les esclaves : non seulement parce qu’il est des “libres de couleur”, mais aussi parce que – héritage et effet des présences arabes – les teints mats ne sont pas rares en Andalousie » (p. 50).
Romain Bertrand a un talent particulier, un souffle et du style, pour donner à ressentir ce qu’ont dû ou pu ressentir les protagonistes de l’époque. Exemple : « La nature tropicale décontenance trop les Européens pour qu’ils la jugent belle, donc digne de description. Ce fouillis de verts, des entrelacs de lianes et de ramées, les mille fermentations musquées des sous-bois, ils ne les comprennent pas. Ils sont habitués à la découpe nette des oliviers sur la terre rouge, aux fruits circonspects du noyer, au goutte-à-goutte des formes et des couleurs. Ici tout déborde, tout déferle, s’étale sans retenue, se répand à jets continus. Tout est trop confus » (p. 59). Il poursuit – et je m’esclaffais de cette géniale image : « Il y a souvent chez le conquistador quelque chose du touriste déçu, de celui qui, s’étant avant son départ fait une image trop nette de ce qu’il ne connaît pas encore, enrage, une fois sur place, que le réel déroge à son rêve » (p. 60).
Après avoir trouvé et franchi ce qui s’appelle aujourd’hui le détroit de Magellan – une incroyable prouesse, avec leurs bateaux qui ne remontaient pas au vent – Magellan et son escadre (délestée de quelques capitaines espagnols fêlons prestement occis) s’engouffre dans le Pacifique. Colossal Pacifique. Mais au cours de leur interminable traversée de cette nouvelle mer océane, les hommes de Magellan ne succomberont que très peu au scorbut – 10 sur 166). C’est qu’en Patagonie ils avaient eu la bonne idée de faire des conserves d’un truc trouvé sur place, « Apium australe : un végétal qui ne paye pas de mine. De petites touffes compactes et proprettes, des allures de ciguë avec des ombelles blanchâtres perchées au sommet de pétioles étiques. Ça n’a rien à voir, bien sûr, mais tout de même, ça fait parterre de géraniums ». Et c’est l’occasion pour l’historien de rappeler ce qu’était probablement la sociologie de ces équipages de marins, soldats, canonniers, calfats, charpentiers et mousses : « Il fallait bien être plus paysan que marin pour penser à s’en nourrir » (p. 63).
Les européens, quand ils rencontrent des autochtones, ils en kidnappent toujours, une sale manie comme aujourd’hui les touristes ramènent des magnets d’un pays ou d’une ville qu’ils ont « faits ». Les Patagons qu’ils ont embarqués se laissent mourir de tristesse. À l’heure de la mort, les Portugais les baptisent, histoire de : « “Paul” n’est pas un prénom, à peine un requiem. Les Espagnols jettent leurs mots comme des linceuls sur les êtres. Ils ne parlent du monde que pour lui imposer le silence, le faire taire à jamais » (p. 66).
En passant, Romain Bertrand nous donne d’ailleurs l’explication la plus probable de l’origine du nom de « Patagonie » : « Patagón » est le nom d’un géant à tête de chien dans un roman de chevalerie paru en 1512, Primaleón de Grecia (p. 67), probablement embarqué par l’un des hommes de Magellan ; c’est donc la littérature qui permit de nommer cet endroit qu’ils abordent pour la première fois. Faute de parler avec les locaux, qui, tous les humains font ça, nommaient leurs terres.
Lorsque les hommes de Magellan abordent les premières îles de l’Asie, ce ne sont pas les premiers étrangers que les habitants de ces archipels voient arriver. Ce monde du Sud-est asiatique est depuis longtemps connecté à l’occident. C’est d’ailleurs ce qui explique que ces populations n’ont pas été décimées par un « choc microbien » comme l’ont été les Amérindiens (p. 75). On peut même dire que la décimation sera du côté des arrivants : « L’Histoire ne débute pas avec l’arrivée des Européens en Asie. Elle les y attend, un sourire narquois au coin des lèvres » (p. 77).
 Lorsqu’il arrive sur l’île de Cebu, Magellan y scelle un traité de paix avec son roi, Humabon ; Magellan n’en prend pas possession, il compose. Faute de moyens militaires, sans doute. Mais c’est aussi que les calculs de longitude montrent clairement qu’ils sont dans la partie portugaise du monde. Or toute l’expédition était fondée sur l’idée que les îles aux épices étaient du côté espagnol. Peut-être est-ce cette déception, et une immense colère, qui entraîneront Magellan à prendre les risques qu’il prendra : son expédition est un échec (p. 88). Devenu l’instrument d’Humabon, qui, tout frais vassal du roi d’Espagne, lui demande assistance et protection, il ira combattre un seigneur local indocile, Lapu-Lapu, sera surpris par un millier de guerriers motivés et bien armés et y laissera la peau sur une plage (p. 87).
Lorsqu’il arrive sur l’île de Cebu, Magellan y scelle un traité de paix avec son roi, Humabon ; Magellan n’en prend pas possession, il compose. Faute de moyens militaires, sans doute. Mais c’est aussi que les calculs de longitude montrent clairement qu’ils sont dans la partie portugaise du monde. Or toute l’expédition était fondée sur l’idée que les îles aux épices étaient du côté espagnol. Peut-être est-ce cette déception, et une immense colère, qui entraîneront Magellan à prendre les risques qu’il prendra : son expédition est un échec (p. 88). Devenu l’instrument d’Humabon, qui, tout frais vassal du roi d’Espagne, lui demande assistance et protection, il ira combattre un seigneur local indocile, Lapu-Lapu, sera surpris par un millier de guerriers motivés et bien armés et y laissera la peau sur une plage (p. 87).
Parmi les rescapés, huit Européens sont vendus, esclaves : « voici parachevé l’insertion des Espagnols dans les réseaux de négoce du Sud-est asiatique : de marchands, ils sont devenus marchandises » (p. 92).
Enrique, l’esclave malais de Magellan, a été affranchi par le Commandant dans son testament. Mais le nouveau patron de la Trinidad, Duarte Barbosa, ne respecte pas cette promesse. Ce traducteur lui est trop précieux. Espèce de salaud, doit penser Enrique. Il réussit à s’enfuir. Romain Bertrand consacre alors plusieurs pages (p. 95) à expliquer qu’il a pu regagner sa terre natale, Malacca. La thèse a été balayée par les hagiographes de l’expansion européenne… l’hypothèse qu’Enrique – qui est aujourd’hui célébré comme un héros aux Philippines – a pu être le premier homme à avoir fait le tour du monde leur était insupportable. Je confesse aussi avoir été particulièrement heureux de lire ces pages parce qu’il y a quelques années j’avais écrit une courte nouvelle qui relatait cette possible histoire.
Une fois Magellan mort, l’expédition continue. Et quelle ne fut pas la surprise de l’équipage de trouver à Bornéo… des musulmans. Les Espagnols venaient à peine d’achever leur « Reconquête » de l’Andalousie – l’expulsion des Maures – et voilà qu’ils en retrouvent aux confins du monde (p. 103).
Romain Bertrand, par son travail d’historien qui déconstruit le mythe de cette grande expédition, rend aussi justice, en mentionnant leur rôle, aux peuples que l’expédition de Magellan a rencontrés ; comme les Punan, chasseurs-cueilleurs nomades sans le savoir-faire desquels les entrepôts des marchands seraient restés vides, de camphre en particulier, difficiles à extraire de la forêt tropicale (p. 104).
L’expédition reprend… c’est aller vite en besogne. La réalité est qu’après un temps, après les Moluques, « le cœur n’y est plus ». Le récit de Pigafetta se remplit d’êtres imaginaires aux grandes oreilles, on imagine des choses incroyables, on bâille sur le monde, « le temps de la découverte est achevé, c’est de rentrer dont il s’agit désormais » (p. 115).

Le 6 septembre 1522, la Victoria accoste enfin à Sanlúcar de Barrameda. Ils ne sont plus que dix-huit Européens et trois Moluquois capturés. Malgré l’échec de l’expédition, ou peut-être par réaction, Elcano – le dernier commandant – écrit au roi : « Que Votre Majesté sache que ce dont nous devons tirer la plus grande fierté, c’est que nous avons découvert et fait le tour de toute la rotondité du monde, car venus par l’occident nous en sommes revenus par l’orient ». « Le voilà, le butin de la Victoria », conclut Romain Bertrand (p. 117).
Citons pour conclure la grande question qu’aborde Romain Bertrand dans ce brillant ouvrage (dont la brièveté semble appeler une amplification) : « Les Espagnols ont fait “le tour du monde”. Soit. Mais de quoi exactement ont-ils fait le tour ? Du globe, assurément. Mais du monde, c’est une autre histoire – ou plutôt quantité d’autres histoires : un inextricable écheveau de vérités, la mosaïque infinie des façons d’être, de penser, d’éprouver. Le monde, c’est la planète plus l’homme – l’homme tout entier, l’homme en tous ses devenirs. Les vaisseaux de Magellan n’ont pas croisé à la surface étale et atone d’un flot vierge qui n’attendait que la signature de leur sillage. Ils ont serpenté le long d’une guirlande d’univers. Les Tupinamba du Brésil, les Tehuelche de Patagonie, les royautés des Philippines, les sultanats des Moluques et de Bornéo : autant de sociétés qu’ils n’ont pas su comprendre, qu’ils n’ont pas voulu considérer – autant de mondes qu’ils n’ont fait qu’érafler » (p. 119). Ainsi revisitée, l’expédition de Magellan synthétise la tension de la modernité, entre universalité – l’humanité faisant du globe sa grande maison commune par cette circumnavigation – et colonialisme dominateur (la modernité étant inventée au XIXe, ces interprétations restent acrobatiques). L’esclave échappé, Enrique, pourrait figurer la contestation et la perspective d’un ailleurs qui reste toujours possible.
Revenons sur le destin de la Trinidad, l’un des cinq navires de l’expédition : commandée par Gómez de Espinosa, un proche de Magellan, il a choisi de retourner au Portugal par l’est, c’est-à-dire en retraversant le Pacifique, sans se lancer à faire le tour du monde. Ils n’y parviendront pas et rebrousseront chemin, mais cela pose une question : les instructions de Magellan étaient-elles de ne surtout pas s’aventurer dans la partie du monde réservée aux Espagnols, ce qui obligeait à rentrer par l’est ? « Ce qui ferait de Magellan un authentique héros de tragédie grecque : un homme aux espérances brisées, qui boit son destin jusqu’à la lie » (p. 124).
On peut rire parfois, mais sans oublier le lot de misères et de douleurs de toute cette histoire, de commerce et de conquêtes coloniales. Beaucoup d’hommes meurent, des enfants souffrent. Tenez, en guise d’histoire à tirer des larmes de tristesse, celle de Juanillo, fils du pilote João Lopes Carvalho et d’une Amérindienne, qui a fait la traversée du Pacifique à l’âge de sept ans et que son père, dans la précipitation du départ de la baie de Brunei, abandonne en otage à Bornéo, seul dans un sultanat musulman, si drastiquement éloigné de sa culture. Mais qui sait, peut-être après moult larmes s’est-il très bien adapté et ses gènes flottent-ils encore de-ci de-là en Indonésie et en Malaisie.
« Mafra, Juanillo, Hans le canonnier, Luis del Molino : il faut se souvenir de tous ces hommes, de toutes ces destinées ; il le faut parce que leurs noms sont des tombes sans épitaphes, des portraits sans légende. Bello, Martín de Ayamonte, Richard de Normandie, Juan Negro l’esclave africain : il faut se souvenir de tous ces hommes, de toutes ces destinées ; il le faut pour se rappeler cette simple vérité : il faut quantité de vies infimes pour faire une vie majuscule. Il fallut 241 mousses, marins, calfats et capitaines – et un esclave Malais – pour faire un Magellan » (p. 129).
En guise d’épilogue je ne peux que citer in extenso la magnifique conclusion de Romain Bertrand, revenant sur le livre de Stefan Zweig dont j’avais fait la chronique « Magellan, qui soulève la question de la littérature comme puissant vecteur des mythes historiques : « Le Magellan de Zweig est un héros sans failles ni faiblesses, l’archétype de l’homme qui abat un à un les obstacles qui se dressent entre lui et son rêve. Mais il est surtout une certaine idée de l’Europe, en laquelle le romancier s’efforce de croire encore, et ce alors même que la nuit monte en lui. La vraie mort de Magellan – c’est-à-dire la mort de l’idéal qu’on lui a fait endosser comme un vêtement trop grand pour lui, la fin du rêve complaisant d’une Europe toute de courage et de curiosité –, la vraie mort de Magellan a donc lieu le 22 février 1942, à Petrópolis, à 65 kilomètres de la ville de Rio de Janeiro, lorsque Stefan Zweig et Lotte Altman se suicident. Car les héros sont comme les fées et les divinités des contes pour enfants : ils ne meurent vraiment que lorsqu’on ne croit plus en eux. C’est douloureux, ça ne se fait pas sans un pincement au cœur, mais ça s’appelle grandir » (p. 136).
Audio – podcast – de la rencontre du 26 juin 2024 :
https://open.spotify.com/episode/13zHfmQGLCuWG1ouC0g2R1
J’ajoute que ce petit livre est idéal pour faire travailler des étudiants ou des élèves, en histoire mais aussi en littérature, en leur proposant par exemple d’imaginer les vies romancées de certains des protagonistes. Romain Bertrand m’a dit que de nombreux professeurs l’utilisaient ainsi.
Qui a fait le tour de quoi ?
L’affaire Magellan
Romain Bertrand
Verdier, 185 p.
2024