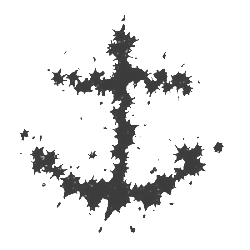Suprême recours
En octobre 2010 paraissait le numéro 28 de la revue Les Temps maudits, revue « théorique » de la CNT. J’en étais membre du comité de rédaction.
L’édito que j’avais en partie rédigé – et qu’il faut resituer dans le contexte d’une organisation syndicale – se concluait par quelques lignes qui me semblent résonner aujourd’hui, veille de la quatrième grande journée de mobilisation des “Gilets jaunes” :
“Il serait sain de n’avoir pas à recourir à la violence, fut-elle matérielle et seulement menace. Mais la seconde moitié du XXe siècle, faite de réformisme et de concessions de ce que l’on appelait naguère le mouvement ouvrier, s’est accompagné d’une aggravation des inégalités.
C’est donc bien que les moyens légaux, ceux que nous garantissent les droits de l’Homme, ne suffisent pas à faire respecter nos droits inaliénables à nous nourrir, vêtir, à nous loger, à nous éduquer, à vivre décemment. Et encore moins à conquérir notre dû sur le capital.
Il serait possible de la fermer. Mais, par l’éthique et par les tripes, nous sommes légitimes.
[…]
Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare : « Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression… »
Où est cet état de droit face à la tyrannie et à l’oppression économique ?
Ne serait-il pas temps de proclamer une « Déclaration universelle des droits à la justice sociale », non fondée sur la nature de nos personnes, mais sur le refus de la réalité de l’exploitation capitaliste ?
Notre parti pris éthique étant clair, et éthiquement fondé, la question suivante est de savoir quel niveau d’injustice et de misère nous devons atteindre et attendre pour sonner l’heure du « suprême recours ».”

Éditorial complet
Suprême recours
Quelle est la légitimité, le fondement éthique, de certaines actions syndicales comme les occupations, séquestrations, saccages de locaux, menaces de polluer une rivière proche ou de « faire sauter la tôle » menées par des travailleurs en lutte pour leurs droits, pour leur revendications, pour leurs vies ?
Des actions dont le nombre ne cesse d’augmenter ces dernières années, hors du contrôle des états-majors syndicaux ; des actions qui reflètent l’augmentation croissante des tensions au sein de la société ; des actions qui ne peuvent s’expliquer par le seul fait qu’elles sont souvent l’épilogue de situations désespérées.
Toute action doit être pensée. Si possible avant sa réalisation, sinon après. Mais nul homme, nul groupe, s’il tient à ne pas s’abandonner, ne peut se soustraire à l’examen éthique de son action.
Pour tous ceux qui aspirent à un changement de société et non uniquement à des pratiques de radicalité, pour tous ceux qui aspirent à jeter les bases d’une autre forme d’organisation sociale, politique et économique, il semble d’autant plus important de se pencher sur la légitimité de ce type d’actions syndicales.
D’abord parce que rien n’est vrai, légitime ou justifié « en soi ». Nous le pensons des actions, nous le pensons des droits de l’Homme : ceux-ci sont légitimes du fait de l’adhésion qu’ils suscitent, non d’un prétendu « droit naturel ».
Ensuite parce que nous considérons que les moyens déterminent la fin.
Enfin, la question de la légitimité de ces actions nous semble aujourd’hui importante parce que l’ère du temps est à l’anathème facile, « terroriste » et autres « intolérables prises d’otage ». Et que face à la pression de la communication de l’ordre établi, médias, experts et pouvoirs publics, il est nécessaire de pouvoir répondre, de pouvoir revendiquer nos actions sans défaillir, de se donner une chance de convaincre.
La justification fondamentale de nos combats pour une vie digne (et non pour le seul « droit » à une vie digne, que nous avons), pour la justice sociale là où une extrême minorité concentre une immense majorité des richesses, cette justification n’est pas fondée sur un impératif d’ordre dogmatique, religieux, panthéiste, irrationnel.
La justification fondamentale de nos combats pour un monde juste et débarrassé de institutionnalisation des hiérarchies ne réside pas dans une hypothétique nature humaine ou un scientisme historique : nous sommes ce que nous faisons, là réside probablement notre seule essence. Et il n’est pas d’autre sens de l’histoire que celui que nous faisons, ou laissons faire.
Notre justification repose essentiellement sur un parti pris éthique face à une réalité objective, adossé à un sentiment viscéral : l’exploitation de l’Homme par l’Homme et l’administration d’une société qui permet la perpétuation de ce cannibalisme n’est pas notre conception de la vie.
Cela ne signifie pas que nous souhaitions imposer une façon de vivre et de nous organiser. Mais ce parti pris assumé fonde notre légitimité à nous opposer à ceux qui exploitent, à ceux qui chérissent et défendent une société dont le cœur économique, le capitalisme, est une industrie de l’injuste, comme il en est d’autres du luxe. Au mieux parce qu’ils la considèrent comme « le moins mauvais des systèmes », au pire parce qu’ils jugent pertinente l’institutionnalisation de la loi du plus fort. Et toujours parce qu’il en va de leurs intérêts moraux et matériels. Peu importe. Nous combattons un système dans toutes ses conséquences, et ce système est incarné par des hommes et des femmes. Ce parti pris s’oppose en tout point à celui du capitalisme, qui nous est imposé par la Loi et ses forces de l’ordre, et perpétué par la subordination du salarié qu’institue le Code du travail et le principe de l’héritage des fortunes.
Pour celui qui se bat contre les injustices et affirme la possibilité d’un autre futur, la détermination des moyens qu’il se donne pour concrétiser une telle opposition relève de deux critères : quels sont les moyens disponibles ? Les moyens employés sont-ils adaptés aux actes et états de fait contre lesquels il lutte ?
Les premiers moyens disponibles sont légaux et juridiques : participation aux instances démocratiques par l’intermédiaire d’élections – syndicales ou politiques – qui nous donneraient le poids suffisant pour infléchir certaines politiques ; appels à la Loi et à la Justice par le recours aux prud’hommes, aux tribunaux ou aux conciliations. Si ces solutions peuvent parfois permettre d’empêcher le pire, de gagner ou de rétablir certains droits, elles ne permettent pas de modifier substantiellement la condition de ceux qui travaillent – ou devraient pouvoir travailler – face à ceux qui détiennent les capitaux. Ces dernières décennies l’ont montré, tant par l’accroissement des inégalités sous des gouvernements dits de « gauche » (par exemple, les 10% de ménages aux revenus les plus élevés percevaient environ 30 % du revenu fiscal déclaré par les ménages en 1980, et en percevaient 32,5 % en 1998) que par l’incapacité des grandes centrales syndicales – en la matière, l’incapacité de celui qui « peut » est une forme de trahison – à opposer la force des salariés à la pression de classe qu’exerce les capitalistes et leurs amis élus, par la Loi, la force et l’idéologie.
Le deuxième moyen dont nous disposons est celui de l’établissement d’une pression par la grève et par la rue. La nécessité d’user de tels moyens – pas encore illégaux –, par exemple pour mettre à bas le CPE hier ou contrecarrer les politiques et « réformes » libérales, confirme l’inefficacité, ou l’insuffisance, des seuls rouages démocratiques et judiciaires, c’est-à-dire du réformisme.
Mais nous en sommes rendus à une telle arrogance du verbe et de l’agir de la part des possédants, à un tel flicage du corps social et à un tel battage idéologique (« la seule solution, c’est d’augmenter l’âge de départ à la retraite » annonent les ordures), que la rue et la grève ne suffisent souvent plus.
Par exemple les manifestations, rassemblements et actions autorisées en préfecture contre les expulsions de sans-papiers, infléchissent à peine le nombre d’expulsions.
Si les salariés en lutte, comme les emblématiques Contis, se contentaient de multiplier les manifestations, s’ils avaient choisis de n’être que des Sisyphes du trottoir, rien n’en serait changé du sort qu’on leur réserve.
Ni par la réforme, ni par la rue, pas assez par la grève.
Se pose dès lors la question des moyens illégaux, question corrélée à la proportionnalité des moyens de lutte adoptés face aux indignes dirigeants qui perçoivent les aides de l’État avant de licencier massivement, face à ceux qui nous virent parce que nous nous syndiquons, face à ceux qui, pour préserver ou accroître les dividendes de leurs actionnaires font peser toute augmentation de la productivité sur les travailleurs.
Disons-le d’emblée, les travailleurs qui se mobilisent sont des gens d’honneur. Puisque aujourd’hui on ne les tue pas, ils ne tuent pas.
Les travailleurs en lutte sont proportionnels – et quand ils ne le sont pas, quand la violence qu’ils déploient devient meurtrière, c’est en général contre eux-mêmes, par le suicide, qu’ils la retournent. A l’aune de ce principe de proportionnalité, les Contis qui saccagent une sous-préfecture, les salariés de 3M ou de Molex qui séquestrent leur patron, les Sodimatex qui menacent de faire sauter leur boite, les salariés de Daewoo ou de Lenoir-et-Mernier qui menacent de polluer leur rivière ou les travailleurs sans-papiers qui multiplient les occupations ont-ils le droit éthique d’agir ainsi ?
Autrement dit, le parti pris éthique que nous évoquons plus haut est-il légitime ?
Avant que d’argumenter, rappelons qu’il s’agit des conditions de vie et de santé physique et mentale de gens réels – et non de guéguerres morales ou « sociétales ». Il s’agit de la seule chose d’importance qui soit, se nourrir, se loger, se soigner, la vie.
Notre réponse, dont nous ne prétendons pas qu’elle soit universelle, est oui : le parti pris éthique est légitime. Et ce pour deux raisons :
1 – Puisque aucun moyen, légal, de rue ou juridique ne permet d’établir un semblant d’équilibre des forces entre salariés et patronat ou État quand il se fait promoteur de l’idéologie capitaliste, il n’y a le choix qu’entre accepter de se poser parfois à la marge de la légalité, ou de se résigner. Or, et c’est un des fondements des droits de l’Homme, nous avons le droit ne pas nous résigner à une vie précaire et misérable.
2 – Les conséquences des décisions des capitalistes impactent essentiellement l’espérance de vie, la santé, les conditions de vie et la joie de vivre des seuls travailleurs. Le fondement du respect de la légalité est l’existence d’un pacte social commun. Un tel pacte n’est possible que si tous, au sein d’une société, partagent équitablement les efforts nécessaires. Dès lors que ce n’est pas le cas, ceux sur qui on fait peser l’essentiel des efforts sont fondés à remettre en cause les règles – la légalité – qui brisent le pacte social de base.
De plus, puisque les actions dont nous parlons se réduisent toutes à des menaces, des pressions physiques ou des violences contre des biens, oui, elles peuvent être considérées comme éthiquement légitimes.
Face à ceux qui font de nous des variables d’ajustement, face à ceux qui déclenchent la violence des flics, nous menaçons, occupons, retenons quelques heures des patrons et dévastons quelques locaux. Il y a proportionnalité. Et nous avons de la marge.
Il serait sain de n’avoir pas à recourir à la violence, fut-elle matérielle et seulement menace. Mais la seconde moitié du XXe siècle, faite de réformisme et de concessions de ce que l’on appelait naguère le mouvement ouvrier, s’est accompagné d’une aggravation des inégalités.
C’est donc bien que les moyens légaux, ceux que nous garantissent les droits de l’Homme, ne suffisent pas à faire respecter nos droits inaliénables à nous nourrir, vêtir, à nous loger, à nous éduquer, à vivre décemment. Et encore moins à conquérir notre dû sur le capital.
Il serait possible de la fermer. Mais, par l’éthique et par les tripes, nous sommes légitimes.
La jeune histoire du capitalisme a connu son essor au XIXe siècle, imposant sa propre légitimité de l’exploitation. A la suite des deux guerres mondiales du XXe siècle auxquelles ses premières crises avaient conduit, il a promis la croissance aux pays « développés », en méprisant le reste du Monde. La fin du XXe siècle et ce début du XXIe confirme que le capitalisme est un système qui se développe en creusant les inégalités, et se régénère de ses folles entreprises, concurrences fratricides, gaspillages et émergence de ses nouveaux empires par des crises que les citoyens, majoritairement – et factuellement – non capitalistes, sont contraints de payer. De plus, âpre legs du communisme d’État, la fin de l’Union Soviétique a servi de prétexte à certains – prétexte heureusement déjà frelaté – pour clamer que le capitalisme était le seul système possible, et de surcroît une condition nécessaire aux libertés démocratiques.
Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme déclare : « Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression… »
Où est cet état de droit face à la tyrannie et à l’oppression économique ?
Ne serait-il pas temps de proclamer une « Déclaration universelle des droits à la justice sociale », non fondée sur la nature de nos personnes, mais sur le refus de la réalité de l’exploitation capitaliste ?
Notre parti pris éthique étant clair, et éthiquement fondé, la question suivante est de savoir quel niveau d’injustice et de misère nous devons atteindre et attendre pour sonner l’heure du « suprême recours ».