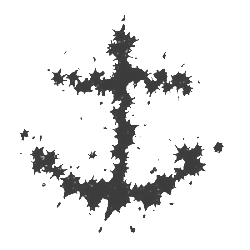Une fin pour un début
Fin d’une époque
La loi travail du président Hollande met fin, en France, à un cycle entamé en 1936 avec les grandes conquêtes ouvrières et leur représentation institutionnelle, le Front populaire. Je parle d’un cycle politique. Peut-être le capitalisme lui-même est-il aussi confronté à une agonie intrinsèque et structurelle, comme celle évoquée par le courant de la critique de la valeur. Mais l’une de ses caractéristiques essentielles étant sa capacité à se régénérer, à se réinventer en coupant ses propres membres défaillants, les prophéties du grand effondrement final sont toujours à considérer avec prudence. Mais regardons du point de vue politique : un gouvernement « de gauche », directement héritier du socialisme réformiste, impose une loi qui remet en cause des fondamentaux de l’équilibre patrons-salariés, gagnés par les luttes syndicales et politiques de nos aïeux. Les masques sont tous tombés, les Janus ne font même plus semblant. Leur politique est explicitement et ouvertement de contribuer à accroître l’avantage des détenteurs de capitaux, c’est-à-dire du patronat et des actionnaires, au détriment des travailleurs. Leur prétexte est de « relancer » une économie en la basculant toujours plus dans l’ornière des jobs précaires et sous-payés ; leurs vraies motivations sont probablement de favoriser leurs amis, leurs bailleurs de fonds, leurs anciens copainsdavant de promotion, leurs amis d’enfance nés dans la soie et d’appliquer les préceptes des professeurs d’économie chicagesques. Du côté des travailleurs (étant entendu que par travailleurs je désigne quiconque ne tire ses revenus que de sa force, son temps ou ses compétences, qu’il ait effectivement un emploi ou qu’il soit sans-emploi, et par opposition à ceux qui vivent du travail d’autrui ou de rentes) ; les travailleurs, donc, ont perdu les principaux leviers qui leur avaient permis de gagner des droits, quand le capitalisme avait quelque chose à redistribuer et de vagues craintes face aux millions de prolétaires organisés en syndicats et partis puissants : des partis de masse qui prônaient la fin du capitalisme, et des confédérations syndicales qui n’avaient pas abdiqué toute combativité en se noyant dans les verres à pied des cocktails de leurs pince-fesses cogestionnaires avec les organisations patronales.
Le cycle politique qui s’achève maintenant en France est celui de l’illusion d’un socialisme qui puisse gouverner et réformer le capitalisme. En presque cent ans de tentatives et expériences, que les socialistes de gouvernement aient été sincères ou non, peu importe, ils ont tout essayé. Que de temps perdu, de vies sacrifiées alors que des Bakounine, Rocker ou Luxemburg et de nombreux autres nous avaient prévenus. Mais ils l’avaient anticipé, déduits de leurs théories ou observations contemporaines, ou bien ils en avaient eu l’intuition. Mais ils n’avaient pas la masse d’expériences malheureuses de socialistes au pouvoir que nous avons, en 2016. Ils avaient prévenu d‘un risque. Nous pouvons observer comment ce risque s’est matérialisé. L’alerte a gagné la légitimité de l’expérience historique.
Précisons ici que par « réformiste » j’entends la prétention d’aménager, d’adoucir, d’équilibrer le capitalisme, indépendamment des moyens utilisés pour y parvenir, par une « révolution », ou par les urnes. C’est-à-dire que le « réformisme » s’oppose au bouleversement, à la destruction avant la reconstruction. Les « frondeurs » du PS n’y pourront rien, ils ne quittent pas le parti… le socialisme réformiste, celui qui court les dorures des palais de l’État, a ouvertement assumé, avec cette loi, sa mise au service du capitalisme.
Deux points supplémentaires me semblent confirmer la fin de ce cycle de l’illusion réformiste. Premièrement les déconvenues électorales ou les désaveux populaires des gouvernements « de gauche » réformistes nés aux marges des partis socialistes en Grèce et dans plusieurs pays d’Amérique Latine. Tout se passe comme si, après avoir promis et chanté, le constat de leur incapacité à changer les choses en profondeur devenait peu à peu évident (quand ce n’est pas leur trahison franche et nette). Logiquement – en Amérique – les électeurs, las et encore une fois déçus, s’abstiennent ou votent bêtement pour les mensonges de la droite. L’alternative politique de cette fin d’ère est peut-être là, pour ceux qui votent encore : le choix entre le mensonge et la trahison. Sans traverser l’Atlantique, remarquons enfin que Hollande fait – avec parcimonie, c’est son style – ce que Blair et Schröder ont fait il y a quelques années au Royaume-Uni et en Allemagne. Les travailleurs de ces pays s’en sont trouvés précarisés, appauvris, trahis. Dans les deux cas, des gouvernements qui se disaient de « gauche ». Les plus sales besognes, c’est la fonction que les maîtres donnent aux traîtres qu’ils emploient. Le cycle s’achève en France, mais il semble bien que ce soit un naufrage mondial.
Le socialisme réformiste ne parvient pas à modifier les choses en profondeur ; il ne le peut pas, et ne le veut pas. Après avoir été longtemps gestionnaire d’une chimère, le capitalisme à visage humain, il est désormais ouvertement promoteur et garant d’un retour au capitalisme XIXe siècle. C’est ce qu’on exige de lui pour qu’il soit « crédible » au pouvoir, sachant que la conservation du pouvoir devient très rapidement le principal objectif de tout détenteur de pouvoir. Par ailleurs, l’incapacité des gouvernements à acter des mesures drastiques face à l’imminence du désastre écologique désormais prévisible est frappante. Tout se joue à quelques degrés d’augmentation de la température. Dans les dizaines d’années à venir. Tout, c’est-à-dire également, peut-être, l’avenir de l’espèce humaine. Que les capitalistes et leurs représentants les plus évidents, la droite, s’en foutent et ne soient pas fermes sur la question est tout à fait cohérent avec leur vision strictement comptable et à court terme. Mais que les gouvernements dits « de gauche » fassent preuve de la même passivité et s’embourbent dans les mêmes molles arguties juridiques ne peut être que le signe, encore une fois, de leur totale incapacité – ou absence de volonté, comme on voudra – de réellement changer les choses si ces changements s’opposent à l’idéologie ou aux pratiques capitalistes.
Bien sûr, les tenants du réformisme diront : mais nous sommes en crise (économique). Nous vivons une situation d’exception. Dès que les courbes s’inverseront, nous repartirons. C’est nous prendre pour des imbéciles. Cela fait plus de quarante ans que nous sommes en crise. Presque deux générations. Depuis que le capitalisme est né, crise ou pas crise, ce sont les mouvements de lutte et de revendication qui ont arraché droits et redistributions. Les réformistes n’ont fait qu’acter dans la loi ces victoires, ou lâcher du lest de peur des insurrections ou paralysies durables de la production. Sur le fond, c’est-à-dire du point de vue historique, il faudrait se demander : l’état stable du capitalisme ne serait-il pas, précisément ce que les économistes appellent les états de « crise » ? Le capitalisme n’a-t-il pas vécu, depuis sa naissance, davantage de périodes de « crises » que de périodes de croissance stable et confiante en l’avenir ? Ne seraient-ce pas les « Trente glorieuses » l’exception post-traumatique d’une guerre mondiale et totale ? (Exception que les USA commencent par subventionner – le plan Marshall –, et garantissent ensuite jusqu’aux années 70 en limitant la financiarisation spéculative – application des accords de Bretton Woods).
Prendre conscience et assumer la fin de ce cycle est simple à matérialiser : nous ne les croirons plus. Nous ne voterons plus pour la gauche réformiste, de gouvernement. Nous ne les préférerons plus à la droite. Ils ont fait le tour de leurs mensonges ; ils sont pareils. Pire peut-être, en cela qu’ils peuvent oser lancer des « réformes » que la droite ne pourrait pas envisager, sûre de voir des millions de gens les faire plier dans la rue.

La forme, c’est-à-dire la façon dont cette loi a été adoptée, marque – certes moins nettement – le début de la fin d’une autre illusion : la démocratie républicaine. L’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution pour adopter une loi qui bouleversera les équilibres économiques du pays, faute de majorité, est un fait du prince, un acte dictatorial de l’autorité qui délite l’idée et la pratique de la démocratie. Hollande a été élu il y a quatre ans, sans jamais que cette loi ne lui soit donnée en mandat. Mais notre régime frelaté et absurde permet aux élus d’obtenir des mandats blancs de cinq ans au cours desquels ils peuvent faire ce qu’ils veulent, sans rendre aucun compte ni risquer aucune sanction – en particulier trahir leurs promesses. Des millions de gens sont descendus dans les rues pour manifester contre cette loi et ont pris des risques physiques face à l’agressivité de la police. La plupart des sondages semblent bien indiquer que la majorité des Français est contre cette loi. À l’Assemblée nationale qui est censée être le lieu de la représentation du peuple, qui est le lieu où se décident et se votent les lois, il n’y a pas de majorité pour adopter ce projet. Alors le gouvernement Valls, armé de cette détestable et gluante morgue de caporal complexé, décide d’imposer la loi comme s’il s’agissait un arrêté municipal interdisant un square aux chiens. Même tenus en laisse. Ce sont des traîtres à leur parole, « mon ennemi c’est la finance » et tout ça, c’est entendu. Mais que nos institutions permettent de tels actes d’autorité, et que ce soit la « gauche » qui le fasse, elle qui a en principe moins d’appétence pour l’autoritarisme que la droite, est un signe de la faillite de la démocratie républicaine. Les millions d’électeurs qui s’abstiennent élection après élection en sont un autre symptôme.
Pression
Tout semble indiquer que nous sommes entrés dans la phase finale d’une énième recomposition du capitalisme, fruit du transfert d’une pression de la répartition vers une pression du lowcost. D’une part la pression pour la répartition, menée par les mouvements ouvriers a drastiquement diminué depuis le début des années quatre-vingt ; d’autre part, la pression des économies des pays émergents qui conquièrent des marchés et produisent à n’en plus finir pour satisfaire nos fringales consuméristes dans des conditions sociales paléolithiques entraîne la désindustrialisation constante des pays comme la France. Moins de travail, moins de revenus, moins de luttes. Au lieu de lutter pour une répartition plus juste entre les revenus du capital et ceux du travail, ou, mieux, pour l’abolition des revenus du capital, beaucoup de travailleurs s’oublient et se laissent envahir par le consommateur façonné par les médias (avez-vous remarqué l’omniprésence médiatique des rubriques « conso » ?). Courir la promotion, s’endetter pour le superflu, javelliser la solidarité, les cultures et savoir-faire de lutte. Vivre sa vie en courbant l’échine et digérer le temps qui passe comme un mauvais fast-food.
Cette recomposition du capitalisme accroit souffrances et douleurs, et il est possible que le pire soit à venir. Précarisation, ubérisation, salaires à la baisse, horaires à la hausse, droits en berne, mécanismes de répartition poussés à la faillite… Mais le pire ce sera aussi la bêtise qui s’empare toujours d’une partie de la population quand le sol se dérobe : xénophobie, racisme, nationalismes, fascismes, communautarismes, replis religieux, violences entre exploités, etc. Il n’existe aucun théorème politique démontrant que du délitement d’une époque ne peut naitre que l’opportunité de vergers verdoyants. C’est même souvent le contraire : les ressources de la fange sont inépuisables. La seule option raisonnable est de ne rien lâcher et d’augmenter la pression face aux réformes capitalistes. D’affirmer, par les mots et par l’action : vous mentez. Un autre monde est possible. Vos réformes sont vos résignations à servir des maitres qui nous méprisent tous. Pour lesquels nous ne sommes que des ressources humaines. C’est la seule façon de contrecarrer les efforts des capitalistes et du gouvernement pour maintenir l’ordre, c’est-à-dire l’ordre qui s’effondre. Aujourd’hui, pour l’État, imposer l’ordre établi revient à nous précipiter tous dans le chaos.
Mais si des travailleurs s’oublient, des millions pourraient aussi être en train de se réveiller. Au cours des dernières manifestations contre la Loi travail El Khomri il y a eu des violences. Les médias bouclent à n’en plus finir sur les « casseurs », évoquent un jeune à Rennes qui a perdu un œil suite à un tir de flashball, et plus souvent des policiers pris à partie et blessés, une voiture incendiée. Ceux qui ont été dans les manifestations racontent les syndicalistes arrêtés, des dizaines de gens qui affrontent les forces de l’ordre, les locaux syndicaux défoncés par la police sans mandat de perquisition, les papis et mamies aspergés de lacrymo mais qui ne rentrent pas chez eux, des points de suture par centaines, les flics en civil qui passent les lignes, provoquent, frappent et arrêtent.
Les sociétés humaines sont comme la croûte terrestre : souvent les continents dérivent paisiblement. Mais quand trop de tension s’est accumulée – quand un cycle arrive à son terme –, quand un grand changement est devenu nécessaire, alors les forces en tension finissent par craquer en tremblement de terre.
Chez beaucoup de Français subsiste le tabou de toute opposition physique. Comme si la dignité avait quelque chose à voir avec la passivité. Peut-être est-ce en partie ce qui explique l’introuvable jonction entre les mouvements sociaux « classiques » et les mouvements de révolte des quartiers (comme ceux de novembre décembre 2005 suite à la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré), ces derniers assumant, d’emblée et sans simagrées, un certain niveau d’engagement.
Pourtant, un fait notable est arrivé au cours des manifestations du 1er mai 2016 : quelques centaines de personnes seulement, certes, affrontaient directement les forces de l’ordre. Mais des dizaines de milliers d’autres les appuyaient de leur présence, de leur sollicitude et de leurs slogans. Sachant que l’immense majorité des gens qui se mobilisent contre la loi travail sont également antifascistes, peut-être le fait que sept policiers sur dix votent Front national n’est-il pas étranger à cette solidarité de fait avec ceux qui les affrontent (cf. une étude récente du Cevipof).
Quoi qu’il en soit, de plus en plus de gens s’interrogent sur l’éventuelle nécessité de monter d’un cran l’engagement et refusent de s’accoupler aux médias pour japper les « casseurs, horreur, des casseurs ! ». Ce qui semble émerger c’est bien l’idée que les réactions populaires devraient être proportionnelles en intensité à l’ampleur des attaques subies et à la répression. Retourner contre le gouvernement ses pathétiques tentatives de manipulation et de division des manifestants ; braver l’état d’urgence dont il est désormais évident qu’il n’est maintenu que pour faciliter le contrôle et la répression du mouvement social. Face à la charge capitaliste menée par le gouvernement, des marches paisibles ne suffiront pas.
Lorsqu’il est question de réagir physiquement, deux garde-fous sont indispensables : premièrement, l’action ne doit être confiée à aucune « avant-garde », et elle doit toujours rester dans les limites de l’assentiment et de la participation du plus grand nombre. Deuxièmement, la proportionnalité est essentielle. Tout semble indiquer que sans réaction de défense plus intense, les protestations en forme de gentilles randonnées urbaines ne serviront à rien. Et il est visible que l’intensité de l’action des gens qui vont à l’affrontement contre les forces de l’ordre au cours des dernières manifestations s’étalonne sur le niveau de répression et d’agressivité de la police. Quant au traitement médiatique, quel humaniste peut rester de marbre face à la disproportion du temps d’antenne donné à la dénonciation des dégradations matérielles versus les yeux crevés par des tirs de flashball ou la mort de Rémi Fraisse ? Risquer de bruler vif des policiers dans leur voiture est idiot. Mais cela ne justifie pas d’envoyer des gens en cour d’assises. Et en ces temps d’arbitraire, rappelons avec force un principe essentiel du droit : ceux qui ont été arrêtés sont innocents. Sur les faits, il semble bien que les dossiers soient tout à fait vides. Les tireurs en uniforme qui éborgnent ou tuent en lançant des grenades offensives y sont-ils déférés, eux, aux assises ? Non, alors qu’eux ont estropié à vie et ont tué. Ramenons les choses à leurs justes proportions : la plupart des actions ces dernières semaines sont symboliquement ciblées (banques, chaines de magasins fers de lance du capitalisme, locaux du Parti socialiste flétris de « 49.3 », etc.) et les réactions contre la police sont en deçà de la violence que celle-ci déploie.
Rien ne garantit qu’une réaction plus intense, tumultueuse, dans la rue fasse reculer les fanatiques du gouvernement. Mais il est certain que des « journées d’action » ne le feront pas.
La rue n’est qu’une dimension. Une insurrection, même réussie, ne fait pas une révolution. Sans doute faudra-t-il la coupler à une paralysie économique de la société, c’est-à-dire la grève, des blocages, des occupations. Et aussi à un projet, des propositions, un projet de société. Peut-être les initiatives comme Nuit debout permettent-elles de faire grandir cette nécessité. Mais il faut aussi une organisation. Le spontanéisme, y compris avec sa dimension de riposte à la répression policière est une dimension importante de la résistance populaire. Mais c’est se méprendre que d’imaginer qu’il serait possible de transformer, sans organisation, un refus en résistance puis en conquête.
Le totem appelé « gauche républicaine » a pourri. Personne ne peut plus ignorer sa toxicité. Mais il ne tombera pas tant que nous craindrons le tabou de nos corps en risque face aux gaz et aux matraques ; il ne tombera pas sans multiplier les actions syndicales de base libérées des injonctions modératrices des états-majors confédéraux. Et nous ne le dépasserons pas sans penser l’autre futur auquel nous aspirons, au-delà des slogans et protestations. Et nous ne construirons rien de stable sans organiser les élans collectifs.