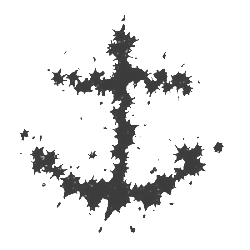Une nuit au concert
Un concert de musique classique, ça faisait des années. J’en écoute beaucoup, pourtant ; mais le temps passait et les salles de concert feutrées restaient loin. Une amie de ma compagne ne peut se rendre à la Philharmonie, cette grande boite de conserve dont un architecte génial a fait une œuvre d’art, à côté du périphérique, à l’est de Paris. Nous dînons, ma compagne insiste, vas-y, il est vingt heures, ma fille rechigne à voir s’envoler son histoire du soir, j’hésite – depuis combien de temps n’es-tu pas allé à un concert ? – ça commence à 20h30. Allez.
Je saute sur ma vénérable 750, 22 ans et quelques fuites d’huile noire. On blinde et on y laisse de la gomme sur le bitume, on ne s’en veut pas, on se connaît bien tous les deux.
Approchant du périph je me rends compte que je n’ai pas de masque. Je m’arrête devant une épicerie et, sans avoir enlevé mon casque : bonsoir, vous vendez des masques ? Non, désolé, me dit la dame. Je repars, je me ravise, stop, j’y retourne : dites, vous n’en vendriez pas un, même un des vôtres, j’en ai absolument besoin, je vais à un concert. L’homme, le mari j’imagine, ouvre sa voiture garée juste en face de leur magasin, fouille dans une boite à gants saturée et me tend un masque bleu et blanc, jetable mais non jeté, légèrement froissé. Je suis content, merci monsieur, je file, au bord du flash jusqu’à la porte de Pantin.
En arrivant à la Philharmonie, j’enfile le masque : il sent très fort. Je reconnais immédiatement le parfum de l’épouse, celle qui m’avait dit qu’ils n’en vendaient pas.
J’entre dans la grande salle. Les musiciens me tournent le dos mais je suis face à la cheffe d’orchestre, Marin Aslop.
L’ouvreuse qui m’a placé réprimande gentiment un groupe qui avait abaissé ses masques. Dépassant de sa poche, un bouquin de Virginie Despentes. Mon masque sent fort le parfum.
La pianiste entre, Khatia Buniatishvili. Elle marche sensuel, elle sourit, elle annonce la couleur : son concerto pour piano n°1 de Ludwig van Beethoven sera généreux.
Et ça commence, et c’est merveilleux, Beethoven. Buniatishvili, elle, est d’une présence incroyable. Lorsqu’elle ne joue pas, elle balance et danse littéralement au gré de l’orchestre. Tout son buste, ses épaules, sa poitrine, son cou accompagnent le mouvement des concertistes. Et quand Ludwig fait claquer ses notes, les cheveux de la pianiste s’envolent et retombent comme des plumes en flocons sur ses épaules.
Tout sonne juste, tous les instruments, le rythme de l’ensemble, le piano et jusqu’aux sons des pages des partitions que les violonistes tournent quand ils en viennent à bout.
Lorsque le concerto finit, après plusieurs rappels et de nombreux bravos lancés par les spectateurs conquis, Khatia Buniatishvili revient et joue, sobre et calme, cette fois. Des larmes me viennent aux yeux tellement c’est beau. À la fin je demande à ma voisine, Schubert, croit-elle. Oui, elle avait raison, c’était bien l’Impromptu n°3.
Il n’y a pas d’entracte mais une pause, histoire de laisser l’orchestre de Paris reprendre son souffle.
On installe deux immenses harpes dorées que deux toutes fines femmes viennent basculer entre leurs jambes. Marin Aslop revient, c’est au tour de la Symphonie n°5 de Dmitri Chostakovitch. J’attends avec impatience le son des harpes, petites vibrations ténues qui sortent de ces titans baroques ; je ris en entendant les cors tonitruants, petits bouts de tuyaux en cuivre recroquevillés qui envahissent littéralement la salle de leurs vibrations.
Je crois qu’un des cameramans, plongé au milieu de l’orchestre, est amoureux d’une des clarinettistes, vu comme il la cadre. L’amour c’est comme ça, ça se voit à la façon de regarder. Elle joue Chostakovitch et ne le regardera pas une seule fois.
La cheffe d’orchestre, cette fois, ne lit pas de partition. Elle sait toute la symphonie de mémoire et lève le poing à la manière d’une guerrière submergée d’adrénaline lorsque Dmitri s’emporte en un vacarme mélodieux.
Je ne sens plus le parfum de la dame de l’épicerie qui m’a permis un merveilleux concert.