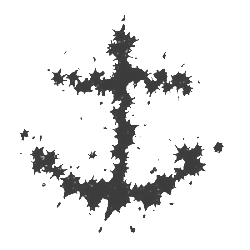L'affaire de la rue Transnonain
Un livre de Jérôme Chantreau
Dans un Paris « cimetière d’asphalte où dansent les fantômes » (p. 349), elle est amoureuse d’un jeune homme abattu par l’armée un jour d’émeute contre la monarchie en 1834, avec tous les habitants innocents d’un immeuble de la rue Transnonain (aujourd’hui rue Beaubourg). Il est un rude agent de police qui doute de l’histoire officielle qu’on veut qu’il raconte.
C’est l’histoire d’une femme – Annette – et d’un homme – Lutz – pris dans le maelstrom de l’histoire. C’est notre histoire, celle dont les motifs se répètent de siècle en siècle.
On y croise l’immonde Thiers en discussion avec le non moins puant général Bugeaud : « Monsieur le ministre, dans ce genre d’affrontement, c’est le gouvernement contre le peuple. Et à la fin, c’est encore devant le peuple que vous rendrez des comptes. Donnez-lui l’impression que vous l’avez défendu… contre lui-même […]. Tuez-en trois, vous êtes un assassin. Tuez-en mille vous êtes un sauveur » (p. 181).
On y croise des femmes qui écrivent, dans La Tribune des femmes : « L’État craint le peuple comme le mari craint sa femme. Tous deux recourent à la même violence. C’est toujours le faible qui asservit le fort » (p. 333).
On y pleure, on y apprend, on y vit la vie des personnages, on y sent la misère et la vie dure, on y rit, aussi :
« — Oui. Mais tu n’as pas grand-chose à craindre de lui.
— Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
— Des bobards de flique.
— Et tu lui as répondu quoi ?
— Des bobards de femme » (p. 341).
 Ce livre aurait pu n’être qu’un bon roman historique dans la matrice de notre époque qu’est le XIXe siècle. Mais c’est surtout de la très bonne littérature. Prenons un court paragraphe, que je trouve caractéristique de l’écriture de Chantreau :
Ce livre aurait pu n’être qu’un bon roman historique dans la matrice de notre époque qu’est le XIXe siècle. Mais c’est surtout de la très bonne littérature. Prenons un court paragraphe, que je trouve caractéristique de l’écriture de Chantreau :
« Lutz plisse les rides de son front et d’un coup, se lève de sa chaise. Il écrase son cigare contre le rebord de la fenêtre, ajuste son haut-de-forme et saisit sa canne en quittant la pièce.
La Seine exhale son odeur de marée basse jusqu’au quai des Orfèvres » (p. 290).
D’abord, Lutz. L’homme à l’air préoccupé, agacé, peut-être est-il inquiet et il semble pressé. Mais ce sont des impressions, une ambiance. Je l’interprète de ce qui se passe. Une page moins inspirée aurait explicité que Lutz est « fébrile », que « quelque chose le tracasse », qu’il est « agacé ». Son auteur paresseux aurait essayé d’imposer ses pensées plutôt que de ne proposer au lecteur que des circonstances. Les images que ce dernier s’en forgera seul n’en seront que plus intenses. Elles deviennent intimes, je fais mien l’état d’esprit de Lutz bien davantage que si l’auteur me l’avait servi avec des mots abstraits. Ernest Hemingway et Norman Mailer avaient raison*.
Ensuite, on perçoit nettement comment, par le personnage, l’histoire se met en mouvement. La page précédente on était avec le flic dans ses bureaux, à tourner en rond et ressasser, et soudain l’histoire repart en suivant les pas de Lutz. L’histoire repart et le lecteur dont les pensées pouvaient divaguer est saisi par l’inflexion de la voix du conteur qui change de ton, de rythme.
Une fois Lutz parti l’auteur change de point de vue. C’est peut-être ça, la littérature : nous donner mille yeux, mille points de vue, mille vies. Nous étions en intérieur avec un homme qui mène une enquête et brusquement nous voyons tout Paris. Alors on essaie de se souvenir des bords de mer, de retrouver l’odeur des estrans et on l’emmène à la ville sans océan. Et ça marche. Une odeur de vase, des effluves poisseux, des algues et des relents de mollusques en décomposition enveloppent le fleuve. Et ainsi, de l’image de quelque chose qui n’existe pas naît une sensation bien réelle.
La littérature s’accroche aussi au monde, au réel, au local. Elle le fait ici par la Seine et par l’évocation du quai des Orfèvres. Pour un lecteur lointain, ce sera un endroit comme un autre, comme la vieille capitale française en compte des milliers. Mais pour beaucoup de francophones ou de connaisseurs de Paris, le quai des Orfèvres c’est la police. La lectrice ou le lecteur qui arrive à cette page 290 sait que Lutz est policier, le rapprochement vient facilement. Mais si on ignore ce qu’est le quai des Orfèvres, ça marche tout de même. C’est là une autre caractéristique, je pense, de la bonne littérature : quand elle s’offre en multiples niveaux de lecture.
Enfin, on retrouve à l’œuvre la magie des associations, plus abstraite cette fois. L’odeur désagréable qui nous est restée en tête vient se mêler à celle, repoussante, du cigare écrasé. Ces exhalaisons empestent la maison police qui veut couvrir le massacre de la rue Transnonain. Mais Lutz se rebiffe.
Voilà pourquoi et comment ce court passage, et l’histoire toute entière, m’a tellement plu et fait les livres que j’aime et admire.
L’affaire de la rue Transnonain
Jérôme Chantreau
Éditions La Tribu, 460 p.
2025
* « Hemingway avait raison. L’adjectif n’est que l’opinion de l’auteur sur ce qui se passe et rien de plus. Si j’écris : “Un homme très fort entra dans la pièce”, cela signifie seulement qu’il est fort par rapport à moi. À moins de m’être déjà bien fait connaître du lecteur, je risque bien d’être le seul client du bar que la carrure du nouvel arrivant impressionne. Mieux vaut écrire : “Un homme entra. Il portait une canne et, pour je ne sais quelle raison, la brisa brusquement en deux comme une brindille”. Certes, cela est plus long à raconter. Et donc les adjectifs permettent une écriture rapide du genre je vais vous apprendre à vivre, moi. La publicité prospère là-dessus ».
https://abordages.net/les-vrais-durs-ne-dansent-pas